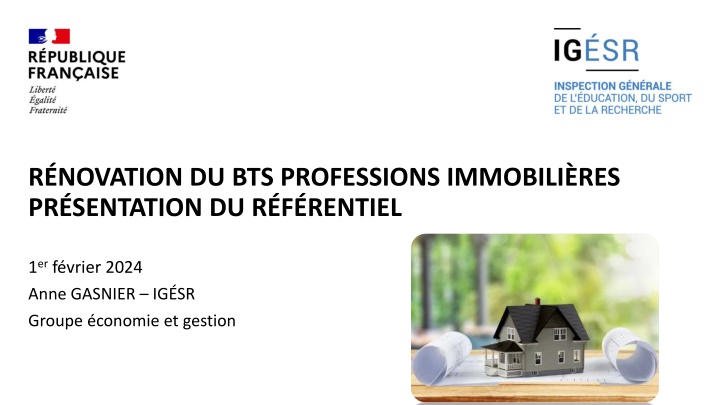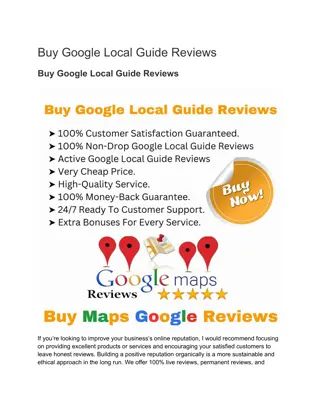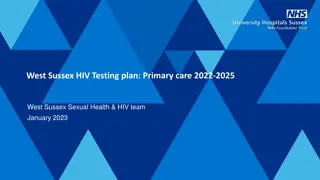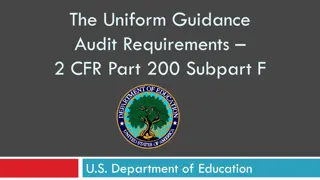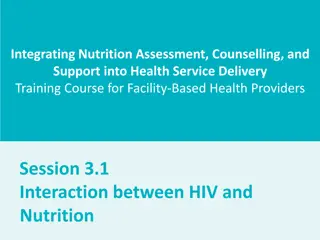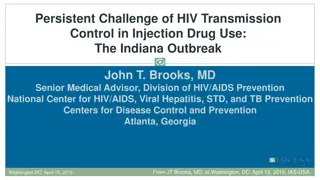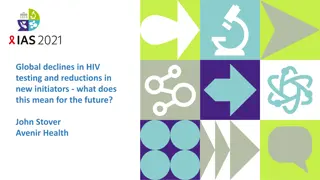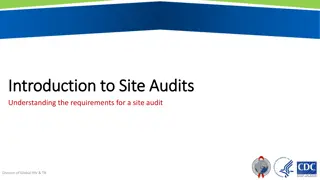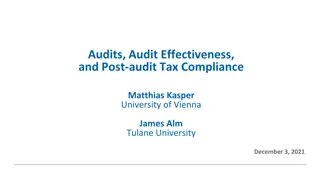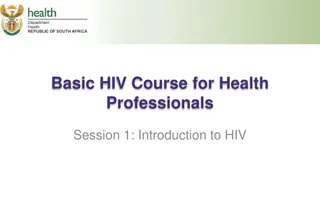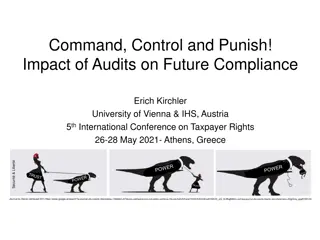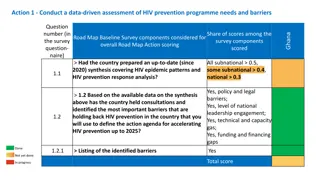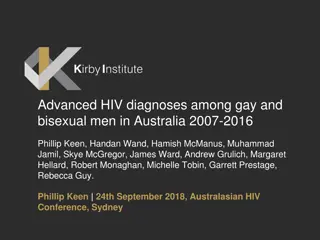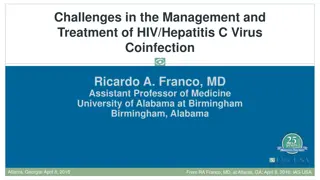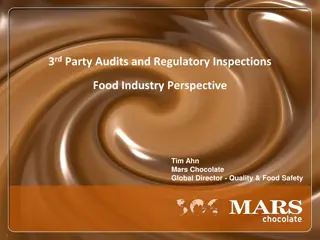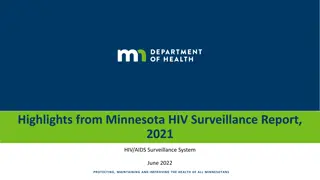Addressing Late HIV Diagnoses through Look Back Reviews and Audits
Late HIV diagnosis continues to be a significant issue, with a high percentage of adults diagnosed at an advanced stage. This study explores the implementation of look back reviews and audits to identify missed opportunities for earlier diagnosis, aiming to improve interventions and reduce late diagnoses.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
RNOVATION DU BTS PROFESSIONS IMMOBILIRES PR SENTATION DU R F RENTIEL 1erf vrier 2024 Anne GASNIER IG SR Groupe conomie et gestion
Dispositif daccompagnement de la rnovation Webinaire n 3 27/06/2024 Eclairages sur la certification PNF 15 mai Lyc e J. ZAY Paris Webinaire n 2 02/04/2024 Apports th matiques Webinaire n 1 01/02/2024 Pr sentation Phase de restitution du PNF en acad mie
Que recouvre lexpression professions immobilires ? Les m tiers de la g rance immobili re Administration d un ou plusieurs sites immobiliers et met en uvre les moyens techniques, administratifs, financiers et comptables de conservation ou d am lioration du patrimoine immobilier selon la r glementation. Exemple : administrateur de biens, syndic Les m tiers de la transaction immobili re R alisation des transactions immobili res et/ou fonci res (location, vente) et conseil aux clients sur les possibilit s d'acquisition, de location, de vente selon la l gislation de l'immobilier. Exemple : agent immobilier, marchand de biens, n gociateur Les m tiers de management de projet immobilier Superviser les tudes de faisabilit techniques, financi res, administratives de projets, programmes immobiliers en fonction des besoins d'une client le potentielle ou d'une collectivit . Assurer le lancement et la pr commercialisation des r alisations immobili res selon la r glementation, les d lais et les objectifs de rentabilit . Coordonner les diff rentes tapes du projet immobilier : conception ( tude, montage du dossier, ...), choix des ma tres d' uvres, construction, r ception des ouvrages. Exemple : Charg d affaires, responsable de programme 3
LE BTS PROFESSIONS IMMOBILIRES : une formation reconnue par les milieux professionnels Seul dipl me de niveau 5 Le titulaire du BTS professions immobili res acqui re les cartes professionnelles de transaction et de gestion Le secteur immobilier est r gi par la loi Hoguet n 70-9 du 2 janvier 1970 et son d cret d application n 72-678 du 20 juillet 1972. d di l immobilier Formation d veloppant la fois des comp tences en transaction et en gestion Un dipl me permettant une insertion directe tout en se pr servant la possibilit de sp cialisation ult rieure Acquisition de cartes professionnelles Statut l gal n cessitant la d tention de carte professionnelle
Trois lments essentiels criture du dipl me en blocs de comp tences Un dipl me qui a 10 ans Un dipl me reconnu par les milieux professionnels mais non crits en blocs de comp tences Des volutions int grer La derni re r forme date de 2012. Des volutions prendre en compte : Or le secteur a fortement volu durant la derni re d cennie domaine r glementaire apparition de nouvelles activit s volutions des pratiques professionnelles
1.1- Une modification du cadre juridique des certifications professionnelles - Loi du 5 mars 2014 relative la formation professionnelle, l emploi et la d mocratie sociale L art. L. 6113-1 du code du travail : L indication sont constitu es implique : - L obligation du d coupage d une certification professionnelle en blocs de comp tences ; Les certifications professionnelles sont constitu es de blocs de comp tences, ensembles homog nes et coh rents de comp tences contribuant l'exercice autonome d'une activit professionnelle et pouvant tre valu es et valid es. - Le fait que la notion n est pas forc ment exclusive, et plus sp cifiquement, la certification professionnelle peut tre constitu e d autres l ments, notamment certains savoirs g n raux qui ne contribueraient pas directement l exercice d une activit professionnelle Obligation de structurer toute certification professionnelle en blocs de comp tences - Loi du 5 septembre 2018 pour la libert de choisir son avenir professionnel Instauration de France Comp tences, organisme cl dans la construction des titres et dipl mes professionnels ( fixation d un cadrage)
Comptences et blocs de comptences Bloc de comp tences : ensemble homog ne et coh rent de comp tences contribuant l exercice autonome d une activit professionnelle 1. Une comp tence : La comp tence ne r side pas dans les ressources (connaissances, capacit s ) mobiliser mais dans la mobilisation m me de ces ressources . G. Le Boterf o La notion de coh rence , s appr cie au regard de l objectif de l exercice autonome d une activit professionnelle , et porte principalement sur l ensemble du d coupage de la certification en blocs ; - La comp tence s appr hende au niveau de l individu engag dans l accomplissement d une t che o La notion d homog n it renvoie principalement la coh rence propre du bloc au regard des comp tences qui le constituent. En ce sens, le bloc doit tre un assemblage coh rent de plusieurs comp tences, pour r pondre une activit professionnelle. - C est un processus et non la somme des connaissances et des m thodologies acquises - Il y a comp tence lorsqu un tudiant est capable o de mobiliser des ressources l occasion d une situation professionnelle o et de l expliciter Un bloc de comp tences regroupe des comp tences n cessaires pour r aliser un ensemble d activit s coh rent, qui correspond une dimension de la profession
1.2- Un secteur en pleine transformation Un secteur en tension Quelques chiffres Malgr un contexte conomique complexe l activit s est accrue tendanciellement dans le secteur. Depuis 1995, la contribution de ce secteur la valeur ajout e nationale a progress de 30 %. En 2020 les activit s immobili res d nombraient 212634 quivalent temps plein. En 2020, la valeur ajout e du secteur de l immobilier repr sente 13,4% de la VA nationale soit 276,2 milliards d euros. L immobilier repr sente l un des principaux postes de constitution de patrimoine des m nages. Dans le secteur de l immobilier, les services immobiliers repr sentent, en 2020, 72,13 % de la valeur ajout e de l immobilier, contre 30,31% en 1950. Une demande qui volue fortement li e : - aux volutions soci tales ( taille des m nages, pr occupation environnementales) - au contexte ( le confinement a profond ment modifi les attentes des m nages) - aux volutions en mati re d urbanisme 9
2- Un secteur en forte volution Des acteurs de l immobilier en pleine volution Des tendances sp cifiques - Un march oligopolistique avec quelques grands r seaux face une multitudes d agents de petites tailles - Une entr e en force du num rique qui r volutionne l exp rience client ( visite virtuelle, signature distance) et qui induit de nouvelles pratiques professionnelles et de nouveaux types d acteurs - Une sp cialisation des activit s Des acteurs qui se sp cialisent : R PARTITIONS DES AGENCES IMMOBILI RES - - - Administrateurs de biens Syndic de copropri t s Organismes de logement social 8% Agences ind pendant es R seaux sous enseigne 25% 67% Mandataires immobiliers 10
De nouvelles professionnalits se font jour : la suite du d veloppement important du secteur et l arriv e de nouvelles l gislations, plusieurs m tiers sont apparus encadrant l activit de transaction immobili re : diagnostiqueur expert immobilier am nageur foncier promoteur Certains acteurs se sp cialisent sur un segment d activit : sp cialiste en locations de vacances conseiller en immobilier d entreprise sp cialiste en viagers sp cialiste en affaires rurales et foresti res mandataire en fonds de commerce Les volutions conomique, sociale et environnementale induisent de disposer d une connaissance largie du secteur de l immobilier, notamment en prenant en compte l urbanisme, l architecture et une bonne connaissance du territoire d exercice. 11
Quelques questionnements apparus lors de la r novation : Les impacts du num rique : Les champs d appui des comp tences La prise en compte des volutions Quels nouveaux mod les d agence? - Changements soci taux - La gestion - Les cons quences li es au changement climatiques Quelles volutions dans la conception et la compatibilit des syst mes d information? - Le droit - Ouverture l architecture, l urbanisme?
1.3- Des volutions prendre en compte Des classes compos es essentiellement de bacheliers professionnels et technologiques. Ces tudiants n cessitent un accompagnement pour franchir 2 passages : de l l ve au statut d tudiant de l tudiant au futur professionnel L volution des tudiants Les rapports du GIEC ont maintenant d montr l existence du changement climatique. Le secteur de l immobilier est fortement touch par cette r alit : apparition de dommages sur les biens, cadre juridique en volution, mais aussi volution des demandes des clients. Le rapport de Jean JOUZEL, Sensibiliser et former aux enjeux de la transition cologique et du d veloppement durable dans l enseignement sup rieur Les incidences du changement climatique Un premier cycle de l enseignement sup rieur en plein volution Une concurrence accrue entre formations publiques et priv es s/c et celles hors contrats Une app tence pour l alternance
En rsum : une rnovation ncessaire pour un BTS Professions immobili res dont le r f rentiel datait de 2012 Structurer le dipl me en blocs de comp tences Un secteur porteur d emploi Une activit de syndic en pleine expansion Des volutions professionnelles importantes li es au num rique Favoriser la r ussite des tudiants Mieux pr parer l insertion professionnelle Int grer les pr conisations du rapport Jouzel Loi du 5 mars 2014, relative la formation professionnelle Une construction pour tenir compte de l attribution de la carte professionnelle Repositionner le dipl me au regard des volutions de la profession Inclure dans l criture des objectifs minist riels
Rappel sur le processus de rnovation dun diplme RAP Approbation R pertoire des activit s professionnelles Explicitation des motifs de la r novation Vote en CPCi Structuration du dipl me en blocs de comp tences Contenu des blocs R f rentiel de certification Organisation des enseignements Identification des activit s professionnelles pour le titulaire du dipl me Structuration des activit s en p les d activit Vote en CPCi Pr sentation devant les instances repr sentatives : CSL, CSE, CNESER Vote en CPCi R f rentiel des comp tences Dossier d opportunit
Les entretiens conduits ont permis didentifier les missions du titulaire du dipl me Pour les activit s de location, le titulaire du BTS est en responsabilit d un portefeuille de biens, pour lequel : il conseille et accompagne les propri taires bailleurs ainsi que les locataires ; il assure la mise en location et/ou la gestion locative. Pour les activit s de gestion de copropri t , le titulaire du BTS occupe un poste d assistant ou d assistante, ou bien de gestionnaire : en tant qu assistant ou assistante, il participe, sous l autorit d un gestionnaire, la gestion de copropri t s; en tant que gestionnaire, il est en autonomie pour la gestion courante d un portefeuille de copropri t s. Pour les activit s de vente, le titulaire de BTS met en relation vendeurs et acqu reurs de biens immobiliers sous un statut de salari ou d ind pendant : il constitue un portefeuille de biens et de prospects ; il conseille le vendeur et l acqu reur dans leurs strat gies patrimoniales respectives ; Il accompagne le vendeur et l acqu reur jusqu la conclusion de l acte d finitif. Un secteur professionnel r glement : Loi Hoguet du 2 janvier 1970 Des contextes d exercices multiples : au sein des diff rentes organisations immobili res, dans l immobilier r sidentiel dans les secteurs priv et social, mais aussi dans la promotion de la construction immobili re et plus marginalement dans l immobilier d entreprise.
Le Rpertoire des Activits Professionnelles ( RAP) a permis de mettre en vidence 3 p les d activit s P LE D ACTIVIT S 1 P LE D ACTIVIT S 2 CONDUITE DU PROJET IMMOBILIER DU CLIENT EN VENTE ET/OU LOCATION ADMINISTRATION DES COPROPRI T S ET DE L HABITAT SOCIAL P LE D ACTIVIT S 3 CONSEIL EN GESTION DU B TI DANS LE CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des choix ont t poss 2 Construction d un bloc support conomique et juridique propre ce BTS 3- Construction d un bloc transversal d di l accompagnement de l tudiant dans son d veloppement professionnel 1. Imposer la langue anglaise Comp tence demand e par le secteur. Les professions du secteur de l immobilier sont r glement es par la loi Hoguet. Choix de maintenir la fois les comp tences li es l crit et l oral et de s inscrire dans le formalisme commun aux BTS. Face aux enjeux d accompagnement des tudiants en BTS port e par la r novation de la voie professionnelle, L ensemble des activit s n cessite une connaissance approfondie en droit. Maintenir l accessibilit de ce dipl me tous les parcours ( notamment ceux issus de la voie professionnelle). Face aux objectifs d insertion professionnelle annonc s, Le programme de CEJM n est pas suffisant pour assurer la compr hension de fondamentaux n cessaires aux activit s immobili res en conomie et en droit. Le bloc construction d une professionnalit dans l immobilier permet un accompagnement affirm des tudiants en voie scolaire par une p dagogie de projet men e en co-intervention. La possibilit de pr senter une LV2 en preuve facultative permet de valoriser un parcours d tudiant.
Le conseiller ou la conseillre immobilier est charg(e) didentifier des prospects afin de prciser, voire susciter, des projets de vente ou de mise en location de biens immobiliers. Accompagner les propri taires, les futurs acqu reurs ou futurs locataires constitue une t che essentielle qui n cessite une connaissance fine du march , du droit de l immobilier et de ses volutions, etc. La relation client est au c ur de ce p le d activit s et n cessite anticipation, adaptabilit pour r pondre, avec d ontologie, aux besoins d une client le (propri taires, acqu reurs, locataires) toujours plus inform e. .
Le syndic assure donc en lien avec le conseil syndical la gestion administrative, financi re et technique d une copropri t Il met en uvre les d cisions vot es par l assembl e g n rale des copropri taires et repr sente le syndicat des copropri taires pour tous les actes civils et en justice. Ainsi, le syndic guide les copropri taires dans un environnement juridique et technique complexe. L exercice de ce m tier est fortement encadr par le droit. Il s effectue en mode projet et n cessite galement des capacit s de communication importantes ainsi que de la rigueur. Pr sentation d une copropri t (prise de connaissance de l immeuble) Introduction la copropri t Commercialisation du bien propos la vente ou la location Processus de d cision en copropri t Bloc 2 - ADMINISTRATION DES COPROPRI T S ET DE L HABITAT SOCIAL Gestion administrative et comptable de la copropri t Vie d une copropri t Gestion du personnel de la copropri t L habitat social est g r de fa on sp cifique et n cessite un suivi tout particulier dans le respect du cadre juridique qui lui est propre. Le logement social peut se trouver l origine de nombreuses copropri t s. Acc s au logement social Gestion des contentieux au sein de la copropri t
Les contextes de changement climatique et de transition nergtique simposent aujourdhui lensemble des activit s de vente, de location et de gestion de copropri t ; cela se traduit par un besoin accru de conseil pour les clients, mais aussi par la prise en compte d une volution importante et continue des obligations l gales. Ainsi, la mise en oeuvre de politiques publiques d adaptation du b ti aux enjeux du d veloppement durable et du changement climatique a un impact sur l exercice des activit s du titulaire du dipl me. Le conseil en gestion du b ti, que ce soit lors de la construction d un bien immobilier, de son entretien, de sa r novation, de son am lioration s impose pour toutes les activit s immobili res. CONSEIL EN GESTION DU B TI DANS LE CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE Participation des op rations de Vente en l tat Futur d Ach vement (VEFA) dans un contexte de changement climatique Prise en compte de la politique d am nagement du territoire dans le conseil au client Information du client sur les incidences du changement climatique sur le patrimoine immobilier Gestion des risques et des sinistres Accompagnement du client lors des op rations de travaux
Le stage Un stage plein temps de 12 semaines minimum et pouvant aller jusqu 14 semaines au sein d un ou plusieurs tablissements du secteur immobilier. Une possibilit de r aliser une partie du stage, savoir 8 semaines maximum, dans un pays de l Union Europ enne Possibilit de compl ter les 12 semaines minimum de stage par 2 semaines au plus d observation aupr s d une ou plusieurs organisation en lien avec des activit s connexes l immobilier. Le stage viendra en appui du bloc 4 Construction d une professionnalit immobili re
Lire le rfrentiel 1 2 3
Concevoir les squences 1 El ments pour concevoir un sc nario p dagogi- que El ments pour le question- nement, les missions 2 3
Construction dune professionnalit dans limmobilier (**) un horaire de co-animation de 2h en classe d doubl e est mis en uvre entre le professeur en charge de l enseignement de construction d une professionnalit dans l immobilier et un autre professeur de la section, prioritairement dans les enseignements professionnels (pouvant changer selon la nature du projet conduit). Explicitation Cela correspond 2 heures en co-intervention par groupe soit selon la composition de la division 1 re et 2 me ann e Division < 25 tudiants Pas de d doublement, donc 2 heures en co-intervention soit un co t de 4h Division 25 tudiants D doublement : 2 heures en co-intervention par groupe soit un co t de 8h
Un diplme compos de 6 units certificatives Enseignement g n ral Enseignement professionnel U1 Culture g n rale et expression U4 Conduite du projet immobilier du client en vente et/ou location Langue vivante trang re anglais U5 Administration des copropri t s et de l habitat social U2.1 -Compr hension de l crit et expression crite Construction d une professionnalit immobili re dans le contexte de changement climatique U2 U6 U2.2- Production orale en continu et en interaction U6.1- Conseil en gestion du b ti dans le contexte de changement climatique U3 Environnement juridique et conomique des activit s immobili res U6.2- - Construction d une professionnalit dans l immobilier
Maintenir lattribution de la carte professionnelle pour les 3 activits : transaction, gestion, syndic. Cadre juridique : l article 11 du d cret 72-678 Sont regard es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle pr vue l'article 1er les personnes qui produisent : 1 Soit un dipl me d livr par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau gal ou sup rieur trois ann es d' tudes sup rieures apr s le baccalaur at et sanctionnant des tudes juridiques, conomiques ou commerciales ; 2 Soit un dipl me ou un titre inscrit au r pertoire national des certifications professionnelles d'un niveau quivalent (niveau II) et sanctionnant des tudes de m me nature ; 3 Soit le brevet de technicien sup rieur professions immobili res ; 4 Soit un dipl me de l'institut d' tudes conomiques et juridiques appliqu es la construction et l'habitation. Les blocs 1 et 2, savoir Conduite du projet immobilier du client en vente et/ou location et l administration des copropri t s et de l habitat social constitue les deux blocs embl matiques de ce BTS, au sens o les comp tences travaill es sont celles valider pour pr tendre aux trois cartes professionnelles : cela justifie une certification crite ponctuelle.
Les modalits de certification Maintenir un niveau d exigence sur les comp tences essentielles dans les 3 types d activit pour tous les candidats afin de conserver la confiance du secteur professionnel dans cette formation : une valuation ponctuelle sur les deux blocs 1 et 2 s impose Le bloc 3, Conseil en gestion du b ti dans le contexte de changement climatique favorise une prise de recul et une entr e dans les politiques immobili res li es la transition cologique. Dans ce bloc, il s agit pour le candidat de pouvoir analyser une situation et proposer des r ponses pertinentes. Une valuation en CCF encadr e est bien adapt e. Le bloc 4, Construction d une professionnalit dans l immobilier est bas sur l tude de situations professionnelles et la conduite d une r flexion en vue de concevoir un projet professionnel : l aussi une valuation en CCF est bien adapt e. Le bloc 8, Environnement juridique et conomique des activit s immobili res est valu en CCF au fil de l eau afin de permettre une meilleure assimilation des diff rentes m thodologies. Les blocs 5, 6 et 7 sont valu s sous un format ponctuel dans le cadre d preuves communes.
Merci pour votre coute Si vous avez des questions