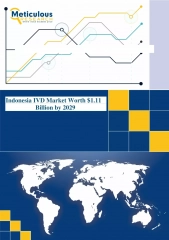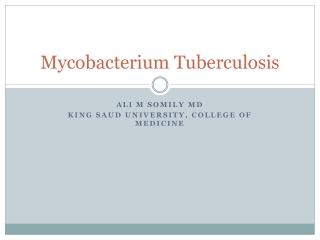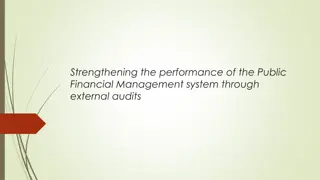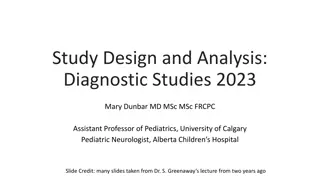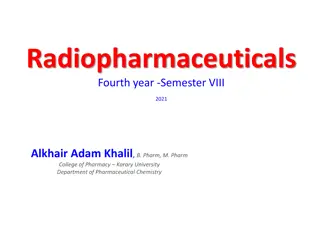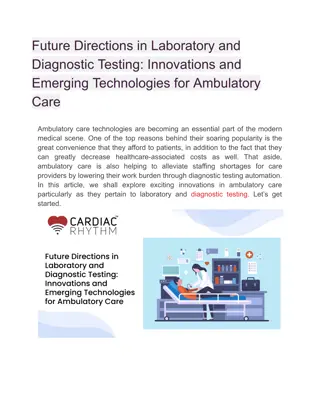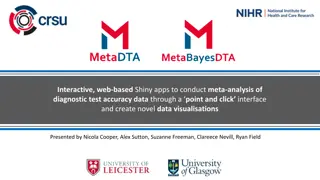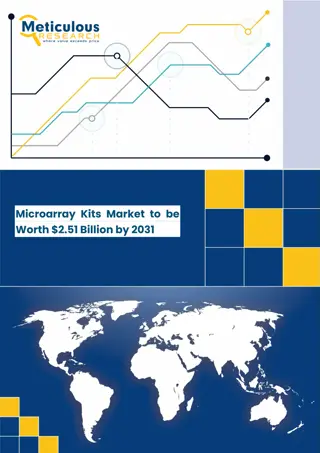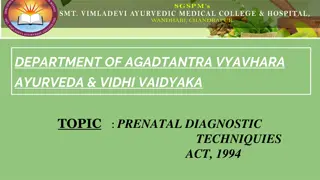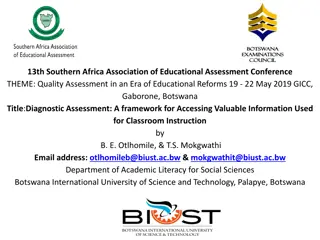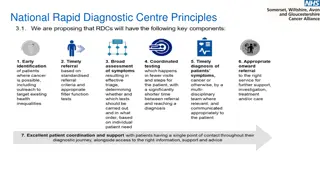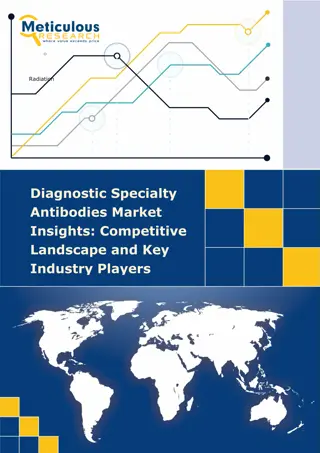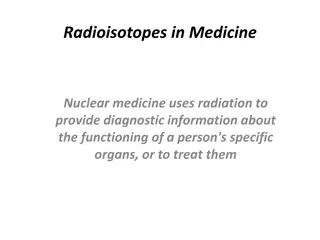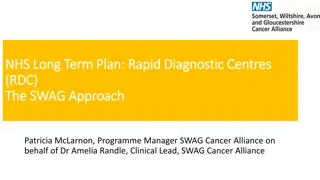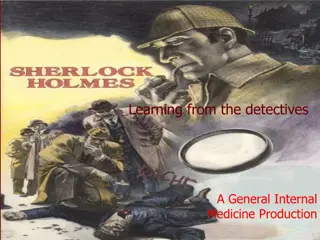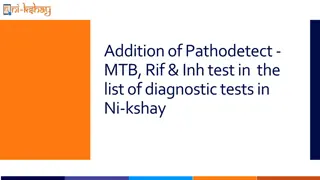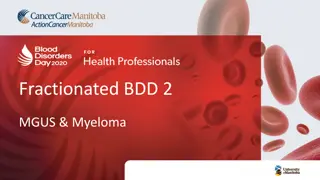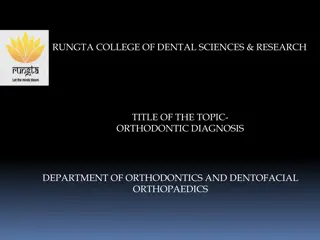Bacteriological Diagnostic Methods: Direct vs Indirect Approaches
Learn about bacteriological diagnostic methods used to confirm bacterial infections, including direct and indirect techniques. Direct methods involve identifying the bacteria through culture, while indirect methods rely on detecting specific antibodies in response to the infection.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DR BECHIR - 2020 2021
DIAGNOSTIC DUNE INFECTION Le diagnostic bact riologique est un ensemble de moyens permettant de confirmer telle ou telle tiologie infectieuse d'origine bact rienne. Le r le du laboratoire est de confirmer le diagnostic de l infection, d identifier les bact ries, de d terminer la sensibilit aux antibiotiques et de d tecter les r sistances.
2 MOYENS: Diagnostic direct : mise en culture, identification. Diagnostic indirect: mise en vidence de la r ponse de l'organisme l'infection par la pr sence d'anticorps sp cifiques.
I-DIAGNOSTIC DIRECT Le diagnostic direct est le seul diagnostic de certitude, car il permet la mise en vidence de la bact rie elle-m me, donc finalement sa culture ou isolement qui permettra l'identification ult rieure mais aussi de pr ciser sa sensibilit aux antibiotiques (antibiogramme).
I-DIAGNOSTIC DIRECT Examen cyto-bact riologique d'une urine (ECBU), d'une expectoration (ECBC), d'un liquide pleural... 1 - Demande 2 - Examen macroscopique 3 - Examen microscopique
4-Culture. 5-Identification. ANTIBIGRAMME.
1 - Demande Il existe une proc dure standard de recherche de cellules et de bact ries Ceci exclut toute recherche non syst matique de germes particuliers qui necessite une demande sp cifique (Bacilles Acido-Alcoolo-R sistants)
2 - Examen macroscopique Toute infection bact rienne s'accompagne de signes biologiques comme l ventuelle pr sence de leucocytes. Une modification visuelle signe une anomalie
2 - Examen macroscopique H maturiques: Odeur Consistance
3- Examen microscopique n cessit de rechercher des bact ries et des l ments cellulaires de type polynucl aire ou lymphocyte( tuberculose) au microscope optique.
3 1- Etat frais Pr sence de bact ries Num ration
3 - 1 Etat frais Une pr paration est obtenue avec le d p t d'une goutte entre lame et lamelle, puis on observe au microscope d'une part, la pr sence ventuelle de bact ries (coque, diplocoque, chainette, coccobacille, bacille...), le type de mobilit .
3 - 1 Etat frais Par ailleurs, lors de cette observation, seront valu es les cellules avec une appr ciation semi-quantitative (rares, peu nombreux, nombreux, tr s nombreux...) ou mieux quantitative, exprim e par nombre d' l ments / mm3ou ml ou par champ. Exemple d'une cellule de Malassez pour LCR, liquides de ponction, urines
3.2. Examen aprs coloration Un frottis fin est obtenu partir du produit pathologique, puis color permettant une meilleure visualisation des bact ries et/ou des l ments cellulaires Coloration simple: Le frottis fin est trait par un seul colorant basique (bleu de m thyl ne)
3.2. Examen aprs coloration pus ur tral pour la recherche de gonocoque: diplocoques en grain de caf intracellulaires.
3.2. Examen aprs coloration Coloration diff rentielle : Compte tenu des diff rences structurales (cf anatomie) de la paroi des bact ries, la coloration de Gram d couverte par Hans GRAM en 1884 permet de distinguer les bact ries color es en violet (G+) de celles en rose (G-).
3 - 3 Examen aprs coloration spciale (Ziehl-Neelsen) 3.2. Examen apr s coloration
Microscopie au fond noir (condenseur spcial) : Il s'agit de rechercher des bact ries sur lequelles la lumi re s'est r fl chie. Cette recherche est inhabituelle,
Microscopie lectronique : rarement utilise en pratique, plus souvent dans le cadre de l'identification d'une nouvelle tiologie bact rienne (Bartonella, Helicobacter...).
4 - Premires conclusions: Les l ments r colt s de l'examen macroscopique et surtout microscopique fournissent souvent des arguments diagnostiques de tr s forte pr somption qui vont permettre la mise en route d'une th rapeutique adapt e. La culture ou l'isolement de l'agent causal sera, cependant, essentielle. Elle permettra l'identification ult rieure mais aussi de pr ciser sa sensibilit aux antibiotiques (Antibiogramme).
5-Culture et isolement L'examen cyto-bact riologique d'un produit pathologique d bute par l'examen macroscopique, puis l'examen microscopique . Apr s ensemencer le produit pathologique pour un ventuel isolement d'un ou plusieurs germes.
Divers milieux sont utiliss qui doivent satisfaire les besoins nutritifs et nerg tiques des bact ries cultiver , En pratique, sont utilis s plusieurs milieux solides (g los s) avec une technique particuli re d'ensemencement (isolement orthogonal ou en cadran) permettant l'isolement de clones bact riens sous la forme de colonies (de l'ordre de 106bact ries).
Dlai d'incubation : De trs nombreuses espces bactriennes cultivent apr s 18 24 H d'incubation 37 C. Cependant d'autres esp ces ont des d lais d'incubation plus longs telles Mycobacterium tuberculosis (temps moyen d'isolement de l'ordre de 21 jours)
5-Identification Antibiogramme A l'aide de tests d'orientation rapide : oxydase, catalase, coagulase... Par ensemencement d'une galerie biochimique adapt e : Identification de Escherichia coli et Proteus mirabilis par un ensemble de r actions du m tabolisme interm diaire avec la galerie commerciale Exemple API20E (Physiologie-Croissance)
Exemple d'un antibiogramme (mthode de diffusion ou des disques) d'une souche de Escherichia coli productrice d'une p nicillinase (cours sur les Antibiotiques).
A l'heure actuelle, existent des automates qui effectuent dans un d lai de quelques heures, l'identification et l'antibiogramme
Mthodes molculaires l existe depuis quelques ann es, des m thodes pour identifier une bact rie dans un produit pathologique ou d'une culture. Le principe en est simple puisqu'il consiste amplifier un g ne entier ou non avec des amorces sp cifiques qui peut tre ult rieurement r v l , ou par hybridation ou encore s quenc et compar avec ceux d pos s dans des banques (EMBL, NCBI par exemple) SPECIFITE,RAPIDITE,SENSIBILITE
DIAGNOSTIC INDIRECT OU SROLOGIQUE l se base sur les cons quences induites chez l'h te (r action immunologique), savoir la production d'anticorps . La r action immunitaire ne se d veloppe qu' partir d'un d lai, de l'ordre de 8 10 jours
Raction d'agglutination en tubes (s rodiagnostic de Widal-Felix, Wright....) avec des dilutions du s rum (Wright du 1/10 au 1/1280e)
Recherche d'anticorps par une technique de rvlation utilisant les globules rouges
Immunofluorescence directe Immunofluorescence indirecte
La mthode immuno- enzymatique E LISA
Quelques exemples de srodiagnostic: Brucellose : agglutination (Wright), Antig ne tamponn ou Rose bengale, Fixation du compl ment, Coombs, IFI, ELISA Chlamydioses : IFI, Fixation du compl ment Legionellose : IFI, ELISA Lyme (maladie) : IFI, ELISA, Western-blot Mycoplasmes : Fixation du compl ment, ELISA Salmonelloses : anti-typhoparathypho diques (Widal-F lix) Infections profondes Staphylocoques : anti-staphylolysines alpha
Infections Streptocoques du groupe A : anti-streptolysines, anti-strepdornases, anti-streptokinases Syphilis : TPHA, FTA, TPI, ELISA
MERCI POUR VOTRE ATTENTION