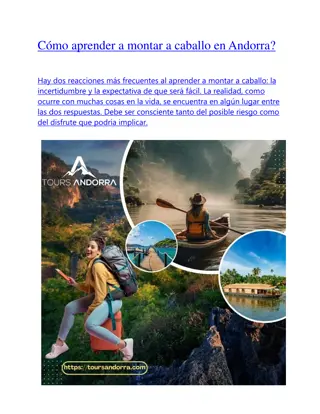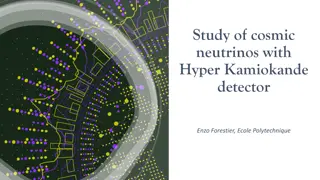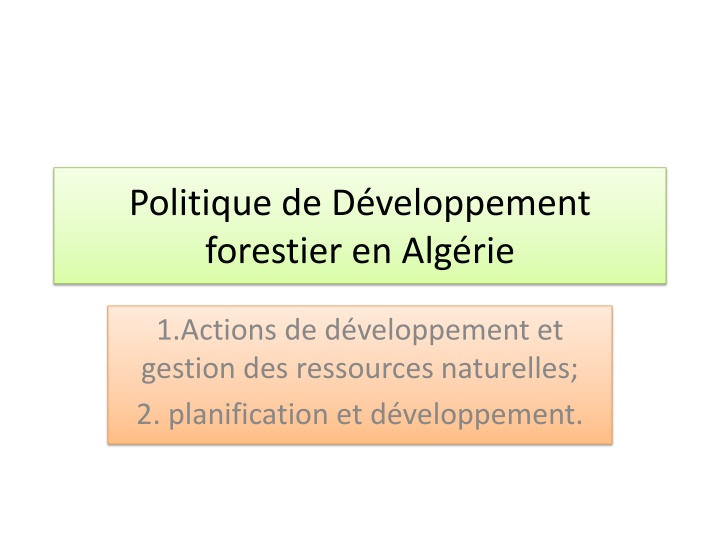
Development and Management of Forest Resources in Algeria
Explore the development and management actions in Algeria focusing on natural resource conservation, sustainable practices, and addressing climate change through reforestation, protection of habitats, and promotion of ecosystem services. Learn about the institutional setup for forest administration and the commitment to safeguarding the national forest heritage according to Algerian constitution.
Uploaded on | 0 Views
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Politique de Dveloppement forestier en Alg rie 1.Actions de d veloppement et gestion des ressources naturelles; 2. planification et d veloppement.
INTRODUCTION D veloppement durable: climat + biodiversit + nergie +H2O + sant + production +consommation les for ts et les cosyst mes naturels: sont au c ur des priorit s port es par les d cideurs de ce monde, conservation et gestion durable constituent une priorit mondialement prise en charge travers les conventions et accords internationaux ratifi s par l Alg rie (UNCCD, CBD, UNCC, Ramsar, AEWA, ).
INTRODUCTION Compte tenu de l importance du patrimoine forestier, la constitution Alg rienne stipule dans ses articles 18, et 19, que: la for t est un bien de la collectivit nationale et de ce fait, elle rel ve de la propri t publique L'Etat garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur pr servation au profit des g n rations futures .
INTRODUCTION Actions de d veloppement engag es: tendant att nuer l impact sur les ressources naturelles et, faire face aux changements climatiques par : 1. Reconstitution et Protection du patrimoine forestier ; 2. Am nagement, Protection et Valorisation des espaces montagneux, steppiques, pr sahariens et oasiens ; 3. Conservation et Valorisation de la faune et de la flore ainsi que leurs habitats naturels ; 4. d veloppement et promotion des biens et services fournis par les cosyst mes forestiers et autres espaces bois s.
Organisation de ladministration des for ts et tat du patrimoine forestier Organisation et fonctionnement de l administration La Direction G n rale des For ts, cr en juillet 1995 par d cret ex cutif n 95-200 du 25 juillet 1995. Dot e des attributs de puissance publique (qualit d officier et d agent de police judiciaire, arme de service, uniformes et signes distinctifs ) autonomie de gestion par d l gation de la tutelle.
Organisation de ladministration des for ts et tat du patrimoine forestier Organisation et fonctionnement de l administration L administration des for ts comprend: la direction g n rale et des services d concentr s, les conservations des for ts de wilaya. L organisation territoriale de la direction g n rale des for ts repose sur : 48 conservations des for ts de wilaya ; 210 circonscriptions des for ts ; 584 districts forestiers et 1.369 triages forestiers.
Organisation de ladministration des for ts et tat du patrimoine forestier Organisation et fonctionnement de l administration Elle a sous sa gestion technique: 8 parcs nationaux, 4 r serves de chasse 3 centres cyn g tiques sous sa gestion p dagogique: 2 instituts de formation 1 cole nationale.
Etat des lieux du patrimoine naturel R trospective Durant le si cle dernier, la for t alg rienne a fait l'objet de diverses agressions humaines qui ont r duit consid rablement sa superficie et provoqu la r gression ou la disparition de nombreuses esp ces animales et v g tales.
Etat des lieux du patrimoine naturel R trospective La d forestation s est acc l r e vers 1830, sur l instigation d une colonisation qui allait inaugurer l re des grands d frichements!!!!!, pr sent s comme une uvre civilisatrice ????, r duisant ainsi la couverture foresti re moins de 5 millions d hectares, (Boudy : Consid ration sur la for t alg rienne et la for t Tunisienne document publi le 08 Octobre 1952).
Etat des lieux du patrimoine naturel R trospective A l ind pendance, l Alg rie a mis en place un programme de restauration et d extension du patrimoine forestier, qui ne comptait plus que 3 millions d'hectares!!!!!!!.
Plusieurs programmes de plantations et de lutte contre lrosion et la d sertification ont t initi s d s l ind pendance 1. les chantiers populaires de reboisement (CPR) durant les ann es 60 (apr s l ind pendance) ; 2. le lancement du barrage vert durant les ann es 70; 3. l laboration des premiers plans d am nagement au d but des ann es 70 avec la cr ation du bureau national d tudes foresti res, ayant permis l laboration d tude sur 1 300 000 ha de for t entre 1980 et les ann es 90. 4. Sur cette base, un tissu industriel important de transformation de bois et de li ge a t mis en place.
Plusieurs programmes de plantations et de lutte contre lrosion et la d sertification ont t initi s d s l ind pendance 4. le lancement des grands travaux forestiers durant les ann es 90 ; 5. le plan national de reboisement (PNR) partir de 2000 qui vise la r alisation de 1.245.000 ha l horizon 2020 ; 6. les programmes de lutte contre la d sertification, de traitement des bassins versants et de gestion du patrimoine forestier au titre du d veloppement rural 2009-2014 ;
Rsultats 1990 2000: d cennie noire A acc l r le processus de d gradation et de destruction de la for t: perturbation des r alisations des plans d am nagement tablis. Des efforts consid rables et des moyens financiers importants ont t fournis pour l accomplissement et la r alisation des diff rents programmes. N anmoins, les approches sectorielles mal int gr es leur environnement naturel n ont pas permis l aboutissement aux r sultats escompt s.
Situation actuelle L Alg rie couvre une superficie de 2,388 millions de km2 ce qui en fait, en tendue, le premier pays africain, mais avec une superficie foresti re (4,1 millions d hectares) des plus faibles d Afrique. Le Sahara l un des plus vastes d serts du monde en occupe plus de 2 millions de km2 soit 84% du territoire national.
Situation actuelle Etat du patrimoine naturel Les for ts et les maquis : l inventaire forestier national (IFN 2008), fait ressortir : terres foresti res (for ts, maquis et reboisements) : 4 115 908 Ha, soit 16,7% de l Alg rie du Nord ; terres alfati res : 1 974 018 Ha soit 8% ; terres improductives constitu es de terrains rocheux, chott, urbain, etc. :4%.
Situation actuelle La r partition des 4 115 908 Ha de terres foresti res par types de formations fait appara tre : Pr dominance des maquis et maquis arbor s qui couvrent 2 413 090 Ha (soit 58,7% du total des formations foresti res). Ces chiffres t moignent de l tat de d gradation des for ts r duites sur 58,7% de leur superficie en maquis et maquis arbor s qui sont en grande partie faible densit . Besoins importants en reconstitution des for ts par reboisement des maquis et des maquis arbor s dans des buts de renforcement de leur r le de protection et de production.
SITUATION ACTUELLE Les for ts proprement dites (for ts et reboisements) couvrent 1 702 818 Ha (soit 42% du total des formations foresti res). La r partition de la strate arbor e par types de peuplements fait ressortir la pr dominance des peuplements d ge moyen (perchis et jeunes futaies) qui repr sentent 43% et en second lieu celle des peuplements g s (vieilles futaies) qui repr sentent 36%.
SITUATION ACTUELLE La for t alg rienne est constitu e de diff rentes essences dont : Pin d Alep Ch ne li ge Ch ne z en C dre Eucalyptus Pin maritime Divers 1 158 533 Ha 68% 349 218 Ha 21% 43 922 Ha 32 909 Ha 2% 29 355 Ha 2% 28 490 Ha 68 391 Ha 3% 1% 4%
SITUATION ACTUELLE Les for ts de C dre, de Ch ne li ge et de Ch ne z en, sont constitu es en majorit de vieux peuplements : C dre = 76,7%; Ch ne li ge = 70% Ch ne z en = 79%.
SITUATION ACTUELLE Les for ts de Pin d Alep ont une structure assez quilibr e : Jeunes peuplements = 18,6% ; Perchis = 23% ; Jeunes futaies = 28%. Vieille futaie = 25,4%.
SITUATION ACTUELLE Les for ts de Pin maritime sont majorit de jeunes peuplements (semis, fourr , gaulis = 65,4%) et de peuplements d ge moyen (perchis et jeune futaie = 23,7%). Les for ts et la nappe alfa sont en tat de stress continuel d la s cheresse et sont soumises en permanence aux pressions multiples qu exercent l homme et son b tail.
SITUATION ACTUELLE la pauvret et le ch mage conduisent les habitants commettre des d lits forestiers pour pouvoir subvenir leurs besoins primaires: coupe et vente illicites de bois, fabrication de charbon pour les r tisseries partir du ch ne vert, d frichements pour l extension des parcelles de c r ales, surp turage ,
SITUATION ACTUELLE la pr sence des carri res d extraction de pierres et des stations de concassage l int rieur des massifs, les constructions illicites, sont autant de facteurs aggravants, de la situation de nos for ts
Situation actuelle Les nappes alfa : Les donn es de 2008 montrent qu une r gression de 99% de la production Alfati re a t enregistr e sur une p riode d environ 45 ans (1963-2007) soit une production de: 91 645 t/an en 1963 956 t/an en 2007!!!!!!!!!!.
situation actuelle Les nappes d alfa: Aujourd hui, l exploitation de l alfa ne d passe gu re 400 t/an. Les causes essentielles: D saffection des op rateurs charg s de la r colte; Rar faction de la main d oeuvre due la p nibilit du travail d arrachage et son caract re saisonnier. Les cycles de s cheresses successifs
Situation actuelle La biodiversit floristique : l Alg rie compte 3139 esp ces, dont 1611 sont consid r es comme rare rarissime: 289 esp ces assez rares, 647 esp ces rares, 640 esp ces tr s rares; 35 esp ces rarissimes, ce qui totalise pr s de 51 % de la flore alg rienne menac e de disparition.
Situation actuelle La biodiversit floristique : Cet tat des lieux est li la d gradation des habitats naturels, suite au: d veloppement de multiples infrastructures, l urbanisation croissante, les incendies r currents, les d frichements et labours des cosyst mes fragiles, l rosion des sols, la s cheresse prolong e, et l exploitation anarchique
Situation actuelle La biodiversit faunistique : L Alg rie est caract ris , par la diversit de son climat et de ses cosyst mes renfermant ainsi d normes potentialit s de faune sauvage, notamment end miques la r gion africaine, ainsi qu un fort potentiel cyn g tique, dont des esp ces de gibier m diterran ennes et de nombreuses autres esp ces africaines. La Conservation de la nature et de ses ressources, faunistiques, pr occupation majeure des pouvoirs publics.
Situation actuelle La biodiversit faunistique : N cessit urgente et op ration accomplir travers strat gies de conservation bas es sur des plans de gestion r pondant l ensemble des pr occupations. Ressources cyn g tiques peu connues : n cessit absolue de mettre en place des plans de formation et une actualisation des donn es existantes!!!
Situation actuelle La biodiversit faunistique : L Alg rie, poss de un potentiel en faune sauvage, source de gibier pour le d veloppement durable de l activit chasse et banque de g nes non encore modifi s par l homme, donc une banque zoo g n tique pure. Notre pays abrite : 483 esp ces animales recens es dont : 23 esp ces class es menac es de disparition en vertu de la loi n 06-14 du 14 novembre 2006 relative la protection et la pr servation de certaines esp ces animales menac es de disparition, savoir : 13 mammif res ; 07 oiseaux ; 03 reptiles.
Situation actuelle La biodiversit faunistique 229 esp ces prot g es en vertu de d cret ex cutif n 12-235 du 24 mai 2012 fixant la liste des esp ces animales non domestiques prot g es, conform ment la loi n 03-10 du 19 juillet 2003 relative la protection de l environnement dans le cadre du d veloppement durable, savoir : 53 esp ces de mammif res ; 124 esp ces d oiseaux ; 46 esp ces de reptiles ; 06 esp ces d amphibiens.
Situation actuelle Les parcs nationaux : Les pressions exerc es sur les ressources naturelles ont amen , l administration des for ts a cr ce jour 8 parcs nationaux pour pr server des cosyst mes pr sentant un int r t particulier en termes de biodiversit , de richesse paysag re et culturelle. Cependant, ces aires prot g es occupent une tr s faible superficie qui est de 165 361 ha, soit 0.007 % du territoire national
Situation actuelle Les parcs nationaux : On note une r partition inad quate des parcs nationaux sur l ensemble du territoire, qui sont concentr s au nord du pays, excluant de ce fait, les autres cosyst mes remarquables comme les zones steppiques et sahariennes. Sept d entre eux ont t class s par l UNESCO R serves de Biosph re , il s agit : d El Kala, Taza, Gouraya, Chr a, Belezma, Djurdjura Tlemcen
Situation actuelle Les zones humides : Identification de 16 complexes et 103 sous complexes, s tendant sur une superficie de 98 694 655 ha et comportant 2.375 zones humides apparentes (2.056 zones humides naturelles et 319 artificielles) dont un effort consid rable a t consenti pour le classement de 50 zones humides sur la liste Ramsar d importance internationale. L augmentation des besoins, due la concentration de la population proximit des zones humides, a entra n la surexploitation de ces espaces conduisant, dans certains cas, une rupture de l quilibre biologique qui menace leur p rennit
Situation actuelle Zones humides: l industrialisation, les rejets des eaux us es ont contribu de multiples fa ons la d gradation des zones humides. Pour palier ces menaces des projets permettant la conservation des zones humides ont t mis en place par la DGF : Le Projet sentinelles des zones humides; Le projet Globwetland II.
Situation actuelle Projet sentinelles des zones humides : L'objectif du projet : promouvoir la conservation et l'utilisation rationnelle de zones humides prioritaires s lectionn es en Alg rie, au Maroc et en Tunisie par la cr ation et la formation d'une communaut active et efficiente de la soci t civile au niveau de la r gion : "le R seau MedWet de la soci t civile " travers lequel sera valu et analys , l' tat et les tendances des zones humides prioritaires s lectionn s et tablir un m canisme de communication des r sultats.
Situation actuelle Le projet Globwetland II : Le projet GlobWetland II, est une initiative mise en oeuvre et financ e par l Agence Spatiale Europ enne (ESA), avec la participation de la convention de Ramsar et l Observatoire des Zones Humides M diterran ennes (OZHM). Le but principal du projet est de contribuer l tablissement d un syst me d observation mondial des zones humides (G-WOS) des pays sud et Est du bassin m diterran en, afin d accroitre l accessibilit aux donn es et aux informations sur ces milieux.
Situation actuelle Le projet Globwetland II: A permis la r alisation de produits cartographiques et d indicateurs sur une s lection de 37 zones humides pour l Alg rie, avec des formations sur l utilisation de l application GW II, dispens es aux cadres gestionnaires de ces sites, ces produits permettront de : 1. g rer les zones humides en b n ficiant de cartes d taill es diff rentes p riodes; 2. faciliter l int gration de la t l d tection dans les activit s de conservation et gestion des zones humides; 3. avoir des donn es sur les indicateurs d efficacit de la convention de Ramsar.
Situation actuelle Un R seau National d Observateurs Ornithologues Alg riens (RNOOA) d envergure nationale a t cr par arr t minist riel, il regroupe: des cadres de l administration des for ts, des chercheurs, des universitaires, des membres d associations de protection de la nature ainsi que des b n voles, Qui s engagent contribuer au bon d roulement de ses activit s.
Situation actuelle Il a pour missions: le recensement des esp ces ornithologiques et leur volution ; l identification des facteurs pouvant porter atteinte aux esp ces et leurs sites ; la vulgarisation, la formation, et l ducation environnementale.
Situation actuelle Les zones de montagne : Les enjeux li s aux probl mes d rosion sont per us, tant au niveau de la d gradation du capital sol,, qu au niveau de la mobilisation de la ressource eau,. Pour la ressource en eau: notre pays consacre un effort consid rable dans la construction de barrages pour mobiliser la ressource en eau pour l alimentation en eau potable et pour irriguer les terres agricoles . Ces barrages, au nombre de 75 actuellement d une capacit de stockage de 7,4 milliards de m3, subissent une perte consid rable de leur capacit en raison de leur envasement d l rosion hydrique de leur bassin versant en amont.
Situation actuelle Cette perte, selon les estimations de l ANBT est de 934 millions de m3 soitl quivalence de la capacit du plus grand barrage d Alg rie savoir B ni Haroun dont le co t global est de 20 milliards de dinars permettant l alimentation en eau potable d une population de plus de 5 millions d habitants en raison de 250l/j sur une ann e et l irrigation d une superficie agricole de 40.000 hectares/an
Situation actuelle La r cup ration de la capacit perdue des retenues par des techniques de dragage ou de chasse des s diments, repr sente une solution parfois indispensable!! Mais le v ritable probl me est: l absence de couverture v g tale p rennes +l application des bonnes pratiques agricoles conservatrices des eaux et des sols
Situation actuelle Quant aux ressources en terres, l rosion hydrique menace aujourd hui 12 millions d ha principalement au niveau des zones montagneuses!!! Provoque la perte de fertilit des terres agricoles et une r duction de la S.A.U sachant que cette derni re ne repr sente actuellement que 0,24 ha/habitant alors qu en 1962 elle tait de 1ha/habitant.
Situation actuelle Diff rentes strat gies se sont succ d es depuis les ann es 30 pour contrer l rosion hydrique: les travaux de DRS (d fense et restauration des terres) de 1940 1978, la mise en valeur des terres par des offices d am nagement et de mise en valeur des terres (OAMV) de 1980 1984, les programmes de traitement des bassins versants sur la base des tudes r alis es par le secteur des for ts de 1984 2000, l laboration d un plan national de reboisement o 250 000 ha sur les 1,2 millions taient destin s la protection des bassins versants l inscription d un programme d am nagement de basins versant 2010 2014par le secteur des for ts sur la base des r sultats des 58 tudes initi es, depuis 2003, par l ANBT
Situation actuelle Ce programme qui est en phase de finalisation concerne en particulier, 66 bassins versants en amont de retenues d eau dont 45 disposants d tudes r alis es par l ANBT. Ce programme r partie, travers 30 wilayas et 745 communes, a permis la r alisation d action de lutte contre l rosion hydrique et d autres actions destin es la population rurales savoir : plus de 1 million de m3 de correction torrentielle, de cordon de pierre et de murettes, 66 km de fixation de berges et 1 100 ha de banquettes ; 30 000 ha de plantations foresti res, 52 000 ha de plantations fruiti res et 4 000 ha de plantations pastorales et fourrag res ; 22 000 ha d am lioration fonci re et 91 000 sujets d ol astre greff s; 6 000 km d ouverture et d am nagement de piste, 1 800 u de points d eau (bassin, sources, puits et forage) ; 80 000 ml (seguia, canaux d amen e d eau).
Situation actuelle Malgr les efforts d ploy s, le probl me reste pos pour les raisons suivantes : l importance des superficies traiter qui sont estim es pour les 58 bassins versants tudi s 1,7 millions d ha dont 816 000 ha traiter en priorit . le budget allou pour le secteur des for ts est relativement faible et ne permet pas d assurer convenablement une prise en charge de la probl matique de l rosion hydrique et celui du d veloppement rural;
Situation actuelle l absence d implication des secteurs concern s (eau, travaux publics, environnement) hormis le secteur des for ts, ce qui constitue un frein la conception et au d veloppement d actions coh rentes ; le manque d appui technique des instituts et institutions concern s par le probl me d rosion et de gestion des eaux et des sols. la non application du cadre l gislatif, notamment la loi foresti re de 1984 et celle de l eau de 2005 relatives la lutte contre l rosion hydrique en particulier la d limitation des p rim tres de lutte contre l rosion hydrique. le manque de cr ation d emploi extra agricole permettant de limiter la pression sur les ressources naturelles ainsi que la valorisation des produits agricoles et forestiers forte valeur ajout e
Situation actuelle Les terres arides sont confront es de nombreux d fis li s : la d sertification, la pression d mographique, au changement climatique et la surexploitation ainsi qu la mauvaise gestion des ressources. Les changements d utilisation des terres et d autres pratiques telles que la transformation des parcours et autres syst mes sylvopastoraux en terres de culture, le gaspillage et la consommation non durable de l eau, les pratiques de culture et de p turage inad quates, et la r colte excessive de bois de feu entra nent une d gradation des terres, une raret de l eau et des pertes majeures de services environnementaux. Gestion durable des terres steppiques, pr sahariennes et sahariennes
Situation actuelle Au d but des ann es 70 un vaste projet de lutte contre la d sertification le Barrage Vert qui a permet des actions tr s importantes notamment: le reboisement des bandes de terres semi-arides, la r alisation d une carte de sensibilit , la ratification de la Convention de lutte contre la d sertification, la mise en place d un organe de coordination et d un Plan d action national, et la mise en uvre d un Plan national de lutte contre la d sertification.