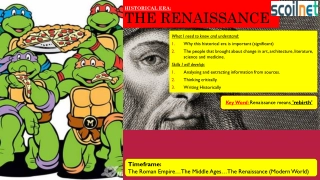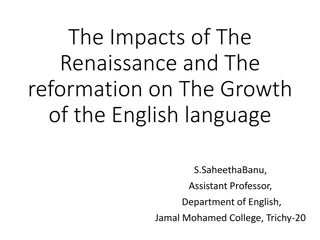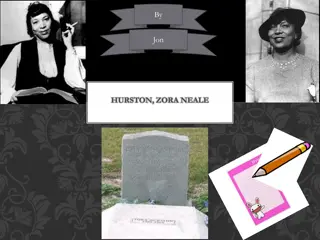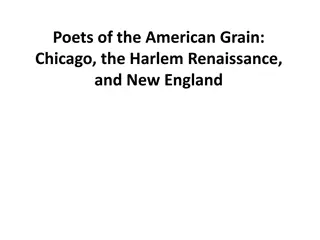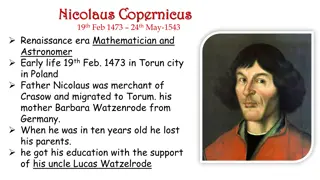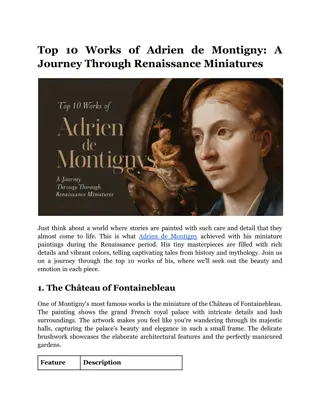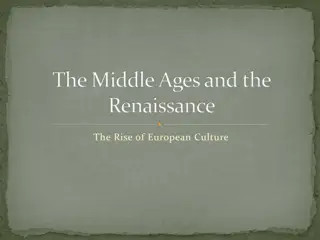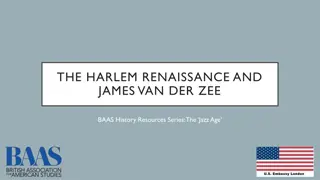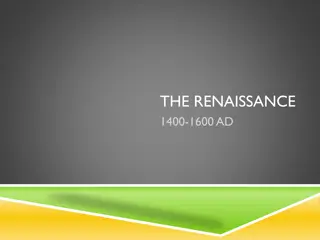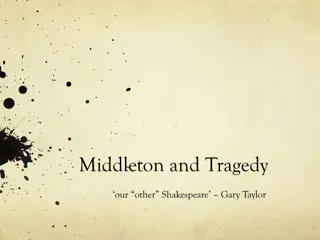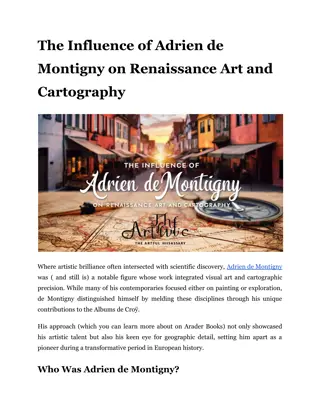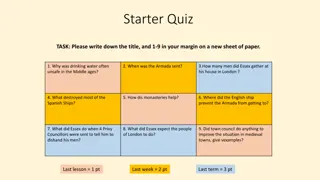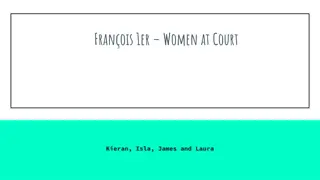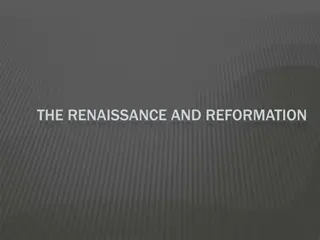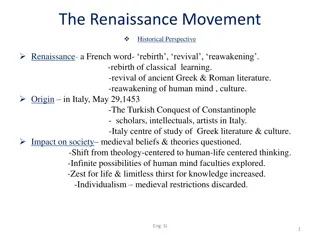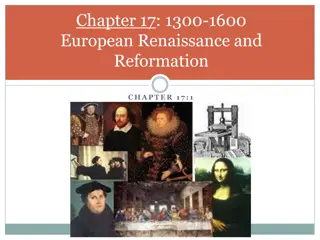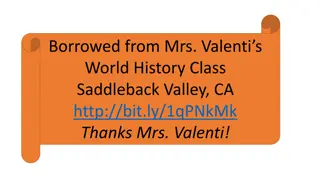Italian Renaissance Influence on French Language and Culture
Explore the impact of the Italian Renaissance on French society, language, and culture. Discover the fascination with Italy, the adoption of Italian artistic styles, and the introduction of Italian terms across various domains during this prosperous period. Delve into the legacy of prominent figures like Leonardo da Vinci, Michelangelo, and more, and how their influence shaped French aristocracy and bourgeoisie.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
La Renaissance La Renaissance L'affirmation du fran ais L'affirmation du fran ais
La prpondrance de La pr pond rance de La fascination italienne l'Italie l'Italie
la fascination pour l'Italie, et l'intrt pour les textes de l'Antiquit, les nouvelles inventions, la d couverte de l'Am rique, etc. une re de prosp rit pour l'aristocratie et la bourgeoisie L onard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Rapha l, etc. les mariages diplomatiques : Catherine de M dicis (1519-1589) avec Henri II (1519-1959) La cour de France se raffina en s'italianisant
Les italianismes Les italianismes termes relatifs la guerre (canon, alarme, escalade, cartouche, etc.), la finance (banqueroute, cr dit, trafic, etc.), aux moeurs (courtisan, disgr ce, caresse, escapade, etc.), la peinture (coloris, profil, miniature, etc.) et l'architecture (belv d re, appartement, balcon, chapiteau, etc.). tous les domaines ont t touch s: l'architecture, la peinture, la musique, la danse, les armes, la marine, la vie de cour, les institutions administratives, le syst me p nitencier, l'industrie financi re (banques), le commerce, l'artisanat (poterie, pierres pr cieuses), les v tements et les objets de toilette, le divertissement, la chasse et la fauconnerie, les sports questres, les sciences, etc. 8000 mots l' poque, 10 % utilis s encore aujourd'hui
alarme banquet brigade estamper perruque guirlande escrime escalade saccager plage banque cavalier partisan rotonde calibre plastron lustre banqueroute caresser citadelle embusquer escadron estrade esplanade estropier m daille tribune infanterie escorte r volter banderole violon radis poltron lagune masque panache b mol mosa que balustre mousquet ballet fleuret incognito cartouche gamelle stylet ombrelle figurine piastre estafette interm de fugue pommade balcon grotte colonel piston casemate pi destal pilastre sentinelle parapet d sastre arabesque camisole parasol bagatelle buste ballon gondole cavale caporal sorbet vermicelle mascarade s r nade mascarade appartement brocoli concert cabriole cale on stalle carrosse carton fantassin polichinelle miniature fresque store burlesque corridor basson berlingot cort ge bombe fortin trombe op ra coupole socle costume carafon violoncelle gouache piano mandoline buffle riz tournesol porcelaine citrouille perle florin galerie trafic canon cavalcade brigand baldaquin barrette lavande police arsenal
Les guerres de religion (1562 Les guerres de religion (1562- -1598) et le Nouveau Monde Nouveau Monde 1598) et le contrecoup de la r forme d'Henri VIII en Angleterre (protestantisme), de Luther en Allemagne et de Calvin en Suisse le principe du crois ou meurs Catholiques (papistes) et protestants (huguenots) Les cons quences de la R forme le d clin du latin l'usage des langues vulgaires (vernaculaires)
Erasme Erasme (1469-1536) Opera Omnia (1523), il consid rait normal de lire l' vangile dans sa langue (maternelle) plut t que de r p ter comme un perroquet des paroles incompr hensibles
Pourquoi parat-il inconvenant que quelqu'un prononce l'vangile dans cette langue o il est n et qu'il comprend: le Fran ais en fran ais, le Breton en breton, le Germain en germanique, l'Indien en indien? Ce qui me para t bien plus inconvenant, ou mieux, ridicule, c'est que des gens sans instruction et des femmes, ainsi que des perroquets, marmottent leurs psaumes et leur oraison dominicale en latin, alors qu'ils ne comprennent plus ce qu'ils prononcent. [Traduit du latin]
Martin Luther : la traduction en allemand de la Bible, en 1522 une immense r percussion pour la langue allemande popularisation et fixation de l'allemand crit En 1559, Jean Calvin (1509-1564), r fugi Gen ve fonde le calvinisme Diffuse sa doctrine en fran ais en Suisse romande + en France Son livre, l'Institution chr tienne, contient l'essentiel de ses id es sur la loi, la foi, la pr dication, les sacrements et les rapports entre les chr tiens et l'autorit civile Fixe l' criture du fran ais alors en pleine volution le fran ais continuera d' tre mal per u en France par l' glise catholique durant tout le XVIe si cle le latin continuait d' tre la langue de l' glise catholique X le fran ais --- l' glise protestante en France et en Suisse romande Les imprimeries de Gen ve et d'Amsterdam : des centres importants de diffusion du fran ais en Europe et en France. Les campagnes militaires dans le royaume de France --- un certain nombre de mots anglais et espagnols des termes de guerre et de produits exotiques dus la d couverte de l'Am rique et de l'Asie par les Anglais et les Espagnols, voire les Portugais
La dcouverte du Nouveau Monde La d couverte du Nouveau Monde Le fran ais a emprunt de l'Espagne (et du Nouveau Monde) cca 300 mots du Portugal, une cinquantaine de mots partir de la Renaissance jusqu'au XVIIesi cle + les termes d'origine arabe avec la d couverte de l'Am rique par l'Espagne et le Portugal --- un nombre important de termes exotiques
canari coutille chocolat casque condor tabac romance bizarre camarade fanfaron (arabe) lama parer toucan alc ve (arabe) p pite caracoler tor ador cortes m lasse satin (arabe) moresque toque n gre savane cannibale hamac intransigeant marron quadrille caramel estampille matamore passacaille sieste adjudant pacotille flottille embarcad re cigare tomate aubergine cacahu te bol ro mayonnaise matamore mirador pampa gitane tornade ouragan ma s embarcation cacao ananas mandarine avocat coyote canyon lasso tango rumba estudiantin safran moustique canot mul tre jonquille embargo pirogue hidalgo alezan parade bandouli re anchois goyave indigo palabre abricot pastille castagnette vanille c dille cr ole
Le Canada Fran ois 1er nomma Jacques Cartier : premi re exp dition fr. en 1534 il donna la France des droits sur le territoire Au plan linguistique : la toponymie de l'est du Canada : les noms de lieu sont depuis cette poque ou fran ais ou am rindiens Cartier a le m rite d' tablir les bases de la cartographie canadienne + le grand axe fluvial le Saint-Laurent
Le franais comme langue officielle Le fran ais comme langue officielle ? ? la fin du XVesi cle : des conflits militaires, pourtant l'expansion du fran ais une arm e permanente et favorisation du fran ais aupr s des soldats patoisants 20 millions d'habitants, la France = le pays le plus peupl d'Europe les imp ts = le roi de France plus riche que ses rivaux --- promouvoir sa langue Paris commen ait dominer la vie conomique du pays partir de 1528, le roi Fran ois Ier manifesta son intention de s'installer Paris Deux formes du fr. : 1) La vari t populaire, le parisien --- des artisans, des ouvriers ou man uvres, des serviteurs, des petits marchands, etc. 2) La vari t cultiv e --- de la religion, de la bourgeoisie, de l'enseignement, de l'administration et du droit diff rentes, surtout dans la prononciation et le vocabulaire le parler parisien = plus de locuteurs que le fran oys, celui-ci plus prestigieux
L'ordonnance de Villers L'ordonnance de Villers- - Cotter ts de 1539 Cotter ts de 1539 le pouvoir royal s'int resse au fran ais latin universel de l' glise catholique vs la monarchie fran aise a sa langue v hiculaire = moyen d'uniformisation juridique dans la pouvoir administratif en d cembre 1490, l'ordonnance de Moulins (en Auvergne) de Charles VIII (1470-1498) : l'emploi du langage francois ou maternel dans les interrogatoires et proc s verbaux en Languedoc En 1510, Louis XII (1462-1515) --- l'emploi du vulgaire et langage du pays En 1535, l'ordonnance d'Is-sur-Tille (en Bourgogne) de Fran ois Ier(1494-1547) --- les actes r dig s en fran oys ou tout le moins en vulgaire dudict pays
une faon de rduire le pouvoir de l' glise + augmentant celui de la monarchie C'est dans son ch teau de Villers- Cotter ts que Fran ois Ier, qui parlait le fran oys, le latin, l'italien et l'espagnol, signa l'ordonnance imposant le fran oys comme langue administrative au lieu du latin 192 articles, seuls les articles 110 et 111 concernaient la langue francoise
Translitration [110. Afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arr ts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et crits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir ambigu t ou incertitude, ni lieu demander interpr tation. 111. Nous voulons donc que dor navant tous arr ts, et ensemble toutes autres proc dures, soient de nos cours souveraines ou autres subalternes et inf rieures, soient des registres, enqu tes, contrats, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en d pendent, soient prononc s, enregistr s et d livr s aux parties en langage maternel fran oys et non autrement.] Version originale 110. Que les arretz soient clers et entendibles et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz Arretz, nous voullons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. 111. Nous voulons que doresenavant tous arretz, ensemble toutes aultres procedeures, soient de noz courtz souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppendent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langaige maternel francoys et non aultrement.
le franais = la langue officielle de l'tat ? --- pas trs clair l'poque finies les longues plaidoiries pr par es en latin par les avocats! l' poque, le fran ais tait aussi tranger que le latin pour l'immense majorit de la population Rappelons ! les ordonnances royales pr c dentes (entre 1490 et 1535) : le choix entre deux usages linguistiques : - en langage Francois ou maternel (ordonnance de 1490); - en vulgaire ou langage du pa s (ordonnance de 1510); - en langue vulgaire des contractans (ordonnance de 1531); - en francoys ou a tout le moins en vulgaire dudict pays (ordonnance de 1535)
De faon gnrale, les historiens croient que l'ordonnance de 1539 n'tait pas dirig e contre les parlers locaux, mais seulement contre le latin de l' glise utilis par les gens de droit ou de justice. https://www.youtube.com/watch?v=L8CmOsnJTFc
L'expansion du franais en France L'expansion du fran ais en France Fran ois Ier: en 1543, cr ation de l'Imprimerie royale --- en grec, en h breu et en fran oys D s lors, les crits en fran ois se multipli rent le latin reste encore privil gi Avant 1550, pr s de 80 % en latin vs 50 % en 1575 plus rentable, plus de lecteurs en fr.
Les problmes du franais Les probl mes du fran ais la pr sence des patois appel s des dialectes (depuis Ronsard) la non-uniformisation de l'orthographe l'omnipr sence des cumeurs de latin l'absence d'ouvrages portant sur la description du fran ais
L'omniprsence des patois L'omnipr sence des patois En 1533, un humaniste picard Charles de Bovelles (1479-1553) l'un des plus grands philologues de la Renaissance Ouvrage sur les langues vulgaires parl es en France : De differentia vulgarium linguarum et Gallici sermonis varietate ( Des diff rentes langues vulgaires et vari t s de discours utilis s dans les Gaules ) Il y a actuellement en France autant de coutumes et de langages humains que de peuples, de r gions et de villes. une grande diversit linguistique
terme patois = invent pour des intrts politiques la fin du XIIesi cle = le parler des paysans D s le XVesi cle --- une forme grossi re par comparaison au fran ais du roi fran ois (vari t basse) comme langue maternelle : Paris, dans certaines villes du Nord (Rouen, Reims, Metz, etc.) et au sein des classes aristocratiques (vari t haute) du nord de la France Partout ailleurs, le fran ois --- une langue seconde (vari t basse ou haute) pour l'aristocratie et la grande bourgeoisie une connotation n gative, Pierre de Ronsard (1524-1585) propose le mot dialecte (du grec dialektos: langue ) Le mot dialecte : les milieux litt raires, le fonds lexical dans lequel on puise des mots de leur terroir Ronsard acceptait les vocables picards, angevins, tourangeaux, --- pour des lacunes du fran ois
Montaigne (1533-1592) : Que le gascon y aille, si le franois n'y peut aller ! Fran ois Malherbe (1555-1628) : unifier la langue fran aise Lisez et d duisez ! Et que chacun s attend prendre son repas (Desportes, l gies, Livre II, p. 390) Note : Je n approuve pas ce langage : il s attend prendre son repas, car attendere des Latins ne signifie pas attendre ; et attendre en francois ne signifie autre chose qu expectare. Cette phrase est proven ale, gasconne, et d autres telles dialectes loign es, ou italienne : Attende a far i fatti suoi. (Malherbe, 1606). Verdict ? contre les proven alismes , gasconismes et autres dialectalismes ou italianismes d gasconiser la langue fr.
tienne Pasquier (1529-1615) : Recherches pour la France (1570) Lisez et d duisez Ceux qui avoient quelque asseurance de leurs esprits, escrivoient au vulgaire de la Cour de leurs Maistres, qui en Picard, qui Champenois, qui Proven al, qui Tholozan, tout ainsi que ceux qui estoient la suite de nos Roys escrivoient au langage de leur Cour. Aujourd'huy il vous en prend tout d'une autre sorte. Car tous ces grands Duchez et Comtez estant unis nostre Couronne nous n'escrivons plus qu'en un langage, qui est celuy de la Cour du Roy, que nous appellon Fran ois. (Pasquier, 1570). un portrait d'une France linguistiquement unifi e l' crit
le dictionnaire (Dictionnaire franais contenant les mots et les choses) Pierre Richelet (1631-1694),1680 Extrait M decine. Quelques personnes se servent du mot de m decine pour dire la femme d'un M decin. Ils diront Madame la M decine, ou Mademoiselle la M decine telle est acouch e. Ces personnes parlent comme les Provinciaux qui ne savent pas parler. On dit Paris, la femme d'un M decin (Richelet, 1680). il se moque de l'usage des dialectes, les locuteurs = ne sachant pas parler tous les dictionnaires = approche d pr ciative des dialectes
Les dialecte + patois associs un usage infrieur, corrompu , grossier , rural , paysan , VS langue fran oise jug e sup rieure , raffin e , douce , l gante , royale Erreur !!! La m me origine latine Le discours du triomphe de la langue nationale sur les patois = la civilisation la langue === un objet politique qu'il faudra organiser et r glementer !
Les Les latiniseurs et cumeurs de latin latiniseurs et cumeurs de latin Le latin du XVIe si cle : les juristes ou gens de droit , les eccl siastiques ou gens d' glise , les lettr s et les scientifiques ; en plus de leur langue maternelle (le fran ois ou un dialecte) communication internationale + comprendre les crits du pass le latin continue d' voluer La communication orale entre rudits de diff rents pays --- de plus en plus difficile! l'existence du latin ternel = un mythe des alt rations, des d formations et des d gradations r vision du latin, la relecture de l'Antiquit effet secondaire ? relatinisation du fran ais mouvement r visionniste l'orthographe et le lexique
L'orthographe L'orthographe uniformisation Jusqu'alors ? N importe comment Les imprimeurs introduisent des consonnes tymologiques (! pas prononc es) un g et un t dans doi --- pour rappeler doigt origine latine digitum, le p de compter (< lat. computare), le b de doubter (< lat. dubitare), le c de faict (< lat. factum), le g de congnoistre (< lat. cognoscere), le p de corps < lat. corpus) ou de temps < lat. tempus), le h de homme (< lat. homo), le b de soubdain (< lat. subitaneus), le p de sept (< lat. septem), le g de vingt (< lat. viginti), le x de paix (< lat. pax) En ancien fran ais ! : conter, doter, faz, conoitre, cors, tems, om, sudein, set, vint et pais
But ? reconna tre la forme latine rappeler l' tymologie latine les typographes 1) afficher les connaissances, 2) des honoraires plus lev s des erreurs ! pois (ajd. poids) NON pondus MAIS pensum La d plorable orthographe du fran ais provient d ici ! 1530, protestations contre l'envahissement du fran ais par le latin : Par exemple : Jean-Antoine de Ba f (1532-1589) son succ s : presque nul
Geoffroy Tory (v. 1480-1533) imprimeur et graveur de son m tier renouveller la forme des livres condamnait les latineurs , rempla aient les mots bien connus par des formes latinisantes : transfeter pour traverser, deambuler pour se promener, quadrivies pour places publiques Voici ce qu'il pensait des escumeurs de latin : Ondit commun ment (et on dit vrai) qu'il y a grande vertu naturelle dans les herbes, pierres et paroles. En donner des exemples serait superflu tant la chose est certaine. Mais je voudrais qu'il pl t Dieu de me donner la gr ce de pouvoir, par mes paroles et requ tes, persuader certains que, m me s'ils ne veulent pas faire honneur notre langue fran aise, qu'au moins ils ne la corrompent pas. J'estime qu'il y a trois sortes d'hommes qui se plaisent travailler la corrompre et la d former : ce sont les escumeurs de latin, les faiseurs de bons mots et les jargonneurs. Quand les escumeurs de latin disent : "Despumon la verbocination latiale, & transfreton la Sequane au dilicule & crepuscule, puis deambulon par les Quadrivies & Platees de Lutece, & comme verisimiles amorabundes captiuon la beniuolence de lomnigene & omniforme sexe feminin", il me semble qu'ils ne se moquent pas seulement de nous, mais d'eux-m mes.
Franois Rabelais (v. 1494-1553) contre les cumeurs de latin pour d fendre la langue vulgaire (populaire) Il se moque du jargon pr tentieux de ceux qui ont fait leurs tudes la Sorbonne + latinisent leur propre langue Lire l extrait
Les doublets Les doublets l'une des manifestations du renouvellement du vocabulaire Un doublet correspond ? deux mots de m me origine tymologique l'un a suivi l' volution phon tique normale l'autre emprunt directement au latin (parfois au grec) apr s quelques si cles h tel et h pital sont des doublets --- du m me mot latin hospitalis, l' volution phon tique =h tel, quelques si cles plus tard = l'emprunt hospital, puis h pital quelques centaines de doublets toujours des sens diff rents, parfois tr s loign s
MOT LATIN > fr. pop. / mot savant MOT LATIN > fr. pop. / mot savant MOT LATIN > fr. pop. / mot savant MOT LATIN > fr. pop. / mot savant acer > aigre/ cre auscultare > couter/ausculter absolutum > absous/absolu capitalem > cheptel/capitale advocatum > avou /avocat singularis > sanglier/singulier masticare > m cher/mastiquer capsa > ch sse/caisse senior > sieur/seigneur ministerium > m tier/minist re scala > chelle/escale causa > chose/cause porticus > porche/portique simulare > sembler/simuler strictum > troit/strict potionem > poison/potion frictionem > frisson/friction claviculum > cheville/clavicule pedestrem > pi tre, pitre/ p destre tractatum > trait /tract operare > oeuvrer/op rer rigidus > raide/rigide fragilis > fr le/fragile pendere > peser/penser integer > entier/int gre legalis > loyal/l gal liberare > livrer/lib rer fabrica > forge/fabrique
Le Le participe pass de participe pass de Marot Marot l'accord du participe pass avec avoir emprunt un professeur italien
Notre langue a cette faon Que le terme qui va devant Volontiers r git le suivant. Les vieux exemples je suivrai Pour le mieux: car, dire vrai; La chanson fut bien ordonn e Qui dit: M'amour vous ai donn e . Et du bateau est tonn Qui dit: M'amour vous ai donn . Voil la force que poss de Le f minin quand il pr c de. Or prouverai par bons t moins Que tous pluriels n'en font pas moins: Dieu en ce monde nous a faits; Faut dire en termes parfaits: Dieu en ce monde nous a faits ; Faut dire en paroles parfaites: Dieu en ce monde les a faites ; Et ne faut point dire en effet: Dieu en ce monde les a fait . Ni nous a fait pareillement, Mais nous a faits tout rondement. L'italien, dont la faconde Passe les vulgaires du monde, Son langage a ainsi b ti En disant: Dio ci fatti.
amour = fminin La r gle pas toujours respect e, 3 variantes possibles : la lettre qu'il a crite il a une lettre crite ou il a crite une lettre Apprise par c ur par les imprimeurs au XIXe si cle, impos e dans les coles : de France, de Belgique, des cantons suisses romands et du Canada fran ais
Les dfenseurs du franais Les d fenseurs du fran ais les savants crivent en fran ais QUI PR CIS MENT ? (les math maticiens, les chimistes, les m decins, les historiens et les astronomes) + plusieurs crivains : Du Bellay, Ronsard, Rabelais, Montaigne, etc. En 1521, Pierre Fabri (v. 1450-v. 1535), un rh toricien et un po te un trait de rh torique : Grant et vray art de pleine rhetorique Dit : le vocabulaire du fran oys = riche pour d signer les r alit s avec pr cision et l gance
Du Du Bellay Bellay et la et la Pl iade Pl iade Joachim Du Bellay (1522-1560), D fense et illustration de la langue fran aise favoriser l'enrichissement du vocabulaire la cr ation de termes nouveaux (abr viations de termes existants, cr ation de mots compos s, r activation du sens des racines anciennes, etc.) les emprunts d'autres langues, r gionales ou trang res (grecque et latine notamment) ! Avec adaptation en fran ais abandonner les formes po tiques m di vales
Lisez le texte et relevez les points les plus importants de l enrichissement du fr.
Pierre Ronsard :Franciade (1572) La langue vulgaire fran aise peut produire un po me prestigieux Dans la pr face, le latin = chose morte
Robert Estienne (1503-1559) : un imprimeur huguenot, humaniste, duqu Il connaissait le fran ois, le latin et le grec, l'h breu De la pr cellence du langage fran ois (1579) : les patois = une richesse pour le royaume, le fran ois = la langue principale il introduit en 1530 l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe Ren Descartes (1596-1659) : son choix = le fran ais dans le Discours de la m thode (1637) Et si j' cris en fran ais qui est la langue de mon pays, plut t qu'en latin, qui est celle de mes pr cepteurs, c'est cause que j'esp re que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront mieux de mes opinions, que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens; et pour ceux qui joignent le bon sens avec l' tude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m'assure, si partiaux pour le latin, qu'ils refusent d'entendre mes raisons pour ce que je les explique en langue vulgaire.
Les premires descriptions du Les premi res descriptions du fran ais fran ais Au XVIe si cle, la langue fran aise = enrichie et diversifi e Les latinismes, italianismes, dialectalismes, n ologismes, etc., plus de mots du fran ais Le fran ais = langue litt raire et scientifique les premi res grammaires et les premiers dictionnaires r dig s en France (l'Angleterre avait pr c d les Fran ais)
Robert Estienne (1503-1559) : le mot dictionnaires = les r pertoires de mots du latin m di val dictionarium --- dictio = action de dire ou r servoir de dictions, de mots en 1539 le Dictionnaire Francois latin contenant les motz et manieres de parler fran ois tournez en latin : 9000 mots fran ais, + d finitions en latin ; la seconde dition = 13 000 entr es, + le lexique sp cialis En 1530, l'Anglais John Palsgrave (1480-1554) Lesclaircissement de la langue fran oyse : r dig en anglais, la prononciation et la mani re de former les lettres, un vocabulaire bilingue, Selon lui le fran ais = en g n ral corrompu cause du manque de r gles et de pr ceptes grammaticaux . de nombreux grammairiens r digent leurs r gles du fran ois en...? latin
terminologie fraaise : adjectif, conjonction, adverbe, conjugaison, terminaison, En 1550, Louis Meigret : Trett de la grammaire francoeze, fet par Louis Meigret Lionoes Son id = crire comme on parle un syst me graphique tr s particulier difficile lire [J]e suys asseur q'une bone part e de eus qi s' nm let, sont si fr ans de suyure le stile Latin, d'abandoner le notre, qe combien qe leur' parolles so tnayuem nt Fran o zes : la maou z' ordonan e rent toutefo s le sens obscur, au q vn gran' mecont ntem nt de l'or lledu lecteur, de l'assist n e. De vrey si nou' consideron' bien le stile de la lange Latin' celuy de la notre, nou' l ' trouuerons contr res en e qe comunem nt nou' f zons la fin de claoz' ou d'un discours, de e qe l Latins font leur com n em nt : si nou' considerons bien l'ordre de nature, nou' trouuerons qe le stile Fran o s s'y ranje beaocoup mieus qe le Latin. Car l ' Latins prepozent comunem nt le souspoz ao v rbe, luy donans n suyte le surpoz .
Verdict ? un rejet g n ralis le premier utiliser les adjectifs fran ais et fran aise (au lieu de fran ois/fran oise) Honorat Rambaud (1516-1586) : aussi une orthographe sur la prononciation augmenter le nombre des lettres latines : 24 nouvelles lettres (au total 52 lettres) les riches parlaient et crivaient le fran ais, leur langue maternelle = un dialecte (patois), les pauvres ne parlaient pas fran ais et n' crivaient pas du tout Son r ve : les gens du peuple puissent crire le fran ais per ue comme l' uvre d'un fou Une orthographe tymologique vs une orthographe calqu e sur la prononciation ? La langue fixe vs changement p riodique
Pierre de la Rame : la Gramere de (1515- 1572) admirait Meigret, un dialogue p dagogique (ma tre et l ve) des r formes grammaticales : la distinction entre u et v (confondues cette poque), + les trois e : e, (accent aigu)et (accent grave)
Conclusion Conclusion L'orthographe pas encore normalis e la m me page/paragraphe : des graphies diff rentes pour un m me mot Le lexique enrichi (emprunts latins) la langue de cette poque = lisible, presque du fran ais moderne le peuple ? ignorait cette langue La population paysanne : illettr e et seuls les notables --- lire et crire le fran ois