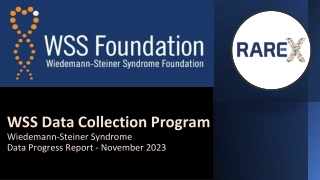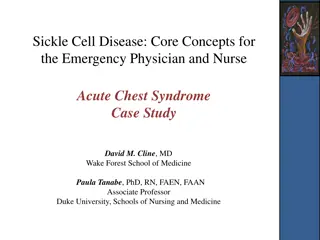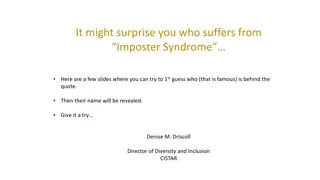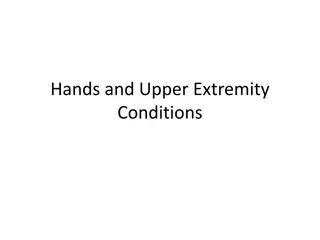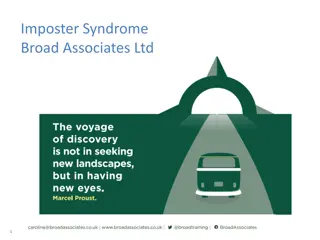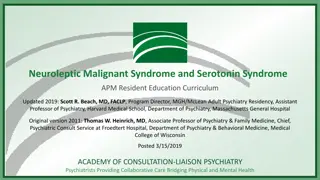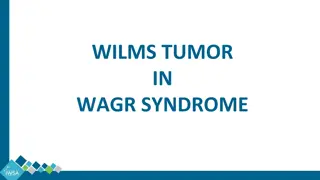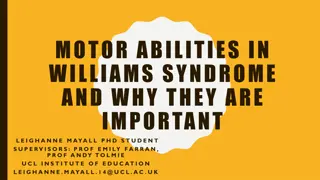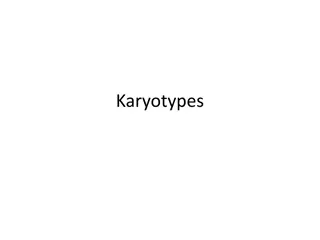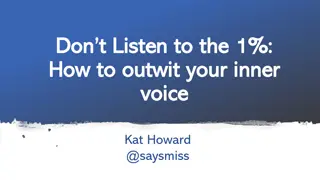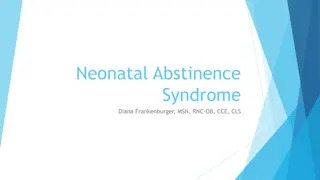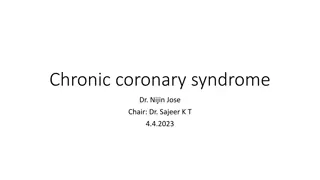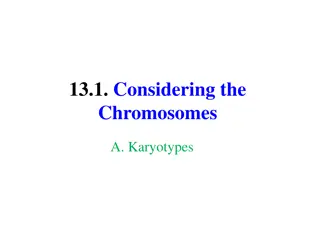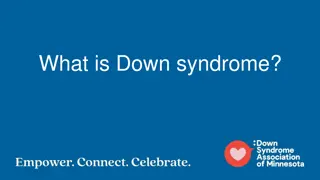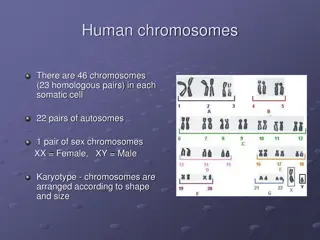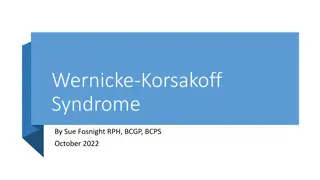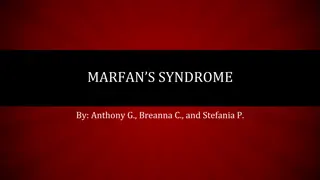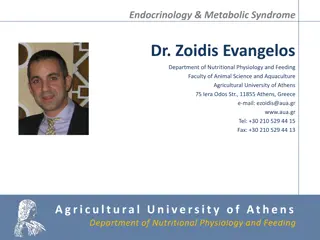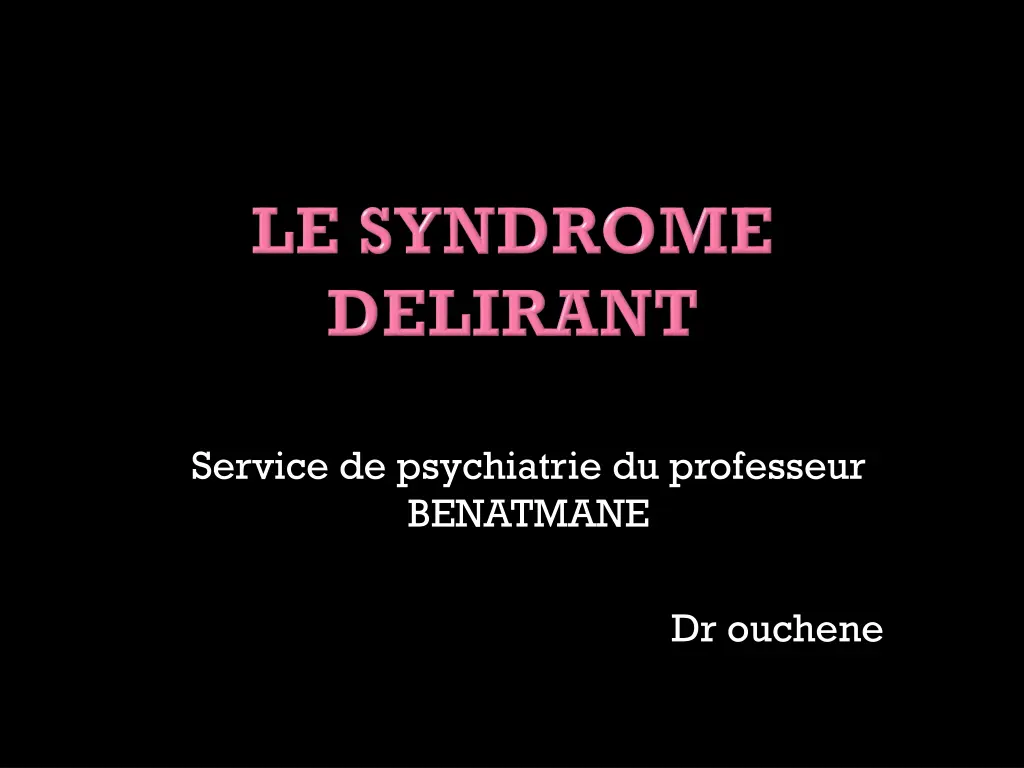
Psychiatrie du Professeur BENATMANE – Histoire et Analyses du Délire
Explore the history and analysis of delusions in psychiatry, from misconceptions of reality to specific mechanisms and diagnostic indicators. Discover various types of delusions like monomanias, persecutory delusions, and more, highlighting the evolution of diagnostic criteria over time.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Service de psychiatrie du professeur BENATMANE Dr ouchene
A/ Dfinition B/Historique C/G n ralit s D/Analyse s miologique du d lire: D but Th mes M canismes Structure Organisation Adh sion
(mot latin delirare = drailler =sortir du sillon=d raisonner=divaguer ..) Le d lire est une conviction in branlable et irr ductible d une conception fausse de la r alit qui se traduit par une alt ration du lien de r alit de l individu avec le monde ext rieur, mais aussi avec la r alit de son propre corps et de son monde psychique .
Ensemble d'ides, de discours et de repr sentations, en complet d calage avec ceux des sujets d'une m me culture ou d'un m me groupe Place souvent centrale du sujet dans la nouvelle r alit construite par le d lire.
Les "monomanies intellectuelles" et "folies partielles" d'Esquirol Le "d lire des pers cutions" de Las gue (1852) Le "d lire hypocondriaque" de Morel (1860) La "folie lucide" deTr lat (1861) Le "d lire de pers cution interpr tations d lirantes" de S glas (1890) Le "d lire raisonnant de pers cution" de R gis (1896) La nosographie de Kraepelin (1899) qui s pare la d mence pr coce et la parano a Le "d lire chronique d'interpr tation" de S rieux et Capgras (1909) Le "d lire d'imagination" de Dupr (1911) La "psychose hallucinatoire chronique" de G. Ballet (1912) Le "d lire passionnel" de G. de Cl rambault (1921)
Comme on peut le constater, la plupart de ces termes mettent l'accent sur la th matique du d lire. Mais, rapidement, les m canismes sont devenus les indicateurs essentiels du diagnostic : Si interpr tation : parano a Si imagination : paraphr nie Si hallucination : P.H.C.
Il faut toujours penser une affection somatique(c r brale),paroxysme pileptique, traumatismes, intoxications, drogues( amph tamines, alcool),infections.. et toutes les causes rentrant dans le cadre de la confusion mentale. De nombreux troubles psychopathologiques entrainent des id esd lirantes. Dans le cadre d'une PMD Les tats psychotiques d lirants aigus(BDA,CM,PP) Les tats psychotiques d lirants prolong s ou chroniques (Parano a, PHC, paraphr nie)
Les ides dlirantes peuvent tre : vagues et floues, ou au contraire pr cises et clairement nonc es ; fixes et monotones, ou bien mobiles ; mono- ou pluri th matiques ; absurdes, bizarres, invraisemblables ou encore coh rentes, plausibles jusqu un certain point. Ces l ments permettent d appr cier le degr d organisation du d lire, c est- -dire l existence ou non d une structure logique et organis e sous- jacente.
Le dlire n'est pas spontanment exprim par les patients. La r ticence (tentative de "dissimulation") est souvent le signe de l'existence d'un d lire que le sujet ne souhaite pas voquer. La disparition du d lire, aussi douloureux soit-il pour le patient, n'est pas toujours accueillie avec soulagement. Il arrive que la disparition du d lire entra ne l'apparition de ph nom nes d pressifs.
On note aussi le degr dextension du dlire, c est- -dire son niveau d envahissement dans les diff rents secteurs de la vie du sujet. Il peut tre limit (d lire en secteur ; exemple : d lire de jalousie centr sur une personne) ou tr s tendu (d lire en r seau ; exemple : bouff e d lirante aigu avec sentiment diffus de pers cution).
Le dlire constitue une no-ralit dans laquelle vit le patient. Les croyances d lirantes peuvent induire chez certains des actes - pour eux parfaitement logiques - aux cons quences m dico-l gales graves. Les d lires de jalousie, de pers cution, de pr judice, de revendication,l' rotomanie, la parano a d'auto- punition peuvent entra ner des passages l'acte auto- ou h t roagressifs qui apparaissent au sujet comme des actes de l gitime d fense ou de justice. Le risque est tr s important dans le cas o le pers cuteur est d sign .
Le syndrome dlirant se caractrise par: D but Th mes M canismes Structure Organisation Adh sion
Aigus :< 1 mois BDA. CM. PP. Chroniques: > 6 mois a) b) Non SX Parano a. PHC. paraphr nie. SX
Lactivit dlirante revt les caractristiques suivantes, associ es ou non : d lire oniro de ( tats confusionnels) ; d lire de d but brutal ; d lire de contenu congruent l humeur.
Les caractristiques de lactivit dlirante sont alors fonction du trouble sous-jacent. - Schizophr nie C est un d lire de type parano de, c est- -dire dans lequel pr dominent les sympt mes psychotiques dits positifs (hallucinations, d lire riche avec th matique et m canismes multiples),et o il y a peu de sympt mes n gatifs (repli social, pauvret des int r ts et des affects) et de d sorganisation (troubles du cours de la pens e, de l affectivit et du comportement).
-Dlires non schizophrniques Psychose hallucinatoire chronique : m canisme hallucinatoire pr dominant. Paraphr nie : m canisme imaginatif et th matique fantastique pr dominants. D lire parano aque : m canisme interpr tatif et th matique pers cutive pr dominants.
Le malade a la conviction quon cherche lui nuire. Il s agit des id es d lirantes le plus couramment observ es, elles ne sont pas sp cifiques et s observent dans des pathologies psychiatriques tr s diverses.
Elles peuvent concerner les capacits du sujet (don, richesse),son r le (mission grandiose) ou encore son identit . Elles sont en g n ral exprim es sans r ticence, et m me souvent avec un comportement hautain et d monstratif. Elles s observent dans les tats maniaques, sous- tendues ,par l lation de l humeur, les tats d mentiels (syndromes frontaux), les tats d lirants aigus ou oniro des, les d lires chroniques (contacts avec le surnaturel dans la schizophr nie ou id es de grandeur dans les d lires syst matis s).
Elles sont sous-tendues par lhumeur d pressive et la perte de l estime de soi dans les m lancolies d lirantes. Elles sont le plus souvent associ es des id es suicidaires.
Elles saccompagnent souvent dune dimension de revendication et doivent faire voquer un d lire parano aque de type passionnel .
Le malade a la conviction errone dune perte d int grit ou d un mauvais tat de sant de son corps. Dans la schizophr nie, il s agit plut t d id es de transformation corporelle (modification de la forme du nez, changement de sexe) ; dans les m lancolies d lirantes, le malade peut exprimer des id es de n gation de ses organes ou de leur fonction (intestin bouch , cerveau arr t ) ou la conviction d tre atteint d une maladie incurable.
Le malade exprime des ides de ngation de sa personne physique et morale, auxquelles peuvent s associer des id es de n gation du monde ext rieur et d immortalit constituant alors le syndrome de Cotard rencontr , mais souvent incomplet, dans les m lancolies d lirantes.
Le malade a le sentiment dtre command par une force ext rieure lui. On lui impose des id es ou des sentiments, on l oblige ou on l emp che d accomplir certains gestes, on parle par sa bouche, l emprise de la force trang re s exer ant par toute sorte de vecteurs (machine influencer). Ces sympt mes, classiquement consid r s comme pathognomoniques de la schizophr nie, peuvent aussi se rencontrer dans les bouff es d lirantes, les manies ou les m lancolies d lirantes.
Diffrents mcanismes sont l oeuvre dans l laboration d lirante ; ils sont le plus souvent associ s, mais l un d entre eux pr domine souvent.
Cest un raisonnement faux qui a pour point de d part une sensation r elle ou un fait exact auquel est donn une signification erron e. Par exemple, un malade se sentant fatigu pense qu on lui a inocul un virus (interpr tation endog ne), ou bien un malade, apr s avoir t bouscul dans le m tro, pense qu il s agit d un avertissement (interpr tation exog ne).
Mcanisme rarement isol, la connaissance intuitive s impose au sujet comme une vidence soudaine et imm diate, sans justification logique. Exemple : J ai compris tout coup que j tais le fils de Dieu .Imagination ou fabulation C est un enrichissement du d lire par des l ments issus de l imagination du sujet, volontiers extravagants ou fantaisistes. Par exemple, intervention de personnages myst rieux.
Il sagit de dformations de la perception d un objet r el pouvant affecter tous les sens. Exemple : un patient croit entendre son enfant pleurer en entendant des cris la t l vision. On peut aussi observer des variations quantitatives des perceptions (fadeur, atonie ou au contraire hyperesth sie).
Fabulation de faux vnements et souvenirs, correspondent la facult de concevoir, de cr er, voquer des images, d associer ces images entres elles avec des capacit s imaginaires laissant libre cours des plus au moins po tiques .
Ce sont de fausses perceptions qui surviennent en l absence de stimulus ext rieur : perception sans objet percevoir (H. Ey). On distingue les hallucinations psychosensorielles et les hallucinations intrapsychiques.
Ce sont des hallucinations vraies qui peuvent int resser tous les domaines perceptifs. Elles peuvent tre simples, l mentaires (sons, clairs, attouchements), ou bien complexes et labor es (conversations, sc nes ou images). Les plus fr quentes sont les hallucinations auditives et visuelles, les autres (tactiles ou c nesth siques, olfactives et gustatives) sont plus rares.
Ce sont de fausses hallucinations puisqu elles perdent leurs indices de sensorialit et de spatialit . Elle sont difficiles mettre en vidence et se d crivent comme des voix int rieures , caract ris par leur absence de subjectivit . Le sujet entend des mots, des phrases ou des conversations interf rant avec sa propre pens e et qu il explique souvent par des ph nom nes de transmission de pens e ou de t l pathie .
Fonctionnement automatique dune partie de lactivit psychique (actes, pens e et perception). Conviction d lirante que le sujet n est plus ma tre de sa volont (influenc par une force ext rieure le dirige) . Ce syndrome appara t dans un premier temps sous forme de ph nom nes l mentaires ( vocation, expression, articulation de mots en dehors de la volont , phrases absurdes se r p tent sans cesse dans la pens e, arr ts de la pens e, d vidages muet des souvenirs ) = petit automatisme mental . Le triple automatisme moteur, id ique, et id o verbal (grand automatisme mental) est constitu de mouvements parasites, de sensations de d placements impos s, paroles impos es ou emp ch es .
Organisation pseudo logique qui peut conduire des d lires partag s(syst matis s) . ex : psychoses parano aques (terrain pr dispos ) . D lires d sorganis s (non syst matis s) d lires flous incoh rents ex : d lires schizophr niques .
En secteur: ne concerne qu'une partie de la vie du sujet En r seau: s' tend graduellement l'ensemble de la vie du sujet
Linvestissement affectif du dlire, la conviction du patient conditionnent le comportement du sujet. Une adh sion forte ou totale comporte un risque important de passage l acte auto- ou h t roagressif : le d lire est agi .
liminer une pathologie organique devant tout tableau dlirant d apparition r cente : TSH,EEG, TDM c r brale, IRM... Faire un bilan des complications organiques possibles : potomanie (ionogramme plasmatique,h mogramme, prot in mie) ; alcoolisme, tabagisme (bilan h patique, radiographie thoracique, voire examens fibroscopiques et imagerie). D crire la symptomatologie d lirante selon le plan : th mes, m canismes, degr d organisation et d adh sion. Le syndrome d lirant est th mes et m canismes polymorphes. Pas de prescription syst matique de deux neuroleptiques en dehors de la phase d agitation ou comme traitement d appoint de l angoisse.
La prise en charge sociothrapeutique, l ducation du patient et de son entourage portant sur le diagnostic, les prodromes d une rechute, la n cessit du traitement et ses effets secondaires sont les facteurs pronostics d terminants. Le risque suicidaire, d automutilation ou de passage l acte h t roagressif est tr s important et souvent impr visible.
S. Vergnaud (sophie_vergnaud@hotmail.com). Unit de psychiatrie, H tel-Dieu, 1, place du parvis Notre-Dame, 75004 Paris France. Conduite tenir devant un syndrome d lirant. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Trait de M decine Akos, 7-0070, 2009.

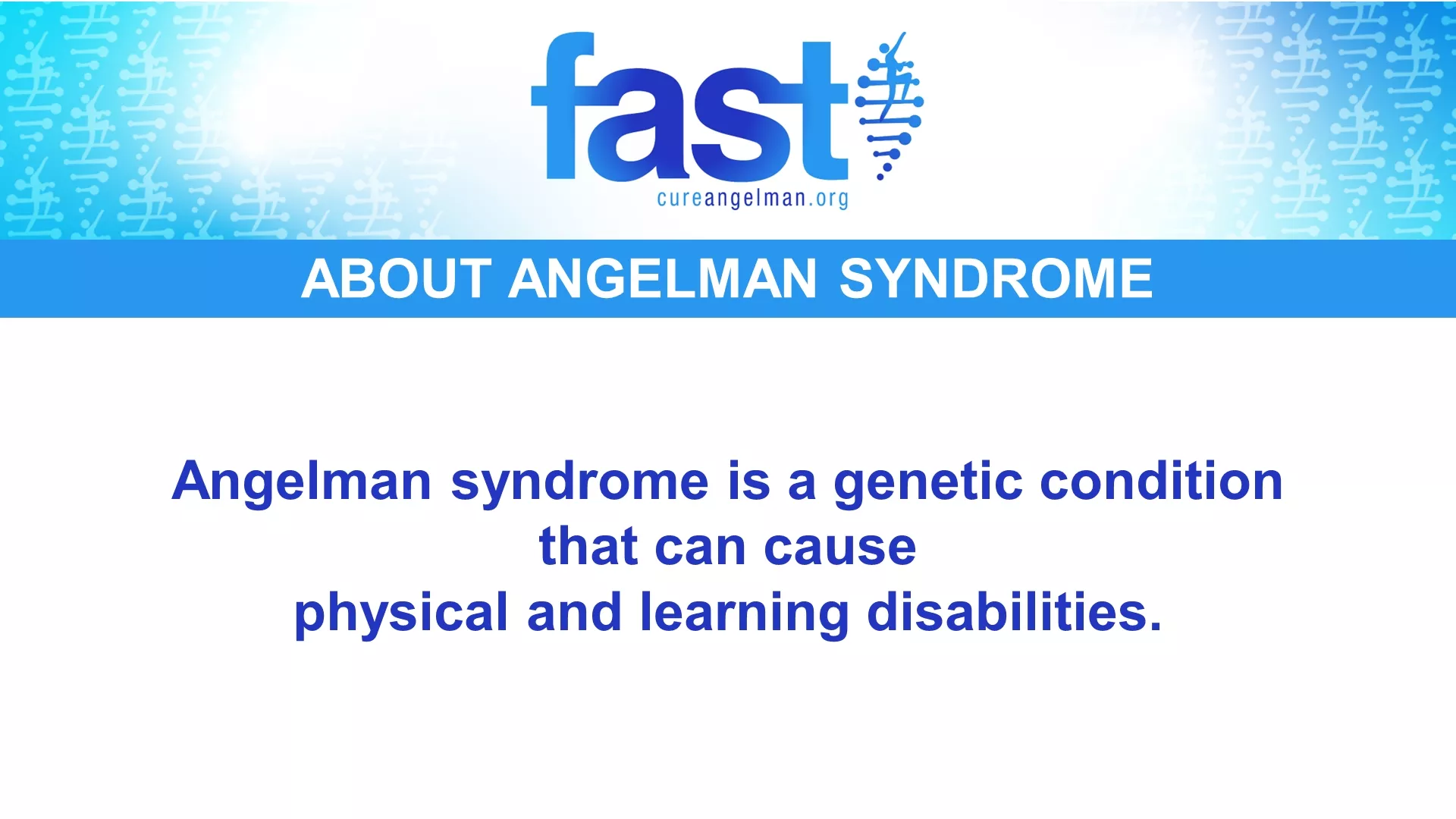
![❤[PDF]⚡ Zee Zee Does It Anyway!: A Story about down Syndrome and Determination](/thumb/20462/pdf-zee-zee-does-it-anyway-a-story-about-down-syndrome-and-determination.jpg)