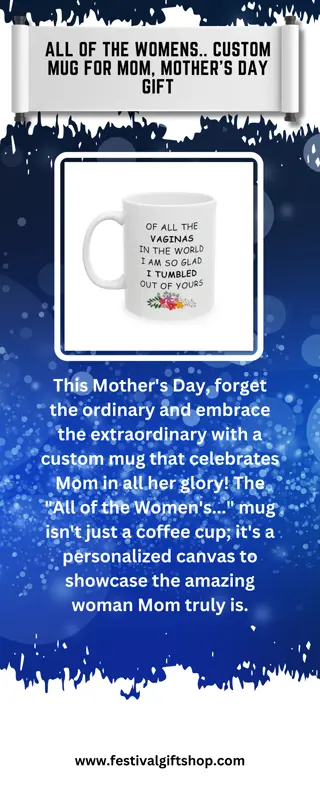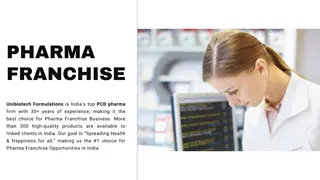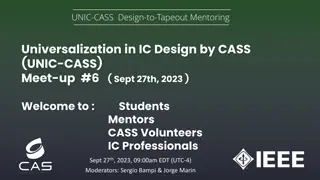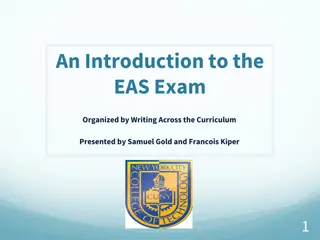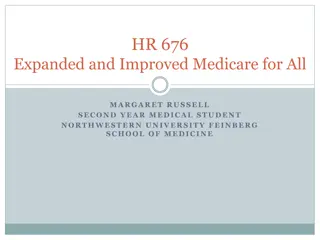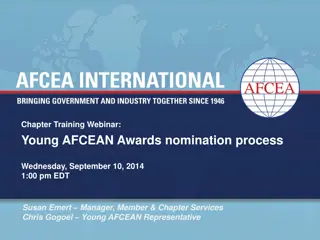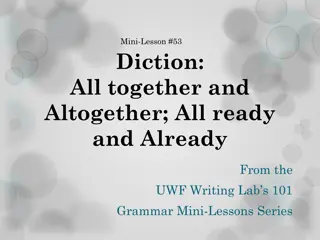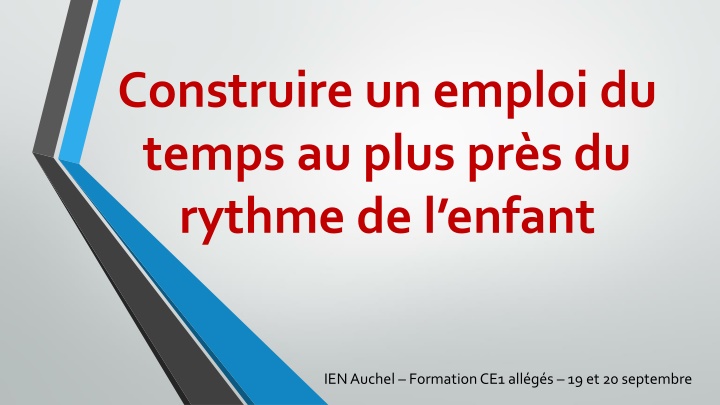
Rythme de l'Enfant: Construire un Emploi du Temps Adapté avec l'IEN Auchel
Découvrez comment construire un emploi du temps personnalisé en fonction du rythme de l'enfant grâce à la formation CE1 de l'IEN Auchel. Une réflexion approfondie est menée pour améliorer les résultats des élèves en croisant leur rythme biologique avec les activités proposées, tout en tenant compte des spécificités de la classe et en dynamisant l'enseignement. Les différents facteurs influençant l'emploi du temps sont examinés, tels que les attentes institutionnelles, les besoins des enfants, les contraintes locales et les choix pédagogiques.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Construire un emploi du temps au plus pr s du rythme de l enfant IEN Auchel Formation CE1 all g s 19 et 20 septembre
POURQUOI UNE REFLEXION SUR LEMPLOI DU TEMPS ? Am liorer les r sultats des l ves en : 1) Croisant leur rythme biologique journalier avec les activit s propos es. 2) Tenant compte de la sp cificit de la classe all g e. 3) Dynamisant son enseignement (signes de d crochage, activit s de transition, alternance type de sollicitation/modalit de travail).
DEROULEMENT de lintervention : Apports th oriques : - attentes institutionnelles et contraintes mat rielles, - les besoins de l enfant et les rythmes de l enfant - les incidences sur l organisation des temps d enseignement Sp cificit de la classe all g e R flexion sur l emploi du temps de sa classe : travail en autonomie
LEMPLOI DU TEMPS: Il r sulte de la prise en compte de diff rents facteurs : - Les attentes institutionnelles (les horaires des programmes, arr t du 9 novembre 2015) - Les besoins et les rythmes des enfants. - Les contraintes locales de la vie de l cole. - Les choix op r s par l quipe p dagogique en lien avec le projet d cole ( changes de service, d cloisonnement ). - Les choix p dagogiques du ma tre.
Le temps d'enseignement Les horaires hebdomadaires de l' cole l mentaire sont r partis sur 24 heures. L'ann e scolaire compte 864 heures d'enseignement. Deux heures d'enseignement sont consacr es la lecture. Les horaires affect s aux diff rents domaines disciplinaires entrent sont pr cis s dans l' arr t du 9 novembre 2015 (JO du 24/11/2015).
Article 3 Sous r serve que l'horaire global annuel de chaque domaine disciplinaire soit assur , la dur e hebdomadaire des enseignements par domaine figurant l'article 2 peut tre ajust e en fonction des projets p dagogiques men s. Article 4 Les temps de r cr ation, d'environ quinze minutes en cole l mentaire et trente minutes en cole maternelle, sont d termin s en fonction de la dur e effective de la demi- journ e d'enseignement. Le temps d volu aux r cr ations est imputer de mani re quilibr e dans la semaine sur l'ensemble des domaines d'enseignement. Arr t du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des coles maternelles et l mentaires http://eduscol.education.fr/cid49225/presentation.html
LES BESOINS ET LES RYTHMES DE L ENFANT
Dfinitions : - La chronobiologie est l tude des rythmes biologiques et des variations physiologiques p riodiques. Elle correspond des p riodes d activation et de repos dont tout individu a besoin. Le sommeil en est l un des aspects le plus reconnu et fondamental. (Cf. Professeur Hubert Montagner) - La chrono psychologie est l tude des rythmes des comportements et de l activit intellectuelle. Les tudes en chrono psychologie scolaire de l enfant ( tude des niveaux de vigilance et de performance de l enfant en milieu scolaire) montrent que l activit intellectuelle des l ves fluctue au cours de la journ e mais aussi au cours de la semaine.
Ces fluctuations de rythmes nont pas les mmes causes : - Les variations journali res - Les variations hebdomadaires Le terme rythmes scolaires peut tre entendu de deux mani res diff rentes : - Soit par rapport au rythme de l enfant : biologique et chrono psychologique en situation scolaire, qui d pend de chaque enfant. - Soit par rapport au calendrier et aux emplois du temps impos s aux l ves, qui sont g r s par les adultes.
Variations journalires : Constats : La dur e de la journ e l cole est de 6h de temps contraint (sans compter les temps de trajet, les heures de garderie et/ou de cantine). Elle est identique pour les enfants de 3 12 ans. Il a t observ des alternances de temps forts et de temps faibles dans l attention et la capacit du traitement de l information.
Temps faibles - Un r veil entre 6h30 et 7h30 (cas le plus fr quent) ne permet pas aux enfants d tre vigilants la premi re heure de classe (8h30 - 9h30) , surtout pour les plus jeunes. - A partir de 8h30, il faut entre 30 et 60 minutes pour que les enfants trouvent un niveau de vigilance suffisamment lev pour qu ils puissent d velopper une attention, une r ceptivit et une disponibilit optimale. - La mi-journ e : entre 12h30 et 14h : d pression de la vigilance corticale (inh rente au cerveau), qui n a rien voir avec la prise alimentaire.
Temps forts - Apr s 9h/9h30 : augmentation de la vigilance et du pourcentage d l ves mobilisant leurs processus cognitifs. Maximum des capacit s intellectuelles jusqu 11h/11h30. - Apr s 15h (jusqu 16h30) : augmentation des taux de vigilance et d attention. Apr s 16h : temps propice aux activit s physiques et sportives : augmentation du m tabolisme, de la temp rature corporelle et de la force musculaire, et une optimisation des coordinations motrices. Pour un enfant de 5-6 ans, la dur e utile des activit s p dagogiques pour une journ e de classe s l ve 2 ou 3 heures maximum (parfois beaucoup moins selon les environnements et les conditions de vie) : la dur e maximale d attention soutenue est en moyenne de 15 minutes cons cutives. Ces temps sont des temps maximaux pendant lesquels la vigilance et l attention s lective des enfants sont suffisamment lev es, pour que les savoirs et les connaissances soient efficacement transmis ; et donc pour que chaque l ve ait une plus forte probabilit de bien comprendre et d apprendre.
Variations hebdomadaires : Pour que la synchronisation entre les rythmes propres de l enfant et le rythme scolaire se fasse au mieux la r gularit est importante. Toutes les ruptures sont susceptibles de modifier cette synchronisation. Le lundi est un jour de faibles r sultats dus au ph nom ne de d synchronisation, effet perturbateur du week-end sur l adaptation la situation scolaire (fatigabilit accentu e dans les milieux d favoris s ), ce qui entra ne des difficult s d apprentissage. Les meilleures performances intellectuelles, d attention et de compr hension sont observables les mardis et jeudis.
La problmatique est dharmoniser les deux facteurs afin : d am liorer les conditions d apprentissage, de r duire les tensions et la fatigue de l enfant, d instaurer une meilleure qualit de vie dans l cole,
LES INCIDENCES SUR L ORGANISATION DU TEMPS D ENSEIGNEMENT
1/ Le dbut de matine Ren Clarisse (chercheur et chronopsychologue) estime que le d marrage 8h30 est trop t t, et peut amener quelques difficult s pour les enfants (pour d buter la classe et fatigue pendant l apr s-midi). Il pr conise un d but de classe plus tardif, 9 heures, afin que l attention des enfants soit id ale tout au long de la journ e. 2/ Les jours de la semaine Les professionnels ont constat que les mardis et les jeudis sont les deux jours de la semaine o les performances des enfants sont les meilleures. Il ne serait donc pas id al par exemple de mettre un cr neau de sport le mardi matin au d triment de l enseignement de fondamentaux. 3/ La r cr ation de l apr s midi Cette coupure apporte un effet de rebond l attention des enfants, elle est m me n cessaire . Remarque : cette coupure peut se faire par un changement d activit . Elle ne n cessite pas forc ment une r cr ation l ext rieur.
4/ Le sport : Faire commencer le sport 13h30 peut comporter des risques, des tudes ayant montr que les accidents taient plus importants entre 13h et 15h. Mais, quand la classe finit 15h45 et que le cr neau ne peut tre d plac au matin, le compromis para t in vitable. 5/ Fran ais et maths le matin : Nicole Delvolv (neuroscientifique-ergonome) : Il y a un mythe des mati res nobles mettre le matin, mais cette configuration fatigue les enfants . Selon, elle, la plage d attention du milieu d apr s-midi est la plus favorable aux apprentissages et est celle retenir en priorit .
6/ Faut-il raisonner par matire ? R. Clarisse et N.Delvov pr conisent de ne pas raisonner par mati re qui n est pas la meilleure fa on de parvenir l emploi du temps optimal. Raisonner par mati re ne veut rien dire, affirme Nicole Delvolv , car les besoins des enfants changent en fonction des moments de la semaine et de la journ e . Selon elle, le matin, le cerveau est plus efficace sur la m moire d j utilis e, alors que l apr s-midi, il l est plut t pour apprendre de nouvelles notions. Quand de nouvelles notions doivent tre apprises, il faut alors mettre la mati re en question dans le cr neau de l apr s-midi. Ren Clarisse, lui parle plut t de charge cognitive , soit le degr d effort demand l enfant. Il vaut mieux ainsi r server les mati res, ou tout au moins les points exigeants d une mati re pour les plages d attention favorables du matin et de l apr s-midi. En sachant qu une bonne apr s-midi est galement tributaire des efforts demand s le matin et de la mani re dont se d roule la pause m ridienne.
7/ Un emploi du temps fig ? Le meilleur emploi du temps serait l inverse d une organisation fig e pour l ann e enti re. Pour Nicole Delvolv , un bon emploi du temps serait celui qui s adapte la situation , et serait diff rent chaque semaine en fonction des apprentissages inculquer. Ren Clarisse trouve du bon dans un emploi du temps fig qui apporte un cadre, un rep re temporel aux enfants.
8/ Comment les chrono biologistes voient-ils les emplois du temps ?
a) Je repre les signes de dcrochage: La bonne dur e pour une s ance c est de finir avant que la classe ne d croche. Signes corporels d crypt s par les enseignants : - Position fl chie (dos rond, paules rentr es..) - Gesticulation sur la chaise, nervosit , mouvements r p titifs (jeu avec le crayon ) - Hypotonicit ou hypertonicit de l enfant Autres signes : - Excitation ou passivit du groupe classe, - Inattention, manque de concentration, - Difficult s m moriser - Comportements agressifs envers l enseignant, entre les l ves
b) Quelques ides dactivits pour crer une rupture, vacuer les tensions et favoriser la remobilisation - Rituels corporels - Lecture offerte (tr s courte, style nouvelle, texte incomplet: la suite demain) - Rituels en histoire des arts, mur d images, coute musicale, - Rituels en LV - Po sie/th tre (plut t versant mise en sc ne en duo, viser le dynamisme) - Chants, jeux de rythme. - Activit s rythm es (exemple calcul mental)
c) Dans la journe, alterner : Les modes de sollicitations : les temps de recherche, de d couverte, d entra nement, de cr ation, de m morisation, de r investissement Les types d activit s : - D couvrir/explorer - Conceptualiser - M moriser - Cat goriser . Les modalit s de travail : - Individuel, bin me, groupe de 3 ou 4, groupe classe - Oral, crit d) Moduler la dur e des s ances en fonction des activit s et en fonction de l ge. (entre 10 et 30 min pour les l ves de cycle 2, 15 et 45 min pour les l ves de cycle 3)
Un emploi du temps journalier qui croise les plages horaires avec les types dactivits
Un emploi du temps journalier qui croise les plages horaires avec les types dactivits (suite)
Les attendus de fin de CE1 : Au CE1, l automatisation du d codage conduit les l ves lire une vitesse d au moins 70 mots par minute. Les rep res de progression permettent aux professeurs de concevoir des programmations et un emploi du temps hebdomadaire qui accordent une place importance l entra nement de la lecture haute voix, dont la pratique quotidienne est favoris e par la taille du groupe, dont il convient d utiliser pleinement l opportunit . Construire le parcours d un lecteur autonome (une des quatre recommandations) La classe d doubl e constitue un cadre propice un entra nement intensif de la lecture voix haute. Chaque jour, tous les l ves lisent haute voix, en pr sence du professeur, seuls ou en tout petit groupe. L automatisation des proc dures de d codage, pour les l ves qui en ont besoin, s obtient au prix d un entra nement tr s r gulier, de gammes de lecture, partir de listes de syllabes, pseudos mots, mots contenant une puis deux et trois syllabes. L emploi du temps en classe de CP et de CE1 est volutif, remani au fil de l ann e en fonction des apprentissages stabilis s et de ceux qui restent renforcer. le volume horaire d di aux domaines d apprentissages est-il suffisant ? l enseignement de la grammaire et du vocabulaire fait-il l objet de s ances d di es r guli res inscrites l emploi du temps ? la pratique de l criture dans ses 4 dimensions (r daction, copie, dict e et geste graphique) est-elle tr s r guli re et mise en uvre d s le d but de l ann e ?
viter la sur sollicitation, entretenir la motivation et lattention des lves. Pour viter la sur sollicitation, cueil possible avec un groupe restreint d l ves, le professeur organise la journ e en distinguant les phases d apprentissage, les temps collectifs ou individuels, les travaux en autonomie, en grand groupe ou en petits groupes. Les enfants ont des temps d attention relativement courts mais particuli rement intenses. Contrairement aux adultes, ils se fatiguent vite, mais ils reprennent de l nergie aussi vite. Il est important de les solliciter sur des temps courts, et d autant plus courts que les enseignements sont nouveaux. Une alternance de temps de d couverte, d entra nement, de jeu et de repos, s encha nent avec r gularit dans la journ e de classe. Les l ves reconnaissent l identit formelle des situations dont les enjeux ne varient pas et qui constituent des rep res s rs, m me si les contenus voluent.
Travail en autonomie autour des emplois du temps
A partir de ce fichier.. http://bit.ly/edtauchel

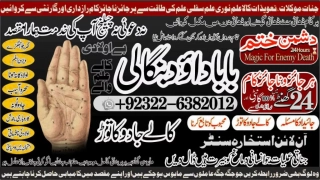

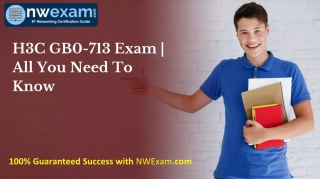
![GET [✔PDF✔] DOWNLOAD✔ My Vegan Recipe Notebook for all your recipes - 6x9 i](/thumb/68090/get-pdf-download-my-vegan-recipe-notebook-for-all-your-recipes-6x9-i.jpg)