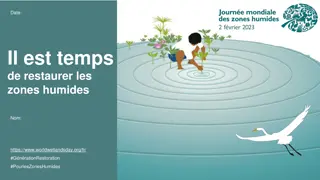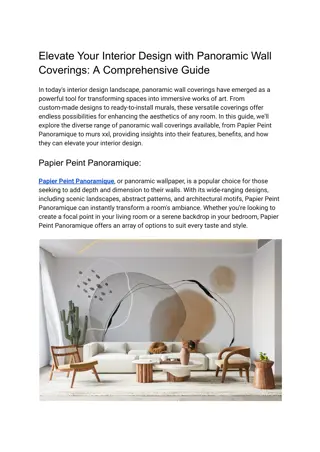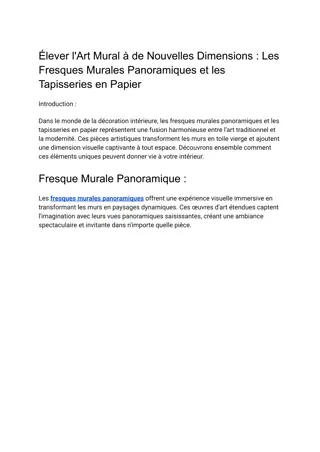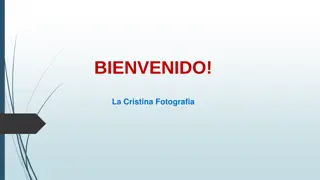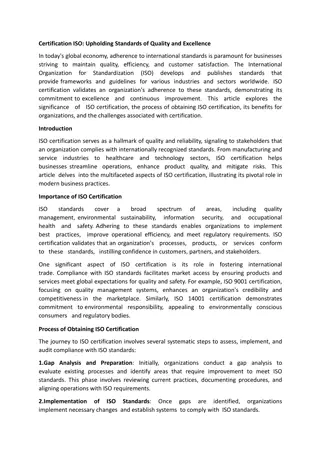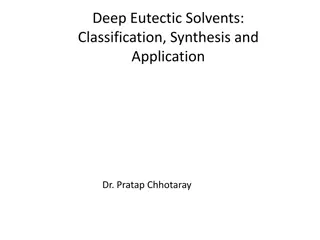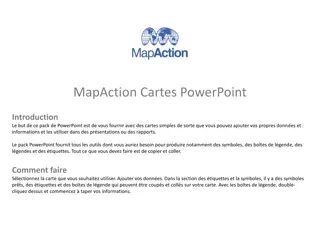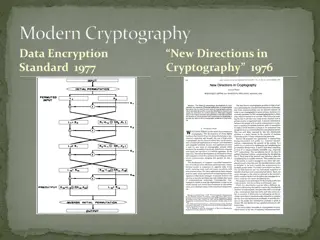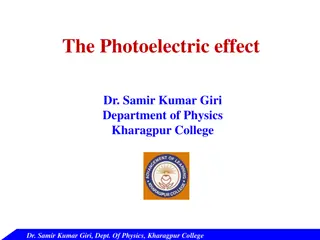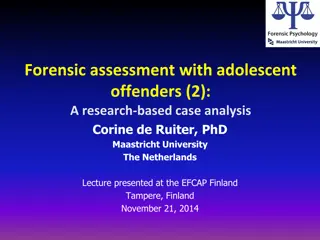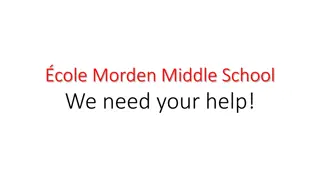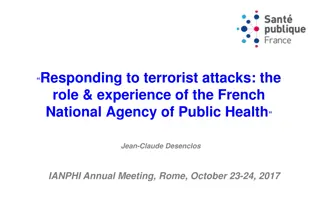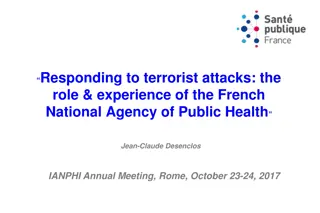UM6SS - EL MIDANE SAMIR - École Internationale de Santé Publique de lUniversité Mohammed VI des Sciences et de la Santé
UM6SS - EL MIDANE SAMIR - École Internationale de Santé Publique de lUniversité Mohammed VI des Sciences et de la Santé
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Utilisation des grands modles de langage (LLM) en rdaction m dicale El Midane Mohamed Samir Master en Health Data Science cole Internationale de Sant Publique Universit Mohammed VI des Sciences et de la Sant 30 d cembre 2024 R sum Les grands mod les de langage (LLM), tels que ChatGPT, transforment la r daction m dicale en offrant des opportunit s significatives pour am liorer la productivit , faciliter l acc s la r daction scientifique pour les non-anglophones, soutenir l enseignement m dical et optimiser la veille scientifique. Cependant, leur int gration dans le milieu acad mique et m dical soul ve des enjeux thiques et juridiques complexes, notamment en mati re de confidentialit des donn es, de responsabilit en cas d erreur, et de risque de d shumanisation de la relation de soin. Cette revue de port e (scoping review) explore les usages, b n fices, risques et implications des LLM dans la r daction m dicale, en s appuyant sur une analyse des cadres juridiques, notamment au Maroc et dans l Union europ enne, et des principes thiques fondamentaux. Les r sultats soulignent la n cessit d un encadrement rigoureux, incluant des volutions l gislatives, une formation des professionnels de sant , et une transparence accrue des algorithmes pour garantir une int gration thique et s curis e des LLM dans la pratique m dicale. 1 Introduction L mergence des grands mod les de langage (LLM), tels que ChatGPT, a marqu un tournant significatif dans de nombreux domaines, y compris celui de la r daction m dicale. Ces outils bas s sur l intelligence artificielle g n rative ont d montr une capacit remarquable produire du texte coh rent et contextuellement pertinent, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l am lioration de la productivit et l acc s l information scientifique. La r daction m dicale, qui englobe la cr ation de documents cliniques, de publications de recherche, de supports ducatifs et de communications r glementaires, est un domaine o la pr cision, la clart et la conformit thique sont primordiales. L int gration des LLM dans ce processus promet de r volutionner la mani re dont les professionnels de la sant , les chercheurs et les tudiants interagissent avec la litt rature scientifique et produisent leurs propres crits. Cependant, cette transformation ne vient pas sans d fis. L utilisation des LLM dans un contexte aussi sensible que la m decine soul ve des questions fondamentales concernant la confi- dentialit des donn es des patients, la fiabilit des informations g n r es, la responsabilit en 1
cas derreurs, et limpact potentiel sur la relation mdecin-patient. De plus, linfluence de ces technologies sur la production acad mique, notamment en termes d originalit , de paternit et d int grit scientifique, n cessite une analyse approfondie. La rapidit avec laquelle ces technolo- gies voluent exige une r flexion proactive sur les cadres thiques et juridiques n cessaires pour encadrer leur d ploiement de mani re s curis e et b n fique. Cette revue de port e vise explorer de mani re exhaustive l utilisation des LLM en r daction m dicale, en identifiant les opportunit s qu ils pr sentent, les enjeux thiques et juridiques qu ils soul vent, et leur impact sur la production acad mique. Nous nous appuierons sur une analyse des cadres juridiques existants, notamment au Maroc et dans l Union europ enne, ainsi que sur les principes thiques fondamentaux qui doivent guider l int gration de ces technologies. L ob- jectif est de fournir une synth se des connaissances actuelles et de d gager des recommandations pour une utilisation responsable et thique des LLM dans le domaine de la r daction m dicale, garantissant ainsi que l innovation technologique serve au mieux les int r ts des patients et de la science. 2 M thodologie Cette revue de port e a t men e conform ment aux lignes directrices du Joanna Briggs Institute (JBI) pour les revues de port e, ainsi qu aux recommandations PRISMA-ScR (Prefer- red Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews). L objectif principal est d identifier et de cartographier l tendue des preuves disponibles concer- nant l utilisation des grands mod les de langage (LLM) en r daction m dicale, en se concentrant sur les opportunit s, les enjeux thiques et juridiques, et l impact sur la production acad mique. 2.1 Strat gie de recherche Une recherche syst matique de la litt rature a t effectu e dans plusieurs bases de donn es lectroniques, incluant PubMed, Scopus, Web of Science, et Google Scholar. Les termes de re- cherche ont t construits en combinant des mots-cl s relatifs aux grands mod les de langage (ex. : Large Language Models , LLM , ChatGPT , AI generative ), la r daction m dicale (ex. : medical writing , academic writing , scientific publication ), aux opportunit s ( oppor- tunities , benefits , applications ), aux enjeux thiques et juridiques ( ethical issues , legal frameworks , data privacy , responsibility ), et l impact acad mique ( academic impact , research integrity ). Des op rateurs bool ens (AND, OR) ont t utilis s pour affiner les re- qu tes. La recherche a t limit e aux articles publi s en fran ais et en anglais, sans restriction de date, afin de capturer l ensemble de la litt rature pertinente. 2.2 Crit res d ligibilit Les tudes ont t incluses si elles abordaient l utilisation des LLM dans le contexte de la r daction m dicale ou scientifique, en examinant les avantages, les risques, les implications thiques, juridiques ou l impact sur la production acad mique. Les types de documents consid r s incluaient les articles de recherche originaux, les revues de litt rature, les articles d opinion, les 2
rapports et les lignes directrices. Les tudes qui ne traitaient pas spcifiquement des LLM ou de la r daction m dicale ont t exclues. 2.3 S lection des tudes Les titres et r sum s des articles identifi s lors de la recherche initiale ont t examin s de mani re ind pendante par deux valuateurs pour d terminer leur pertinence. En cas de d sac- cord, une discussion a t engag e pour parvenir un consensus. Les articles potentiellement ligibles ont ensuite t r cup r s en texte int gral pour une valuation plus approfondie par les m mes valuateurs, sur la base des crit res d ligibilit pr d finis. 2.4 Extraction des donn es Les donn es pertinentes ont t extraites des tudes incluses l aide d un formulaire d ex- traction standardis . Les informations recueillies comprenaient les caract ristiques de l tude (auteurs, ann e de publication, type d tude), les LLM sp cifiques mentionn s, les applications en r daction m dicale, les opportunit s identifi es, les enjeux thiques et juridiques soulev s, l impact sur la production acad mique, et les recommandations formul es. Les donn es relatives aux cadres juridiques au Maroc et dans l Union europ enne ont t extraites s par ment. 2.5 Synth se des donn es Les donn es extraites ont t synth tis es de mani re narrative, en regroupant les infor- mations par th mes principaux correspondant aux objectifs de la revue (opportunit s, enjeux thiques et juridiques, impact acad mique, cadres juridiques). Une analyse qualitative a t r alis e pour identifier les tendances, les lacunes dans la litt rature et les domaines n cessitant des recherches suppl mentaires. Aucune m ta-analyse n a t effectu e en raison de la nature h t rog ne des tudes incluses. 3 R sultats 3.1 Opportunit s des LLM en r daction m dicale Les grands mod les de langage (LLM) transforment la r daction m dicale en offrant une multitude d opportunit s pour am liorer l efficacit , l accessibilit et la qualit de la production scientifique. L une des principales contributions des LLM r side dans leur capacit automatiser les t ches r p titives et chronophages, telles que la g n ration de brouillons, la reformulation de phrases, la correction grammaticale et orthographique, et la synth se de longs documents [1, 2]. Cette automatisation permet aux professionnels de la sant et aux chercheurs de consacrer plus de temps l analyse critique, l interpr tation des donn es et la conceptualisation de nouvelles recherches, plut t qu aux aspects purement r dactionnels. Pour les non-anglophones, les LLM repr sentent un atout majeur en facilitant l acc s la r daction scientifique en anglais, la langue pr dominante dans la publication m dicale interna- tionale. Gr ce leurs capacit s de traduction et de reformulation avanc es, ces mod les peuvent 3
aider surmonter les barrires linguistiques, permettant ainsi un plus grand nombre de cher- cheurs de partager leurs d couvertes avec la communaut scientifique mondiale [1]. Cela favorise une plus grande diversit et inclusion dans la recherche m dicale. En mati re d enseignement m dical, les LLM peuvent servir d outils p dagogiques interactifs. Ils peuvent g n rer des contenus ducatifs personnalis s, cr er des quiz, simuler des sc narios cliniques pour la formation des tudiants, et fournir des explications claires sur des concepts m - dicaux complexes [3]. Cette capacit adapter le contenu aux besoins individuels des apprenants peut enrichir l exp rience ducative et am liorer la compr hension des sujets. L optimisation de la veille scientifique est une autre opportunit significative. Les LLM peuvent rapidement analyser et synth tiser de vastes quantit s de litt rature scientifique, iden- tifier les tendances mergentes, extraire des informations cl s et g n rer des r sum s concis de publications [2]. Cette fonctionnalit est particuli rement pr cieuse dans un domaine o le vo- lume de nouvelles recherches est en constante augmentation, permettant aux cliniciens et aux chercheurs de rester inform s des derni res avanc es sans tre submerg s par l information. De plus, les LLM peuvent jouer un r le crucial dans la recherche biom dicale en aidant la g n ration d hypoth ses, l identification de corr lations inattendues dans de grands ensembles de donn es, et l extraction automatis e de connaissances partir de bases de donn es textuelles [2, 3]. Ils peuvent galement assister dans la r daction de protocoles de recherche, de demandes de subventions et de rapports d tudes cliniques, en assurant la coh rence et la conformit aux normes requises. En somme, les LLM offrent un potentiel consid rable pour transformer positivement la r - daction m dicale en la rendant plus efficace, accessible et innovante, tout en lib rant du temps pour des activit s plus forte valeur ajout e. 3.2 Enjeux thiques et juridiques Malgr les opportunit s qu ils pr sentent, l int gration des LLM dans la r daction m dicale soul ve des enjeux thiques et juridiques complexes qui n cessitent une attention particuli re. La confidentialit des donn es des patients est l une des pr occupations majeures. Les LLM, par leur nature, sont entra n s sur d normes corpus de donn es, et l utilisation de donn es m dicales sensibles, m me anonymis es, pose des questions sur la possibilit de r identification et la protection de la vie priv e [4, 5]. Le risque de fuites de donn es ou d acc s non autoris des informations confidentielles est une menace constante, et la mani re dont les LLM traitent et stockent ces donn es doit tre rigoureusement encadr e. La question de la responsabilit en cas d erreurs ou de d sinformation g n r e par les LLM est galement cruciale. Si un LLM produit un texte m dical erron qui conduit une mauvaise d cision clinique ou une publication scientifique incorrecte, qui est responsable? Le d velop- peur du mod le, l utilisateur, ou l institution? L absence de clart sur cette responsabilit peut entraver l adoption g n ralis e des LLM dans des contextes o la pr cision est vitale [4, 6]. Les LLM peuvent galement propager des biais existants dans les donn es sur lesquelles ils ont t entra n s, ce qui peut conduire des recommandations ou des analyses discriminatoires, no- tamment en fonction de l origine ethnique, du genre ou du statut socio- conomique des patients [5]. 4
Un autre enjeu thique concerne le risque de dshumanisation de la relation de soin. Si les LLM sont utilis s pour interagir directement avec les patients ou pour g n rer des communica- tions m dicales sans supervision humaine ad quate, cela pourrait alt rer la qualit de la relation patient-m decin, bas e sur l empathie, la confiance et le jugement clinique [4]. La d pendance excessive aux LLM pourrait galement entra ner une diminution des comp tences r daction- nelles et de la pens e critique chez les professionnels de la sant , s ils se fient trop aux outils automatis s sans exercer un contr le suffisant. Sur le plan juridique, l utilisation des LLM doit tre conforme aux r glementations existantes en mati re de protection des donn es, telles que le RGPD en Europe et la Loi 09-08 au Maroc. Ces cadres juridiques imposent des exigences strictes en mati re de consentement, de finalit du traitement, de s curit des donn es et de droits des personnes concern es. L int gration des LLM dans les flux de travail m dicaux n cessite une valuation approfondie de la conformit et, potentiellement, des adaptations l gislatives pour adresser les sp cificit s de ces technologies, notamment en ce qui concerne la propri t intellectuelle des contenus g n r s et la gestion des donn es de sant [7, 8]. En r sum , les enjeux thiques et juridiques li s aux LLM en r daction m dicale sont mul- tiples et interd pendants. Ils appellent une approche prudente et r glement e, ax e sur la transparence, la responsabilit et la protection des droits fondamentaux des individus. 3.3 Impact sur la production acad mique L av nement des LLM a un impact profond et multiforme sur la production acad mique, modifiant les pratiques de recherche, de r daction et de publication. L un des effets les plus imm diats est l augmentation potentielle de l efficacit et de la productivit des chercheurs. Les LLM peuvent acc l rer la phase de revue de litt rature en synth tisant rapidement des articles, en identifiant des th mes cl s et en g n rant des r sum s, permettant ainsi aux chercheurs de se concentrer sur l analyse critique et l interpr tation [9, 10]. Ils peuvent galement aider la r daction de diff rentes sections d un manuscrit, de la proposition de recherche la discussion des r sultats, en fournissant des formulations, en am liorant la clart et en assurant la coh rence stylistique. Cependant, cet accroissement de l efficacit soul ve des questions importantes concernant l originalit et la paternit des uvres. Lorsque des parties significatives d un manuscrit sont g n r es par un LLM, la question se pose de savoir qui est le v ritable auteur et comment reconna tre la contribution de l outil. Les politiques des revues scientifiques et des institutions acad miques sont en pleine volution pour adresser ces d fis, avec des exigences croissantes de transparence sur l utilisation des LLM dans la r daction [9]. Le risque de plagiat, qu il soit intentionnel ou non, est galement amplifi , car les LLM peuvent g n rer du texte qui ressemble troitement des sources existantes sans attribution ad quate. La fiabilit des informations g n r es par les LLM est une autre pr occupation majeure. Bien que ces mod les soient capables de produire des textes fluides et convaincants, ils peuvent parfois g n rer des hallucinations , c est- -dire des informations factuellement incorrectes ou invent es [10]. Dans le contexte acad mique, o la rigueur scientifique est primordiale, l int gration de telles erreurs peut compromettre l int grit de la recherche et la cr dibilit des publications. Il 5
est donc impratif que les utilisateurs vrifient minutieusement toutes les informations gnres par les LLM avant de les incorporer dans leurs travaux. L impact sur l int grit scientifique s tend galement aux biais potentiels. Les LLM sont entra n s sur de vastes ensembles de donn es qui peuvent refl ter des biais soci taux ou des d s quilibres dans la litt rature existante. Si ces biais sont reproduits ou amplifi s dans le texte g n r , cela pourrait perp tuer des st r otypes ou des conclusions erron es, affectant la validit et l quit de la recherche [4]. Enfin, l utilisation g n ralis e des LLM pourrait modifier les comp tences requises pour la r daction acad mique. Si les outils automatisent une grande partie du processus, il est crucial de maintenir et de d velopper les comp tences humaines en pens e critique, en analyse, en synth se et en communication scientifique. L objectif n est pas de remplacer l intellect humain, mais de l augmenter, en permettant aux chercheurs de se concentrer sur les aspects les plus complexes et cr atifs de leur travail. 3.4 Cadre juridique au Maroc Au Maroc, la protection des donn es personnelles est principalement r gie par la Loi n 09-08 relative la protection des personnes physiques l gard du traitement des donn es caract re personnel, promulgu e en 2009 [11]. Cette loi, inspir e des directives europ ennes de l poque, tablit les principes fondamentaux de la protection des donn es, notamment le consentement des personnes concern es, la finalit du traitement, la proportionnalit , la s curit des donn es et les droits des individus (droit d acc s, de rectification, d opposition) [12]. La Commission Nationale de Contr le de la Protection des Donn es Caract re Personnel (CNDP) est l autorit charg e de veiller l application de cette loi. L mergence des LLM, et plus largement de l intelligence artificielle, pose de nouveaux d fis ce cadre juridique. La Loi 09-08, bien que robuste pour son poque, n a pas t con ue pour anticiper les sp cificit s des technologies d IA g n rative qui traitent d normes volumes de donn es, y compris des donn es sensibles comme celles de la sant [13]. Les questions cl s qui se posent incluent : Collecte et traitement des donn es : Les LLM n cessitent d importantes quantit s de donn es pour leur entra nement. Si ces donn es incluent des informations personnelles ou de sant , leur collecte et leur traitement doivent tre conformes aux principes de la Loi 09-08, notamment en termes de lic it , de loyaut et de transparence. Le consentement explicite des individus est souvent requis pour le traitement des donn es de sant . Anonymisation et pseudonymisation : Les donn es m dicales utilis es pour entra ner ou interroger les LLM doivent tre anonymis es ou pseudonymis es de mani re efficace pour prot ger l identit des patients. Cependant, la r identification de donn es m me anonymis es est un risque croissant avec les techniques avanc es d IA [11]. S curit des donn es : Les plateformes h bergeant les LLM et les donn es qu ils traitent doivent garantir des mesures de s curit techniques et organisationnelles appropri es pour pr venir les acc s non autoris s, les pertes ou les alt rations de donn es, conform ment aux exigences de la Loi 09-08. 6
Responsabilit : La dtermination de la responsabilit en cas de violation de donnes ou d utilisation abusive des LLM est complexe. La Loi 09-08 attribue la responsabilit au respon- sable du traitement, mais dans le contexte des LLM, plusieurs acteurs peuvent tre impliqu s (d veloppeur du mod le, fournisseur de services cloud, utilisateur final). Le Maroc a montr un int r t croissant pour l encadrement de l IA, avec des discussions et des initiatives visant adapter son cadre juridique. L objectif est de garantir que l innovation technologique s accompagne d une protection ad quate des droits fondamentaux et de la vie priv e des citoyens, tout en favorisant le d veloppement de l IA dans le pays [14]. Des volutions l gislatives sont attendues pour combler les lacunes et clarifier les obligations sp cifiques aux LLM dans le secteur de la sant . 3.5 Cadre juridique dans l Union europ enne L Union europ enne (UE) est l avant-garde de la r glementation de la protection des don- n es et de l intelligence artificielle, avec deux instruments l gislatifs majeurs qui impactent di- rectement l utilisation des LLM en r daction m dicale : le R glement G n ral sur la Protection des Donn es (RGPD) et le futur R glement sur l Intelligence Artificielle (AI Act). Le R glement G n ral sur la Protection des Donn es (RGPD) (R glement (UE) 2016/679), entr en application en mai 2018, est la pierre angulaire de la l gislation europ enne en mati re de protection des donn es personnelles [15]. Il impose des obligations strictes toute entit traitant des donn es personnelles de r sidents de l UE, quel que soit le lieu d tablissement de l entit . Pour les LLM en r daction m dicale, le RGPD soul ve plusieurs points critiques : Donn es de sant sensibles : Le RGPD classe les donn es de sant comme des cat gories sp ciales de donn es personnelles, n cessitant une protection accrue. Leur traitement est en principe interdit, sauf exceptions sp cifiques (ex. : consentement explicite, int r t public dans le domaine de la sant publique) [16]. L entra nement des LLM sur des donn es de sant , m me agr g es ou anonymis es, doit respecter ces conditions strictes. Principes de protection des donn es : Les LLM doivent adh rer aux principes du RGPD, notamment la minimisation des donn es (collecter uniquement ce qui est n cessaire), la limita- tion de la finalit (utiliser les donn es pour des objectifs sp cifiques et l gitimes), l exactitude, la limitation de la conservation, l int grit et la confidentialit . La conception des LLM doit int grer ces principes d s le d part (privacy by design et by default) [17]. Droits des personnes concern es : Le RGPD conf re aux individus des droits tendus, tels que le droit d acc s, de rectification, l effacement (droit l oubli), la limitation du traitement, la portabilit des donn es et d opposition. L exercice de ces droits peut tre complexe lorsque les donn es sont int gr es dans des mod les d IA complexes et distribu s [18]. Transferts de donn es : Si les LLM sont h berg s ou trait s dans l envergure de l UE, les transferts de donn es personnelles doivent tre encadr s par des m canismes de transfert appropri s (ex. : clauses contractuelles types, d cisions d ad quation) pour garantir un niveau de protection quivalent celui de l UE. 7
Le Rglement sur lIntelligence Artificielle (AI Act), dont ladoption est imminente, vise tablir un cadre juridique harmonis pour l IA dans l UE, en adoptant une approche bas e sur les risques [19]. Les syst mes d IA sont class s en diff rentes cat gories de risque (inacceptable, lev , limit , minimal), avec des exigences proportionnelles chaque niveau. Les LLM, en particulier ceux utilis s dans le domaine de la sant , sont susceptibles d tre class s comme des syst mes d IA haut risque en raison de leur potentiel impact sur la sant et la s curit des personnes. Pour ces syst mes, l AI Act imposera des obligations strictes, notamment : Syst mes de gestion des risques : Mise en place de syst mes robustes pour identifier, analyser et att nuer les risques tout au long du cycle de vie du LLM. Gouvernance des donn es : Exigences strictes concernant la qualit , la pertinence et la repr sentativit des ensembles de donn es utilis s pour l entra nement, la validation et les tests des LLM, afin de minimiser les biais et les erreurs. Documentation et tenue de registres : Obligation de maintenir une documentation tech- nique d taill e et des registres d activit pour assurer la tra abilit et la transparence. Transparence et information des utilisateurs : Les utilisateurs doivent tre inform s lorsque des syst mes d IA sont utilis s et comprendre leurs capacit s et limitations. Supervision humaine : N cessit d une surveillance humaine significative pour garantir que les d cisions critiques ne sont pas prises uniquement par l IA. Robustesse et cybers curit : Les LLM doivent tre con us pour tre robustes, pr cis et r silients face aux erreurs et aux attaques de cybers curit . L UE cherche ainsi cr er un environnement o l innovation en IA peut prosp rer tout en garantissant un niveau lev de protection des droits fondamentaux, de la s curit et de la confiance des citoyens. L interaction entre le RGPD et l AI Act sera cruciale pour encadrer l utilisation des LLM en r daction m dicale, en assurant la fois la protection des donn es personnelles et la fiabilit des syst mes d IA. 4 Discussion La pr sente revue de port e a mis en lumi re le r le transformateur des grands mod les de langage (LLM) dans le domaine de la r daction m dicale, tout en soulignant les d fis signifi- catifs qu ils posent. Les opportunit s identifi es, telles que l am lioration de la productivit , la facilitation de l acc s la r daction scientifique pour les non-anglophones, le soutien l ensei- gnement m dical et l optimisation de la veille scientifique, sont ind niables. Les LLM peuvent agir comme de puissants assistants, lib rant les professionnels de la sant et les chercheurs des t ches r dactionnelles r p titives et leur permettant de se concentrer sur des activit s plus forte valeur ajout e, telles que l analyse critique et la conceptualisation de la recherche [1, 2]. Cette capacit synth tiser rapidement de vastes quantit s d informations est particuli rement pertinente dans un environnement m dical o le volume de connaissances ne cesse de cro tre. Cependant, l int gration de ces technologies dans un domaine aussi sensible que la m decine n est pas sans risques. Les enjeux thiques et juridiques, notamment la confidentialit des donn es des patients, la responsabilit en cas d erreurs et le risque de d shumanisation de la relation de soin, sont au cur des pr occupations [4, 5]. La question de la confidentialit est exacerb e par la 8
nature mme des LLM, qui ncessitent dnormes volumes de donnes pour leur entranement, soulevant des inqui tudes quant la r identification des donn es et la protection de la vie priv e. La responsabilit en cas de contenu erron g n r par un LLM reste une zone grise, n cessitant une clarification urgente pour viter des cons quences potentiellement graves sur la sant des patients ou l int grit de la recherche [6]. De plus, la d pendance excessive aux LLM pourrait roder les comp tences r dactionnelles et la pens e critique des professionnels, soulignant la n cessit d une supervision humaine constante et d une formation ad quate. L impact des LLM sur la production acad mique est galement ambivalent. Si ces outils peuvent am liorer l efficacit et la vitesse de publication, ils posent des d fis majeurs en termes d originalit , de paternit et d int grit scientifique [9, 10]. La facilit avec laquelle les LLM peuvent g n rer du texte soul ve des questions sur le plagiat et la v racit des informations. Les politiques des revues et des institutions acad miques doivent voluer rapidement pour s adapter ces nouvelles r alit s, en exigeant une transparence accrue sur l utilisation des LLM et en renfor ant les m canismes de v rification. Les biais inh rents aux donn es d entra nement des LLM peuvent galement se propager dans la litt rature scientifique, n cessitant une vigilance particuli re pour maintenir l quit et la validit de la recherche. Les cadres juridiques existants, comme la Loi 09-08 au Maroc et le RGPD dans l Union europ enne, fournissent une base pour la protection des donn es personnelles, mais n cessitent des adaptations sp cifiques pour les LLM [11, 15]. L AI Act europ en, en cours d laboration, repr sente une tentative proactive de r guler l IA en fonction des risques, imposant des obli- gations strictes aux syst mes d IA haut risque, y compris ceux utilis s en sant [19]. Ces r glementations visent garantir la s curit , la transparence et la responsabilit des LLM, tout en prot geant les droits fondamentaux des individus. Cependant, la mise en uvre effective de ces cadres n cessitera une collaboration troite entre les l gislateurs, les d veloppeurs de technolo- gies, les professionnels de la sant et les experts en thique. 5 Conclusion L av nement des grands mod les de langage (LLM) repr sente une r volution pour la r dac- tion m dicale, offrant des perspectives sans pr c dent en termes d efficacit , d accessibilit et d innovation. Ces outils ont le pouvoir de transformer la mani re dont les professionnels de la sant et les chercheurs interagissent avec la litt rature scientifique, produisent des documents cli- niques et acad miques, et diffusent les connaissances. En automatisant des t ches r p titives, en facilitant la communication multilingue et en optimisant la veille scientifique, les LLM peuvent lib rer un temps pr cieux, permettant aux experts de se concentrer sur l analyse critique et la prise de d cision clair e. Cependant, cette int gration ne peut se faire sans une prise en compte rigoureuse des d fis thiques et juridiques inh rents l utilisation de l intelligence artificielle dans un domaine aussi sensible que la sant . La confidentialit des donn es des patients, la question de la responsabilit en cas d erreurs, le risque de propagation de biais et l impact sur l int grit scientifique sont des pr occupations majeures qui n cessitent des r ponses claires et des cadres r glementaires adapt s. Les l gislations existantes, telles que la Loi 09-08 au Maroc et le RGPD en Union euro- p enne, fournissent une base, mais des adaptations sp cifiques et des nouvelles r glementations, 9
comme lAI Act, sont essentielles pour encadrer lutilisation des LLM de manire scurise et thique. Pour garantir une int gration r ussie et b n fique des LLM en r daction m dicale, plusieurs actions sont imp ratives. Premi rement, il est crucial de d velopper et de mettre en uvre des lignes directrices thiques claires et des politiques de gouvernance robustes, qui d finissent les limites et les responsabilit s de l utilisation de ces outils. Deuxi mement, une formation conti- nue des professionnels de la sant et des chercheurs est n cessaire pour qu ils comprennent les capacit s et les limites des LLM, et qu ils puissent les utiliser de mani re critique et responsable. Troisi mement, la transparence des algorithmes et des donn es d entra nement est fondamentale pour b tir la confiance et permettre une valuation ind pendante des biais et des performances. Enfin, un dialogue continu entre les d veloppeurs de technologies, les r gulateurs, les profession- nels de la sant , les thiciens et le public est indispensable pour naviguer dans ce paysage en volution rapide et s assurer que les LLM servent au mieux les int r ts de la sant publique et de la science. En d finitive, les LLM sont des outils puissants qui peuvent consid rablement enrichir la r daction m dicale. Leur potentiel ne sera pleinement r alis que si leur d ploiement est guid par des principes thiques solides, un cadre juridique clair et une approche collaborative, garantissant ainsi que l innovation technologique contribue positivement l avancement de la m decine et la protection des patients. R f rences [1] Opportunities and Challenges for Large Language Models in ... - PMC. URL : https: //pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11960148/ [2] Int gration des LLM dans le secteur de la sant - medvasc. URL : https://medvasc. info/archives-blog/int gration-des-llm-dans-le-secteur-de-la-sant / [3] L avenir des LLM dans le domaine de la sant : 5 cas d utilisation ... - linkidoc. URL : https://www.linkidoc.fr/blog/2024/07/01/lavenir-des-llm-dans-ledomaine-de-la-sante-5-cas-dutilisation-clinique/ [4] Applications des Mod les IA LLM et du Deep Learning en ... - Amethis. URL : https: //amethis.doctorat.org/amethis-client/prd/consulter/offre/785 [5] Syst mes d IA g n rative en sant : - enjeux et perspectives. URL : ://www.academie- medecine.fr/wp-content/uploads/2024/03/Rapport-Systemes-dIA-generative-en-sante.pdf [6] Syst mes d intelligence artificielle g n rative : - enjeux d thique. URL : ://www.ccne- ethique.fr/sites/default/files/2023-07/CNPEN-Avis7-SIAgen-enjeux d thique-2023-07-04- web.pdf [7] Les scientifiques r clament des lignes directrices thiques alors que ... - dailyai. URL : https://dailyai.com/fr/2024/07/scientists-urge-for-ethical-guidelines-as-llms-play-wider-roles-in-healthcare/ [8] L OMS publie des lignes directrices sur l thique et la gouvernance ... - WHO. URL : https://www.who.int/fr/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models [9] Impact of LLMs on Academic Literature Synthesis. URL : ://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/194326/Alex Zhang 8E 399 524.pdf?sequence=1isAllowed=y 10
[10] How Insiders and Outsiders Reshape Scientific Knowledge Production. URL : https: //arxiv.org/html/2505.12666v1 [11] La protection des donn es personnelles dans un monde ... - village-justice. URL : https:// www.village-justice.com/articles/protection-des-donnees-personnelles-dans-monde-connecte-enjeux-pour-les, 51868.html [12] La protection des donn es caract re personnel au Maroc - ResearchGate. URL : https:// www.researchgate.net/publication/389888306_LA_PROTECTION_DES_DONNEES_A_CARACTERE_ PERSONNEL_AU_MAROC [13] Les donn es personnelles l poque du big-data : quel cadre juridique ... - revuechercheur. URL : ://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/download/559/478 [14] L Intelligence Artificielle : Un Enjeu Juridique et Soci tal pour le ... - westfieldmorocco. URL : https://westfieldmorocco.com/2025/03/10/lintelligence-artificielle-un-enjeu-juridique-et-societal-pour-le-maroc-et-leurope/ [15] Le r glement g n ral sur la protection des donn es - RGPD - CNIL. URL : https://www. cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees [16] Donn es personnelles | LLM. European Law - assas-universite. URL : https://lm-european-law. assas-universite.fr/fr/donnees-personnelles [17] Trois recommandations pour d velopper un LLM respectueux de la ... - usine-digitale. URL : https://www.usine-digitale.fr/article/trois-recommandations-pour-developper-un-llm-respectueux-de-la-confidentialite-des-donnees. N2230511.html [18] LLM et donn es personnelles - VOX Legal. URL : https://www.voxlegal.ch/llm-et-donnees-personnelles [19] IA et protection des donn es personnelles : la r glementation ... - village-justice. URL : https://www.village-justice.com/articles/protection-des-donnees-personnelles-guide-des-bonnes-pratiques, 50547.html 11