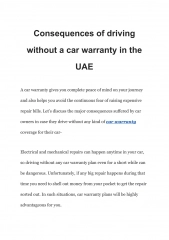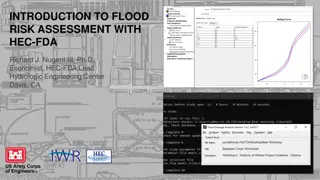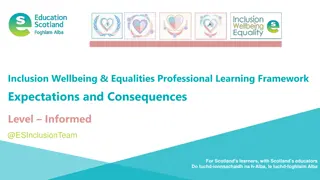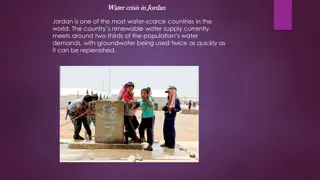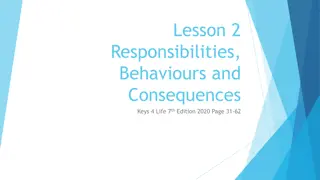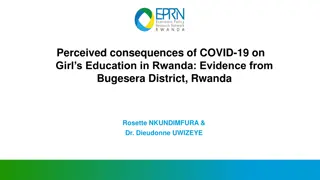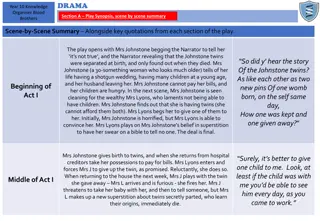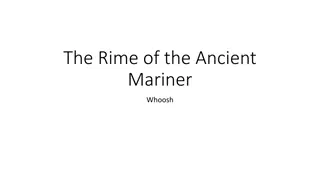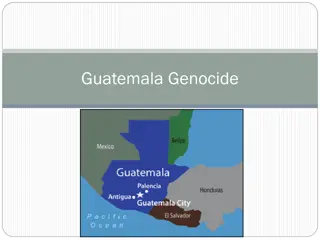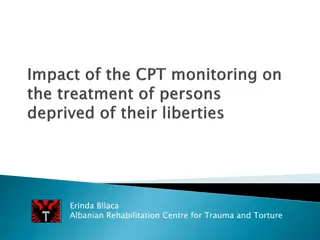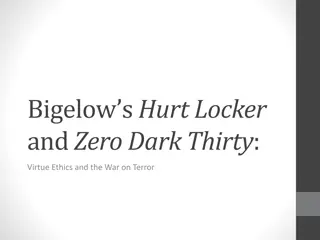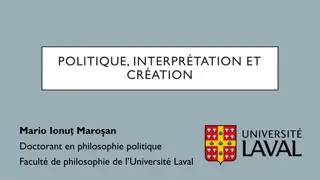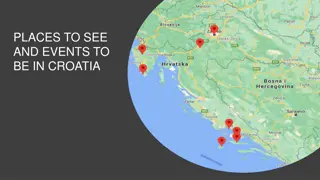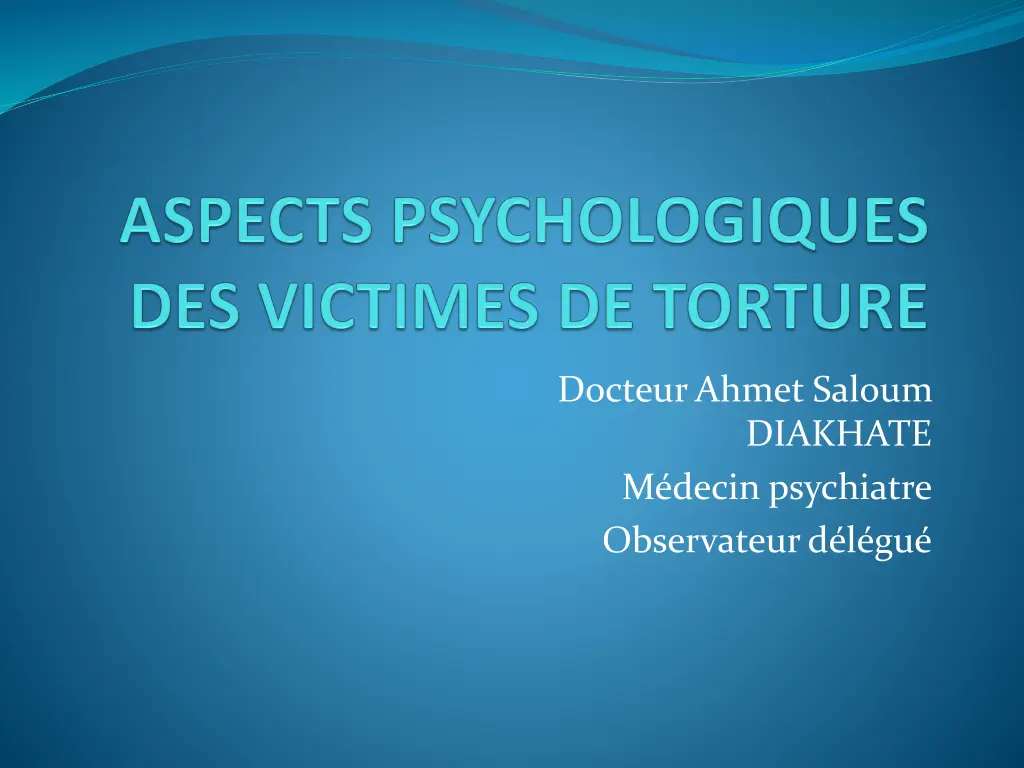
Understanding and Managing Stress Levels: Self-Evaluation Questionnaire Results
This content presents a self-evaluation questionnaire to assess stress levels, with detailed questions and scoring criteria. The results provide insight into one's stress responses and offer guidance on seeking specialist help based on the score obtained.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Docteur Ahmet Saloum DIAKHATE M decin psychiatre Observateur d l gu
12 items Echelle d Evaluation Tout fait vrai Plut t vrai Plut t faux Tout fait faux J prouve fr quemment de l agacement ou de l irritation quand les choses ne peuvent se passer comme pr vu 1. C J ai du mal <<d crocher >>le weekend et ne plus penser au travail 2.P Je coupe souvent la parole aux autres 3.C et cherche imposer mon point de vue de travail J ai des probl mes de sommeil (Difficult s m endormir ou r veils pr coces) 4S Apres avoir terminer une tache, je peux tre soucieux et ruminer des pens es n gatives un sujet 5 P Il m arrive, face un sup rieur, d avoir la gorge serr e et les mains moites ne sachant quoi dire 6.S J ai souvent recours l alcool ou la cigarette pour me procurer 1 d tente 7.S Je suis moins satisfait de moi et je pense ne pas tre toujours << la hauteur>> dans mon travail 8.P J ai l impression de travailler trop rapidement par manque de temps 9.C Il m arrive de perdre mon calme et de m emporter vis- -vis de mon entourage professionnel 10.C J ai r guli rement des manifestations 11.S physiques d sagr ables (digestion p nible) Je ressens moins de plaisir et d int r t que jadis dans mes activit s professionnelles ou de loisirs 12.p
Tout fait vrai Plut t vrai Plut t faux Tout fait faux J prouve fr quemment de l agacement ou de l irritation quand les choses ne peuvent se passer comme pr vu 1. C J ai du mal <<d crocher >>le weekend et ne plus penser au travail 2.P Je coupe souvent la parole aux autres 3.C et cherche imposer mon point de vue de travail J ai des probl mes de sommeil (Difficult s m endormir ou r veils pr coces) 4S Apres avoir terminer une tache, je peux tre soucieux et ruminer des pens es n gatives un sujet 5 P Il m arrive, face un sup rieur, d avoir la gorge serr e et les mains moites ne sachant quoi dire 6.S J ai souvent recours l alcool ou la cigarette pour me procurer 1 d tente 7.S Je suis moins satisfait de moi et je pense ne pas tre toujours << la hauteur>> dans mon travail 8.P J ai l impression de travailler trop rapidement par manque de temps 9.C Il m arrive de perdre mon calme et de m emporter vis- - vis de mon entourage professionnel 10.C J ai r guli rement des manifestations 11.S physiques d sagr ables (digestion p nible) Je ressens moins de plaisir et d int r t que jadis dans mes activit s professionnelles ou de loisirs 12.p
Rsultats R sultat est compris entre 0 et 36 Score entre 0 et 5 : Vous ne connaissait pas de stress Score entre 6 et 12 : Confront aux stress de l existence, vous semblez savoir faire face et rester calme dans beaucoup de circonstances Score entre 13 et 20 : Vous connaissez le stress. Il peut vous tre utile car peut vous permettre de donner le meilleur de vous-m me Score gal ou sup rieur : Niveau de stress lev . Consulter un sp cialiste Comment vous r agissez au stress et quelques conseils Pour connaitre votre fa on de r agir au stress, proc dez ainsi : Additionnez les 4 << S >> (4, 6, 7 et 11) vous obtenez votre score <<r action somatique>> Additionnez les notes aux 4 << P >> (2, 5, 8 et 12) : c est votre score <<r action psychologique>> Additionnez les notes 4 << C >> (1, 3, 9 et 10) c est votre score <<r action comportementale>> R action somatique plus importante : manifestations physiques au premier plan.
Les 10 distorsions cognitives les plus courantes Certaines pens es automatiques peuvent r v ler des d faillances dans le traitement de l information. Ces distorsions cognitives sont fr quemment associ es la d pression, l anxi t ainsi qu la plupart des troubles mentaux. Voici les dix plus courantes :
1, La pense dichotomique : tout ou rien Lorsque le raisonnement est priv de nuances, tout ce qui n est pas une victoire devient une d faite, tout ce qui n est pas sans risque devient dangereux, etc. Ce type de pens e se retrouve logiquement associ au perfectionnisme, aux sentiments d pressifs d incapacit , de culpabilit , d auto d valorisation mais galement certains traits de personnalit s pathologiques. Si vous n tes pas avec moi, vous tes contre moi Commentaire : Tiens, a me rappelle un certain mois de septembre 2001. J ai fait un cart, a ne vaut plus la peine de continuer le r gime L employeur ne m a pas recrut , je ne suis pas fait pour ce boulot 2, L abstraction s lective : filtrage mental D un v nement ou d une exp rience ne seront retenus que les d tails les plus d plaisants. Ceux-ci viennent souvent confirmer une croyance n gative pr alable. Cette op ration conduit la plupart du temps une fixation et des ruminations anxieuses, d pressives, obs dantes en rapport avec ces fameux d tails. J ai g ch mon RDV avec lui car en l embrassant, je lui ai march sur le pied Mon expos est rat , j ai vu quelqu un rire dans le public Ce m decin a consult le Vidal pendant la consultation, il n est pas comp tent
3, La disqualification du positif : pas pour moi Plus que d un priori n gatif, il s agit d un rejet syst matique du caract re positif d un v nement et de sa transformation neutre ou n gative. Un v nement n gatif sera en revanche bien m rit . Ce genre de raisonnement constitue un puissant renfor ateur de la d pression tant il a tendance priver des cons quences positives de l action. Oui j ai eu mon dipl me cette ann e, mais c est un coup de chance Elle m a fait un compliment sur ma cuisine, mais c est parce qu elle a piti de moi Le patron m a offert une promotion mais c est parce qu il n avait personne d autre qui la donner 4, La sur g n ralisation : toujours et partout L extrapolation peut devenir outranci re, notamment lorsqu un ou quelques v nements n gatifs suffisent r sumer l ensemble des exp riences et/ou des performances d un individu. Cette sur g n ralisation peut aussi bien concerner le pass , le pr sent ou l avenir (verticale ou chronologique) qu elle peut s tendre d autres domaines plus ou moins en rapport avec l v nement. J ai t licenci , j ai toujours t incapable de garder un boulot Aucune fille ne m a invit danser hier, et de toute fa on personne ne s int resse moi Je suis encore tomb sur un homme mari , c est s r, je resterai seule toute ma vie
5, Ltiquetage : jugement dfinitif Coller sur soi ou les autres des tiquettes n gatives procure volontiers des motions toutes aussi n gatives et contrarie parall lement toute id e d volution positive. Cataloguer renforce notamment le sentiment d incapacit et le d sespoir caract ristiques de la d pression. J ai oubli mon RDV, je ne suis pas quelqu un de fiable Il m a doubl par la droite, c est un chauffard ! Je me suis nerv contre lui, je ne sais pas garder mon sang froid 6, L inf rence arbitraire : boule de cristal Lorsque ce qui devrait rester une intuition devient une conviction, la conclusion se tire souvent trop h tivement et sans preuve. Lire dans la pens e d autrui ou pr dire l avenir restent deux pratiques divinatoires fr quemment associ es la souffrance motionnelle et la renonciation anxieuse ou d pressive. a ne sert rien de lui demander une augmentation car si je la m ritais, il me l aurait donn e Je ne serai jamais suffisamment solide pour pouvoir me passer des m dicaments Si elle ne m a pas rappel , c est qu elle n a pas envie de me voir .
7, Le catastrophisme : pire du pire Des sc narios d sastreux peuvent se construire sur la base d un simple incident sans gravit , et conduire s en faire une montagne . Assimiler ce qui devrait rester des pens es des faits, toujours sans preuve, favorise l escalade d motions n gatives associ es ces pr dictions funestes. Ma fille n est toujours pas rentr e, elle a du se faire kidnapper, violer, assassiner J ai laiss ma braguette ouverte toute la matin e, ils doivent tous se moquer de moi, ma r putation est fichue, je n ai plus qu changer de boulot, d m nager, loin Ma femme rigole en lisant le SMS d un coll gue, elle me trompe, elle ne m aime plus, nous allons devoir divorcer et je me retrouverai seul, personne ne voudra d un cocu comme moi 8, Le raisonnement motionnel : preuve par le sentiment Lorsque l importance accord e une motion devient excessive, celle-ci peut tre assimil e une v ritable preuve, voire un fait et aboutir un jugement erron . Les motions fortes contrarient ainsi la prise en compte d l ments contradictoires et donc l analyse rationnelle d une situation. S il a r ussi m nerver ce point, c est qu il cherche les probl mes Le patron m a convoqu dans son bureau, je ne suis pas tranquille, il a certainement quelque chose me reprocher J tais mal l aise au diner, je suis s r qu ils m ont trouv ridicule .
L interpr tation d un v nement peut conduire surestimer sa responsabilit voire la cr er de toutes pi ces, ceci favorisant logiquement l mergence d un sentiment de culpabilit . Ce ph nom ne se r p te et s intensifie au cours de la d pression jusqu parfois se sentir la cause de tous les malheurs du Monde. Mon fils a encore rat ses examens, je n ai jamais r ussi lui donner le gout des tudes Ma femme semble contrari e, j ai forc ment dit quelque chose de mal Mon p re fait une d pression, c est de ma faute, je n ai pas t la hauteur de ses attentes 9, La personnalisation : auto-flagellation 10, Les fausses obligations : masturbation Les r gles fix es de fa on arbitraire, les exigences rigides de soi-m me ou des autres favorisent volontiers l mergence de sentiments douloureux tels que la d ception, la frustration, la culpabilit ou la col re. Les je souhaiterais , j aurais pr f r laissent la place aux je dois , il faut . Il faut toujours aider ses amis, je ne peux donc pas refuser de lui pr ter de l argent Il est indispensable d tre appr ci de ses voisins, je ne dois donc pas leur faire de reproches quand ils font du bruit Apr s tout ce que j ai fait pour elle, comment ose-t-elle refuser de me confier sa voiture ?
La torture est lvnement le plus effroyable quun homme puisse garder du fond de soi La sacralit de l' tre humain Le tortionnaire Il sera bris de l int rieur car nous savons faire sans laisser de trace ; s il survit, jamais il n oubliera le prix de son audace Le cerveau traumatique Viol Autres
Quelques types de torture ou traitements cruels inhumains ou d gradants La torture blanche: brouillage des rep res: cagoule sur la t te pour brouiller les rep res de la victime Simulation d ex cution dans un cimeti re D tention au secret Isolement total / Obscurit totale etc. Le viol Autres: Les Privations de nourriture/ une alimentation impropre la consommation Imposer une victime boire ses urines et manger ses excr ments Condition de d tention inhumaine (les poux, les punaises, les intemp ries Meurtres maquill s en accidents de la voie publique Enl vement et disparition Les arrestations muscl es avec humiliation : la victime est d shabill e, nue, devant sa famille et la population avec uniquement un cale on, menott e aux poignets et aux chevilles. Les bastonnades avec des coups sur la t te jusqu l vanouissement de la victime
Les squelles physiques Surdit : gifles Troubles de la vision avec myopie, d formation de la vision, presbytie surtout ceux isol es pendant longtemps dans des cellules sombres: la lumi re du jour devient insupportable Des troubles de l orientation temporo spatiale dans les positions anti physiologiques Les C phal es, vertiges Les Douleurs diffuses avec asth nie physique Les Troubles m taboliques avec diab te, une Hypertension Tension Art rielle, des s quelles d accidents vasculaires c r braux Des Gastrites cause de la mauvaise alimentation Des d formations des membres avec position vicieuse, Impotence fonctionnelle des membres Dysfonction rectile cause du traumatisme par lectrocution et tirement sexuel Des complications neurologiques avec des troubles de la sensibilit au niveau de certaines parties de corps surtout de membres
Les gifles Onder Ozkalipci , MD, Associate Prof. of Forensic Medicine 16
Les gifles Onder Ozkalipci , MD, Associate Prof. of Forensic Medicine 17
KENCE VE KT MUAMELENN BELGELENDRLMES N ANATOMK ZMLER Onder Ozkalipci , MD, Associate Prof. of Forensic Medicine 20
Onder Ozkalipci , MD, Associate Prof. of Forensic Medicine 21
INTRODUCTION La torture ou les traitements cruels inhumains ou d gradants inflig s aux individus est actuellement reconnue dans ses dimensions m dicales, c est- -dire en tant que facteur de risque pour la sant surtout mentale. Elle est une des causes principales des traumatismes aigus. Si la violence physique ou sexuelle provoque des plaies et des contusions visibles, plus graves encore sont les blessures psychiques qui continuent se manifester longtemps apr s la cicatrisation des l sions physiques.
INTRODUCTION Elle constitue une agression contre les structures psychologiques et sociales de l individu. Elle vise briser non seulement l int grit physique de la victime mais aussi sa personnalit . Ainsi elle peut miner le fonctionnement et la coh sion de communaut s enti res. Le tortionnaire s applique d truire les liens qui rattachent la victime une famille et une communaut en tant qu tre humain porteur d espoirs et d aspirations pour l avenir, En d shumanisant sa victime, en brisant sa volont , il pervertit gravement les relations futures qui s tabliront entre la victime et son entourage.
Mme sans violence corporelle, les humiliations, menaces et les s questrations, les d tentions arbitraires, les garde- - vue dans les chambres de suret des commissariats et brigades de gendarmerie (ces actes qu on a tendance sous estimer) peuvent entra ner d importantes alt rations psychiques: le sujet perd confiance en lui-m me et peut aller jusqu n gliger sa sant .
Subjectivit: 2 individus dans la m me situation ont des r actions diff rentes face la torture Devant une victime il faut toujours tenir compte: des croyances ethniques, des coutumes pour mieux appr cier la torture subie par votre client De L impossibilit d en parler
Face un prsum survivant de torture, il faut: savoir d tecter les signes de souffrances le plus t t possible, ne rien n gliger, cr er une relation de confiance avec votre client Le type de victimes de torture: primaire et secondaire
Devant une victime, il faut : Evaluer ces violences Faire l examen clinique Constater les violences : les noter dans le dossier (sch ma ventuel/ Photos), faire un certificat m dical sans oublier l ITT et le garder dans le dossier
Attitude devant une victime? Oser poser les bonnes questions : avoir toujours en t te la compr hension de <<l impossibilit d en parler>> Cr er une relation de confiance et rassurer la victime Savoir gagner la confiance et surtout ne pas avoir de pr jug s ni d attitude moralisante qui culpabiliserait la victime
A noter Lorsqu une victime de s vices sexuels ne veut pas que ceux-ci soient divulgu s en raison des pressions socioculturelles ou pour des motifs personnels, le m decin charg de l examen, les enqu teurs et les tribunaux sont tenus de respecter l anonymat de l int ress . La confidentialit est respect e et la dignit de la victime pr serv e Sujets difficiles la compr hension de l impossibilit d en parler
Ractions de la victime Les types de victimes re ues : victimes primaires et victimes secondaires Mise en route de m canismes de d fense: lutter contre les angoisses Et pour se prot ger contre les motions qui sont le plus souvent insupportables pour la victime: tat dissociation salvatrice du cerveau cas de cette femme victime de viol collectif Mais si le traumatisme survient au moment o l individu est fragile psychologiquement, il d veloppe ce qu on appelle une bouff e d lirante
Diffrents aspects cliniques: Pathologies psychosomatiques: il somatise le plus souvent: C phal es rebelles aux antalgiques classiques Insomnies Sensations d touffement fr quentes Palpitations Pathologie simulant une affection cardiaque Affection gyn cologique avec une am norrh e secondaire etc. C est au cours de la PEC que le m decin g n raliste, demande un bilan paraclinique et ventuellement une valuation psychologique.
TABLEAUX CLINIQUES : Dissociation salvatrice: La victime est repli e sur elle-m me. Elle est isol e socialement et affectivement. Elle peut m me tre dans un tat de psychose : impossibilit pour quelqu un de raconter son traumatisme.
Doffice aprs un traumatisme lindividu culpabilise, ce qui permet de donner un sens son tat et c est un ph nom ne tout fait logique. Trois (3) tapes : Pourquoi il m a fait a ? (pas de r ponse) On r pond la place de son bourreau : il a bu, il tait drogu ou cause de l argent. Qu est ce que je faisais la bas ? Fait important: la victime ne se consid re pas malade, elle pense qu elle a v cu une situation donn e, qu elle la supporte depuis des ann es et a ne l emp che pas de vivre.
Au cours des premiers entretiens, la victime, voulant se d tacher de la situation angoissante, nous dira toujours qu elle ne pr sente aucun trouble pouvant justifier une prise en charge (tout cela pour montrer dans quelle situation psychologique se trouvent ces individus). Ce qu il faut signaler c est la m tamorphose de l identit de l individu, l ment tr s important dans le syndrome post traumatique : mort symboliquement
Les squelles psychologiques 3 types de s quelles : Le syndrome de stress post traumatique (les Flash-back, les Insomnies, les cauchemars, les reviviscences de l v nement traumatisant, les palpitations avec sensation d touffement avec crises d angoisse, les peurs inexpliqu es, les crises de larmes lors de l entretien avec des menaces contre les personnes responsables de cette situation) Les changements de personnalit avec nervosit , ranc urs, et difficult s d adaptation sociale pouvant entrainer une rupture familiale et sociale Les d pressions post traumatiques: isolement socio affectif, absence d initiative et de motivation, indiff rence totale, rumination douloureuse, projection sombre sur l avenir avec des id es d autolyse
Recommandations/ Conduite tenir Face une telle situation il faut permettre la victime de se reconstruire et de faire face aux difficult s existentielles: Une prise en charge m dicale et chirurgicaledes victimes surtout ceux qui pr sentent des pathologies lourdes. Un renforcement des capacit s de r siliencepar : Une psychoth rapie de soutien avec accompagnement psychologique Des s ances de th rapie de relaxation psychom trique Des s ances de th rapies comportementales et cognitives Et dans la mesure du possible des th rapies de groupes La mise en place de mesures de mitigation
Le renforcement des capacits de rsilience par: L coute : toujours am nager un espace d coute avec accompagnement psychologique en vitant les attitudes moralisantes La psychoth rapie de soutien Th rapie Comportementale et Cognitive Les s ances de relaxation psychom trique La th rapie de groupe permettant en m me temps de partager les exp riences v cues entre victimes. Le jeu de r le serait int ressant chez les enfants.
La mise en place de mesures de mitigation Indemnisation des victimes par une activit g n ratrice de revenus Identification des victimes secondaires et leur prise en charge par un accompagnement psychologique
QUESTION ELFE: permet la victime de se focaliser sur sa souffrance et de trouver les moyens de faire face Qcomme question: qu est ce qui s est pass ? Cette question permet d tre en connexion avec la victime E : comme motion ; quelle motion as-tu ressentie?Permet d appr cier les motions de la victime L : le plus difficile : qu est ce qui a t le plus difficile? (question magique, focalise l esprit de celui qui souffre) F : faire face ; qu est-ce qui vous aide faire face? E :empathie : c est l interactionc est- -dire exprimer l autre ce que vous ressentez
LES RESULTATS ATTENDUS : Au bout de 3 4 s ances, les victimes taient distance de leur traumatisme, elles parvenaient en parler sans agressivit , les motions tant moins accentu es
Dans le domaine de la prvention de la torture il ne faut ignorer l tat psychologique des personnes qui prennent en charges ces victimes et les agents d ex cution des lois surtout ceux de l administration p nitentiaire qui vivent plus longtemps avec les personnes priv es de libert : ils ont besoin d une prise en charge psychologique apr s valuation,
Je vous remercie de votre aimable attention