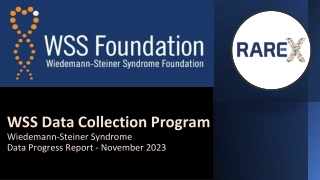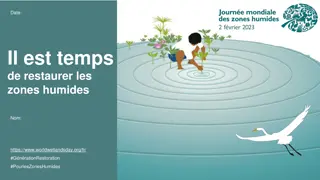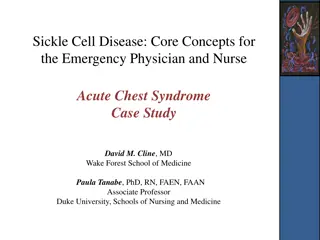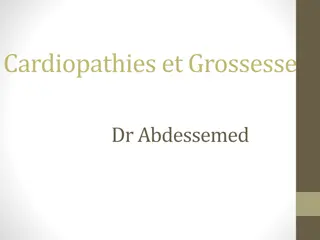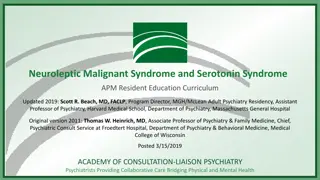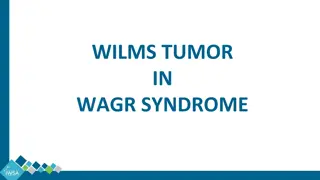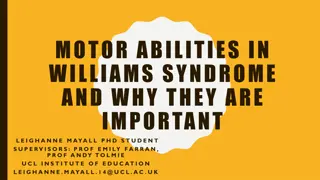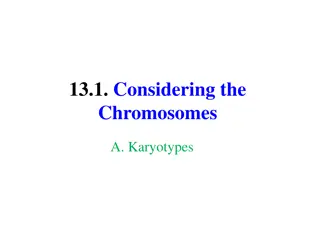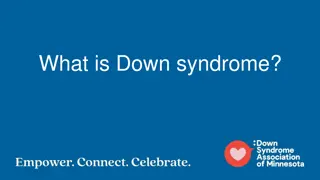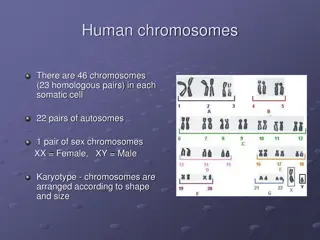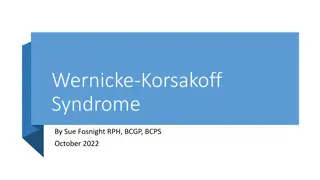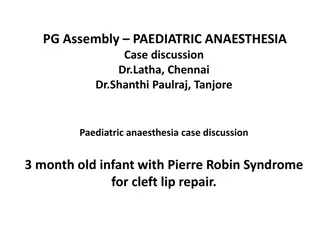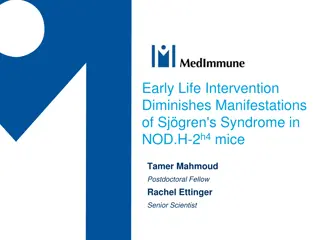Understanding Asphyxiation: Mechanisms, Diagnosis, and Legal Implications
Delve into the complex world of asphyxiation, exploring its physiological mechanisms, medical-legal diagnosis challenges, and classification of mechanical asphyxias like strangulation and suffocation.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Le syndrome asphyxique les asphyxie m caniques Strangulation, pendaison, suffocation et submersion 1
Plan Introduction M canismes physiopathologiques Classification des asphyxies m caniques Diagnostic m dico-l gal Diagnostic tiologique Conclusion 2
Introduction L asphyxie, terme grec signifiant l absence de pulsation , correspond la privation en oxyg ne d un organisme entrainant ainsi une diminution du taux d oxyg ne dans le sang (hypox mie) puis dans les tissus (hypoxie ou anoxie) puis la mort cellulaire (n crose) lorsque cette privation est prolong e. Le diagnostic d une asphyxie en m decine l gale est extr mement difficile faire puisqu il n existe pas de signes pathognomoniques. Il repose sur un faisceau d l ments notamment une autopsie exhaustive liminant toute autre cause de la mort. 3
Mcanismesphysiopathologiques Il existe trois m canismes diff rents pouvant aboutir la diminution de l oxyg nation tissulaire. Les asphyxies atmosph riques : Secondaires la rar faction de l oxyg ne dans l environnement. Les asphyxies m caniques : correspondant l atteinte de la m canique ventilatoire. Les asphyxies provoqu es par l alt ration d un ou de plusieurs effecteurs des m canismes ventilatoires et de l h mostase. En pathologie m dico-l gale, les asphyxies m caniques sont de loin la forme la plus fr quemment rencontr e. 4
Un syndrome asphyxique se manifeste gnralement par des manifestations h morragiques qui peuvent tre constat es lors: l examen externe: Cyanose Ecchymose sous-conjonctivales Piquet h morragique au niveau de la face, du cou et des paules. l examen interne: Congestion des visc res Sang fluide et noir tre. 5
Classification des asphyxies mcaniques La strangulation La pendaison La suffocation La submersion Les compressions thoraciques et thoraco-abdominales. 7
Diagnostic mdico-lgal (1) Il repose sur plusieurs l ments qui seront r colt s sur diff rents temps La lev e de corps L enqu te pr liminaire L autopsie m dicol gale Les examens compl mentaires 8
Diagnostic mdico-lgal (2) L enqu te pr liminaire : men e par les agents de la police judiciaire aupr s des proches de la victimes. 9
Diagnostic mdico-lgal (3) L autopsie m dico-l gale Les examens compl mentaires Examen externe Examen interne La cyanose Les coulements Congestion visc rale L sions pulmonaires Histologie La toxicologie 10
Strangulation On distingue ainsi : Elle correspond la compression active de la r gion cervicale provoqu e soit par un lien, soit par les mains d un agresseur enserr es autour du cou de la victime, soit par son avant-bras La strangulation manuelle La strangulation au lien. La strangulation M canismes physiopathologiques La compression laryng e : responsable des ph nom nes asphyxiques. La compression vasculaire : qui correspond la striction des vaisseaux jugulo-carotidiens dont r sulte un obstacle au retour veineux enc phalique et une disparition du flux sanguin art riel entrainant une anoxie c r brale qui serait l origine d une perte de conscience rapide. La compression nerveuse : le d c s survient suite un r flexe d inhibition entrainant une syncope soit par stimulation des baror cepteurs cervicaux ou par compression des nerfs vagues. 12
La strangulation Les l sions cutan es cervicales sont de deux types : Des ecchymoses si geant au niveau des r gions ant rolat rales du cou, elles ont parfois un aspect digitiforme. Des plaies rosives qui sont provoqu es par les ongles de l agresseur. La strangulation la main Le syndrome asphyxique est inconstant, il peut manquer si la mort survient suite une inhibition reflexe comme il peut tre intense si le d c s est li une asphyxie. Les l sions internes correspondent : Des suffusions h morragiques voire de v ritables h matomes des tissus sous-cutan s et des muscles, elles peuvent exister alors qu aucune trace n est visible sur la peau. Des h morragies autours des vaisseaux cervicaux. Des fractures de l on hyo de, du cartilage thyro de et crico de. Ces l sions laryng es sont plus fr quentes que dans les pendaisons. Il faut insister sur l importance des signes de lutte qu il faut imp rativement rechercher au niveau de la r gion p ribuccale, des zones de d fense, des ongles et des organes g nitaux externes. 13
La strangulation La l sion cutan e type est un sillon cervical habituellement complet, horizontal, unique, situ l tage sous-hyo dien et peu profond. Le syndrome asphyxique est souvent franc. La strangulation au lien Comme dans les strangulations manuelles, la recherche des signes de lutte est imp rative. Les circonstances m dico-l gales : La strangulation qu elle soit manuelle ou au lien est souvent l uvre d un acte criminel, elle est rarement accidentelle et survient chez les enfants. 14
La pendaison On distingue : La pendaison compl te, lorsqu aucune partie du corps ne repose sur un plan horizontal. La pendaison incompl te, lorsqu une partie du corps repose sur un plan horizontal. La pendaison est dite typique lorsque le n ud du lien est post rieur et m dian. Dans les autres cas, elle est dites atypique. Elle correspond la compression cervicale passive provoqu e par l action du poids du corps sue le lien enserrant la r gion cervicale. La pendaison M canismes physiopathologiques sont comme dans la strangulation : La compression laryng e La compression vasculaire La compression nerveuse Auxquelles peuvent s ajouter les traumatismes vert braux et m dullaires qui se voient lors de pr cipitation associ e la pendaison et lorsque le n ud est ant rieur sous-mentonnier. 15
Les constatations mdico-lgales (1) Les l sions cutan es constat es sont de nature traumatique en rapport avec la compression provoqu e par le lien et la traction li e la suspension. Il s agit le plus souvent d un sillon cervical unique, situ au- dessus du cartilage thyro de, profond, oblique de bas en haut, du plein de l anse vers le n ud. Ce sillon est g n ralement simple mais il peut tre complexe lorsque le lien effectue plusieurs tours autour du cou ou si les mains sont interpos es entre le lien et la peau. D autres l sions types abrasions pidermiques et plaies superficielles peuvent tre observ es au niveau de l extr mit c phalique et au niveau des membres. 16
Les constatations mdico-lgales (2) Les l sions internes sont : Des suffusions h morragiques sous-cutan es et musculaires int ressant surtout les insertions sternales et claviculaires des muscles du cou. Des manchons ecchymotiques autour des vaisseaux. Les signes de Friedberg (d collement de l intima par rapport la m dia carotidienne) et d Amussat (ruptures transversales de l intima des carotides) sont rares et ne sont pas pathognomoniques. Les fractures de l appareil laryng . Les l sions ost o-m dullaires. 17
Les circonstances mdico-lgales (3) La pendaison est dans la plupart des cas en rapport avec un acte suicidaire et le principal probl me m dicol gal est de faire la diff rence entre une pendaison vitale suicidaire et une suspension post-mortem maquillant un homicide. 18
La suffocation (1) Elle correspond une asphyxie provoqu e par l obstacle la p n tration de l air dans les voies a riennes, le plus souvent sup rieures. D finition 19
La suffocation (2) Selon la localisation de cet obstacle on distingue : 1) Les obstructions des orifices respiratoires de la face, l obstacle se trouvant l ext rieur de l organisme. Elles sont souvent accidentelles surtout chez nourrissons. Elles peuvent tre criminelles et cette nature criminelle se d termine sur quatre points : Affirmer la suffocation comme cause de d c s en recherchant les l ments constitutifs du syndrome asphyxique et surtout en liminant les autres causes de d c s. D terminer la nature de l agent suffocant en cherchant des traces de cet agent sur la victime. Affirmer l utilisation de la force ou d une contention physique ou chimique pour maitriser la victime. L intentionnalit ou le mobile de l homicide. 20
La suffocation (3) 2) l inhalation de corps trangers Le diagnostic repose sur les t moignages mais surtout sur la mise en vidence du corps tranger lors de l autopsie. 3) les l sions intrins ques des voies a riennes sup rieures : Il s agit de toutes les pathologies inflammatoires, infectieuses ou tumorales obstruant ces voies. 4) l inhalation d agents pulv rulents : C est inhalation de substances constitu es de fines particules pouvant saturer l air c est l enfouissement. L air peut tre remplac aussi par une substance visqueuse, on parlera alors d ensevelissement ou d enlisement. 21
La Submersion (1) La submersion est une asphyxie m canique aigue, la mort survient par inondation des voies respiratoires par l eau ou par syncope dans l eau, cr ant rapidement des l sions c r brales irr versibles. D finition Accidents : c est une grande cause de mort surtout pendant la saison estivale : mer, rivi re, laque Suicide : la plus fr quente apr s les pendaisons, on peut retrouver une certaine mise en sc ne : pieds et mains li s et attach s un objet lourd, v tements pli s soigneusement sur la plage. Homicide ou crime : difficile affirmer, donc pr sence des l sions de violence qui sont l origine de la mort, mode d infanticide est actuellement rare. Circonstances m dico-l gales 22
La Submersion (2) Diff rencier entre une submersion et de l immersion du cadavre constitue un des grands probl mes m dico-l gaux. 23
Les constatations mdico-lgales (1) a) Examen externe Noy frai Cyanose de la face et des ongles chez le noy bleu suite une inondation des voies respiratoires Pas de cyanose chez le noy blanc suite une syncope. Champignon de mousse au niveau de la bouche et du nez : m lange d air, d eau et de mucus elle constitue un signe important de submersion vitalemais n est pas pathognomonique. Peau ans rine (chair de poule) : due la contraction des muscles horripilateurs Mac ration des mains et des pieds Lividit s p les Tonicit du globe oculaire : yeux du poisson 24
Les constatations mdico-lgales (2) Pour le cadavre qui a s journ : l sion de charriage : L sions cutan es qui sont dues au frottement au niveau du fond marin, les h lices de bateau, animaux aquatiques. Elles si gent au niveau: de la face dorsale des mains, du front et genou et des pieds chez l homme , des fesses, occiput et talent chez la femme due la r partition des graisses Ce sont des l sions ne pr sentant pas un caract re vital (post- mortem) 25
Les constatations mdico-lgales (3) Noy putr fi Apr s un long s jour dans l eau si le cadavre est rep ch , la putr faction est rapide Odeur naus abonde, couleur verd tre, dilatation de la face qui n est plus identifiable, gonflement du tronc et de scrotum, phlyct nes et d collement de l piderme. 26
Les constatations mdico-lgales (4) b) Autopsie A l ouverture : aspect lav des visc res. Sang fluide, poumon hyper hydro a rique, distendus avec empreintes costales Algue, la vase, du sable au niveau des bronches. Larynx et thyro de congestive. Estomac contient de l eau avec suspension d algue, de vase, de sable. 27
Les constatations mdico-lgales (5) c) Examen compl mentaire La recherche de diatom es Algues monocellulaires qui r sistent la putr faction, Retrouv es au niveau de la moelle osseuse, foie, poumon et c ur. 28
Les constatations mdico-lgales (6) c) Probl mes m dico-l gaux : Identification: Objets retrouv s, formule dentaire, empreinte digitale apr s traitement de l piderme (doigts des gants), tude ADN. Estimation de la dur e de s jour dans l eau : Etat de putr faction. D termination de la forme m dico-l gale de la noyade : Donn es des enqu tes, de la lev e de corps et de l autopsie. 29
Conclusion Le diagnostic d asphyxie doit tre pos avec la plus grande prudence et ne doit jamais tre retenu sur un seul signe. Les donn es de la lev e de corps, de l enqu te pr liminaire et de l autopsie m dicol gales sont toutes importantes les unes que les autres et doivent tre r colt es avec soins pour pouvoir retenir l asphyxie comme cause de d c s. 30

![❤[PDF]⚡ Zee Zee Does It Anyway!: A Story about down Syndrome and Determination](/thumb/20462/pdf-zee-zee-does-it-anyway-a-story-about-down-syndrome-and-determination.jpg)