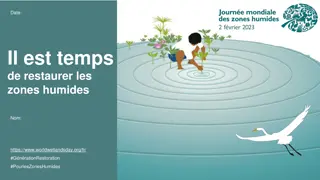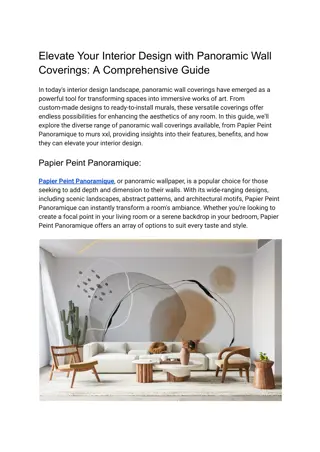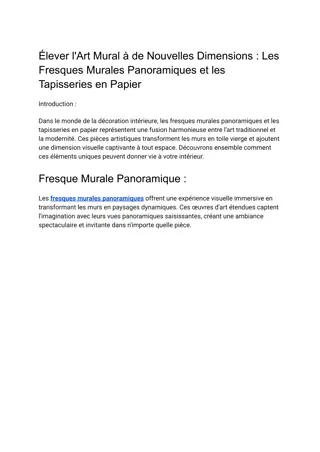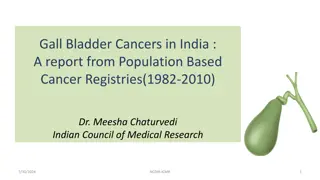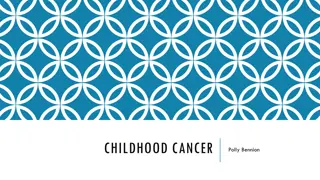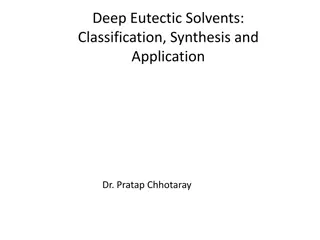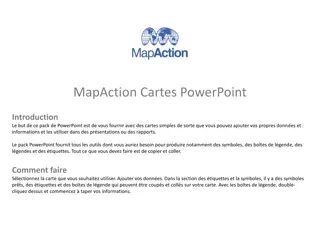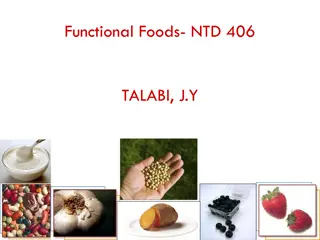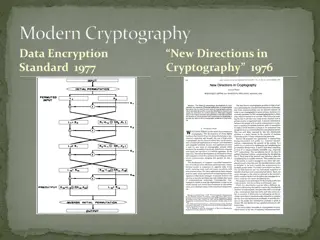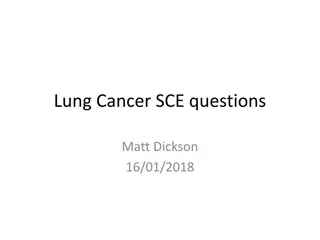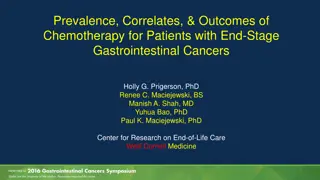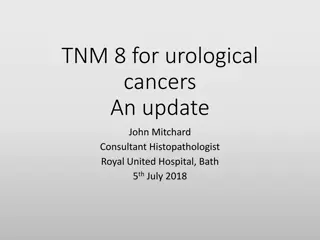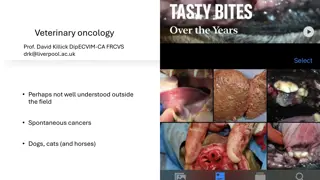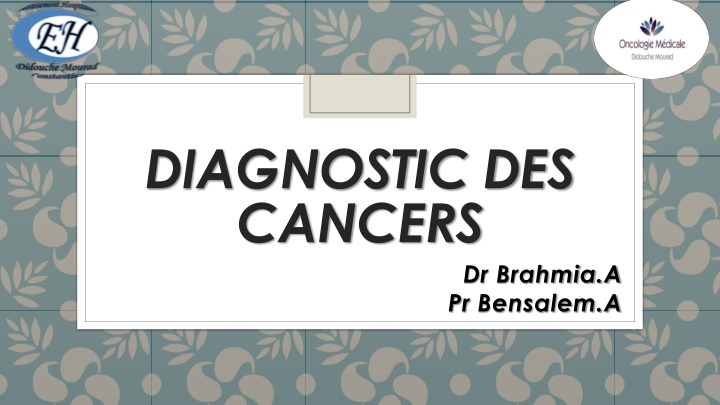
Understanding Cancer Diagnosis: Signs, Investigations, and Staging
Explore the diagnostic process of cancer, focusing on clinical signs, paraclinical investigations, tumor tissue sampling, classification, and staging. Uncover the significance of recognizing key diagnostic markers and predictors in oncology to enhance patient care and outcomes.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
DIAGNOSTIC DES CANCERS Dr Brahmia.A Pr Bensalem.A
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Diagnostic des cancers : signes d appel et investigations paracliniques ; caract risation du stade ; pronostic D crire les principes du raisonnement diagnostique en canc rologie Expliquer les bases des classifications qui ont une incidence pronostique Conna tre les principaux marqueurs diagnostiques et pr dictifs des cancers
PLANS DU COURS 1. Signes d appel Clinique . Paraclinique 2. Diagnostic 2.1. Obtention d un chantillon de tissu tumoral 2.2. Analyse anatomo-cytopathologique 3. Examens paracliniques : bilans d extension et pr -th rapeutique 3.1. Bilan d extension 3.2. Bilan pr -th rapeutique : bas sur le terrain, la strat gie th rapeutique envisag e, les complications suspect es 4. classification et stadification des cancers 5. Conclusion
introduction Le cancer est une pathologie fr quente potentiellement grave dont les circonstances de d couverte sont le plus souvent une symptomatologie vocatrice ou une d couverte fortuite chez un patient explor pour une autre raison ou l occasion d un examen de d pistage. Une fois le cancer est suspect des investigations cliniques , paracliniques doivent tre organis es dans un but diagnostic, pronostique et pr -th rapeutique. L ensemble de ces explorations tant li es les unes aux autres
1- signes dappel De multiples signes peuvent et doivent faire voquer le diagnostic de cancer. La pr sence de ces signes dits d appel devra faire rechercher : un terrain pr disposant : exposition professionnelle ou personnelle (tabagisme actif ou passif, consommation d alcool, infections chroniques, etc.) des agents canc rig nes ; ant c dents personnels ou familiaux de cancer pouvant faire suspecter un syndrome de pr disposition g n tique au cancer. d autres signes cliniques, biologiques ou d imagerie ; une association de signes renforce la pr somption de cancer et, par cons quent, l indication d investigations compl mentaires vis e diagnostique. Les signes cliniques, biologiques et d imagerie retrouv s dans le cadre du bilan peuvent tre regroup s en 3 grandes entit s syndromiques : syndrome cachectique et inflammatoire : ensemble des signes en lien avec une alt ration de l tat g n ral et un tat inflammatoire li s au cancer ; syndrome tumoral : ensemble des signes cliniques, radiologiques ou biologiques li s la pr sence d une masse tumorale primitive ou de m tastases et ses cons quences locor gionales (compression, envahissement) ; syndrome paran oplasique : ensemble des signes li s une tumeur fonctionnelle s cr tante ou une maladie auto-immune associ e au cancer
1-1 CLINIQUE Signes d appel Par Sd g n raux paran oplasique syst mes
1-1-1 signes gnraux dappel Alt ration de l tat g n ral : asth nie, amaigrissement, anorexie, sarcop nie, d nutrition Fi vre et sueurs nocturnes 1-1-2 signes d appel par syst me Vasculaire : TVP, embolie pulmonaire ( tm / coagulopathie) .. Neurologique : S neurologiques centraux focaux, att centrale des paires cr niennes S de compression m dullaire .. ORL : dysphonie, dysphagie, dlr au niveau de la sph re ORL, ulc ration .. Respiratoire :toux, h moptysie, dyspn e, dlr Thoracique Digestif : dlr abdominale ,trouble du transit , Sd occlusif, saignement digestif .. Urologique : h maturie, orchidom galie, dysfonction rectile .. Rhumatologique : dlr osseuses ( m canique/ inflammatoire) parfois r fractaire aux antalgiques palier 3 , tum faction, fracture spontan e ..
Dermatologique : mlanome ( ABCDE) lsion asymtrique, bord irrgulier, couleur inhomogne, diamtre en augmentation volution rapide. grain de beaut , ulc ration, nodules sous cutan s .. H matologique : ADP, SPM, signes h morragiques surtout purpuriques . 1-1-3 syndrome paran oplasique sont des manifestations syst miques, distance du cancer, qui ne sont pas dus la pr sence de m tastases mais qui sont sch matiquement li s la production tumorale d une substance pseudo- hormonale ou des ph nom nes auto-immuns en rapport avec une r action immunitaire anti-tumorale. peuvent tre regroup s en 2 grandes cat gories : endocrinologique (syndrome s cr tant) et dysimmunitaire La maladie veineuse thrombo-embolique est le plus fr quent des syndromes paran oplasiques. Elle est particuli rement fr quente dans les cancers du pancr as et de l estomac. Les syndromes paran oplasiques li s une auto-immunit sont rares, mais peuvent tre inauguraux de n importe quel type de cancer et m me parfois pr c der leur d tection clinique, radiologique ou m tabolique. ( dermatomyosite et polymyosite fr quentes dans les kc du poumon, sein , ovaire) Les syndromes paran oplasiques li s un syndrome s cr tant sont fr quemment associ s aux tumeurs neuroendocrines dont les cancers bronchiques petites cellules ou aux tumeurs endocrines bien diff renci es (notamment pancr atiques comme l insulinome, le gastrinome, tumeur carcino de du gr le, cancer thyro dien comme le carcinome m dullaire, ou surr nalien comme le ph ochromocytome).
1-2 PARACLINIQUE 1-2-1 Biologie : Les analyses biologiques peuvent amener suspecter un cancer ou renforcer la suspicion de cancer en cas de signes cliniques associ s : signes biologiques li s un syndrome cachectique et inflammatoire : d nutrition (baisse de l albumine et de la pr albumine), l vation de la CRP, et du fibrinog ne ; signes biologiques li s un syndrome de masse : perturbations de fonctions d organe, principalement h matologique, r nale et h patique, l vation des LDH, hypercalc mie (par m tastase osseuse), syndrome de lyse tumorale spontan e biologique ; signes biologiques li s un syndrome paran oplasique : hypercalc mie (par s cr tion de PTH-rp), hyponatr mie (s cr tion inappropri e d ADH), dosages hormonaux anormaux ou r sultats vocateurs d autoimmunit .
Les signes dappels pourront ainsi tre : h matologiques : an mie microcytaire ferriprive sur saignement chronique, lymphop nie (de d nutrition ou li e un envahissement m dullaire), hyperleucocytose et thrombocyt mie secondaire une inflammation chronique, pancytop nie d origine centrale par envahissement m dullaire, an mie h molytique m canique et thrombop nie dans le cadre d une microangiopathie thrombotique. biochimiques : ionogramme sanguin : hyponatr mie, hypercalc mie, hyperphosphor mie ; fonction r nale : l vation de la cr atinin mie (obstacle sur les voies urinaires avec ou sans infection urinaire microangiopathie thrombotique, atteinte glom rulaire) ; fonction h patique : cholestase ict rique ou anict rique, cytolyse, diminution des facteurs de coagulation, hypoglyc mie en cas d envahissement h patique massif ou d insuffisance h patocellulaire ; dans le cas des h mopathies : anomalies quantitative ou qualitative des lign es sanguines comme pr sence de my l mie, de blastes, an mie, neutrop nie, lymphop nie, thrombop nie centrale (aplasie), polyglobulie (maladie de Vaquez), thrombocyt mie, hyperlymphocytose, hyperleucocytos
les marqueurs tumoraux : Le dosage des marqueurs tumoraux permet d identifier dans le sang, les urines ou certains tissus de l organisme, diff rentes substances pouvant indiquer la pr sence d un cancer. Cet examen peut s av rer utile diff rentes tapes de la prise en charge : du diagnostic du cancer l valuation de l efficacit du traitement, ou encore lors du suivi des patients. Certains marqueurs tumoraux sont sp cifiques d'un seul type de cancer, d autres sont associ s plusieurs types diff rents de cancer. Le dosage des marqueurs tumoraux peut aussi tre lev lors d affections non canc reuses. l vation du PSA dans le cadre du d pistage du cancer de la prostate ; l vation de l alphaf toprot ine, qui doit tre r guli rement dos e chez les patients cirrhotiques, pour d pister les h patocarcinomes ; lectrophor se des prot ines plasmatiques ou urinaires et immunofixation (my lome multiple ou autres h mopathies lympho des) ; les autres marqueurs tumoraux ne seront dos s que dans des situations o un cancer est d j suspect , vis e de suivi ou, pour certains, titre d aide au diagnostic conform ment aux recommandations
1-2-2 Imagerie Certains signes l imagerie (radiologie ou endoscopie) peuvent faire voquer le diagnostic de cancer, principalement par la mise en vidence d un syndrome de masse(s). Il peut s agir d examens r alis s pour un tableau clinique vocateur de cancer : signes cliniques en lien avec un syndrome de masse : examens guid s par la clinique (mammographie en cas de masse mammaire, radiographie ou scanner thoracique en cas de symptomatologie respiratoire, endoscopie digestive et/ou imagerie abdominale en cas de sympt mes digestifs, endoscopie ORL en cas de signes ORL, signes cliniques en lien avec un syndrome de cachexie ou une hyperthermie isol es : examens d imagerie larges, non orient s par la clinique (scanner thoraco-abdomino-pelvien, TAP, ou radiographie thoracique signes cliniques en lien avec un syndrome paran oplasique : examens d imagerie larges, voire de m decine nucl aire (scintigraphie, TEP-TDM), recherchant pr f rentiellement une pathologie tumorale d origine pulmonaire ou mammaire (par argument de fr quence) ; un d pistage organis ou individuel du cancer (mammographie, coloscopie, colposcopie). une autre raison, non rattach e une suspicion de cancer (d couverte fortuite, frottis et colposcopie).
2- Diagnostic Le diagnostic de cancer est pos par l examen histologique, ou cytologique, d un chantillon de tissu tumoral 2.1. Obtention d un chantillon de tissu tumoral La preuve anatomo-pathologique peut tre apport e partir d un chantillon de la tumeur suppos e primitive ou d une l sion m tastatique mise en vidence lors des investigations cliniques et paracliniques initiales. Le choix de l examen invasif vis e diagnostique (ponction cytologique, biopsie, pi ce op ratoire) se fera en fonction de la balance b n fice / risque des diff rents examens possibles, d pendant ainsi de : l accessibilit des diff rents sites tumoraux et Choisir la biopsie la moins risqu e ! les biopsies permettent de ramener plus de tissu tumoral que les ponctions cytologiques. la rentabilit mod r e des biopsies osseuses avec difficult s faire des analyses mol culaires sur le tissu osseux tumoral avec n cessit de d calcification du fragment biopsique
2.2. Analyse anatomo-cytopathologique 2.2.1. Questions pos es L examen anatomo-cytopathologique de l chantillon tumoral permet de r pondre des questions majeures : tumeur b nigne / maligne ; tissu d origine du cancer : carcinome ( pith lium) / m lanome / sarcome (tissu conjonctif) / neurologique (gliome, astrocytome ) / my lome, lymphome et leuc mie (tissu h matopo tique) / tumeur germinale et embryonnaire . Dans certains cas il est difficile de pr ciser le diagnostic de l organe d origine du cancer qui peut parfois tre guid par des marquages immunohistochimiques (cytok ratine, alphafoetoprot ine, r cepteurs hormonaux ) ;
valuation pronostique : degr d invasion au travers des diff rentes couches du tissu atteint pr sence d emboles vasculaires, d engainements p rinerveux degr de diff renciation (perte des caract ristiques morphologiques du tissu d origine, au niveau cytologique et histologique) activit mitotique pour certaines tumeurs, des grades histopronostiques sont valid s ; pr sence de marqueurs anatomo-pathologiques pronostiques ou pr dictifs de r ponse un traitement sp cifique : surexpression de HER2, des r cepteurs hormonaux dans les cancers du sein, par exemple ; parfois anomalies du caryotype, pr sence d anomalies g n tiques somatiques (= uniquement dans les cellules tumorales) qui peuvent avoir une valeur pronostique et guider la th rapeutique (exemple : pr sence d une mutation EGFR dans les cancers bronchiques qui est pr dictive de la r ponse aux inhibiteurs de la tyrosine kinase de l EGFR).
2.2.2. Lexamen cytopathologique peut tre r alis e partir de cellules isol es pr lev es dans des s cr tions naturelles (FCV, expectorations) ou au cours de ponction l aiguille fine d un liquide (pleur sie) ascite ; liquide c phalo-rachidien) ou dans un nodule plein (sein, foie). Un examen cytologique la recherche d un cancer n a de valeur que positif L affirmation du caract re malin des cellules repose sur l existence d anomalies : nucl aires : anisocaryose, hyperchromatisme, augmentation du nombre de mitoses et mitoses anormales ; cytoplasmiques : anisocytose, augmentation du rapport nucl o-cytoplasmique. Les caract ristiques de la tumeur telles que son type histologique, son degr de diff renciation, ne peuvent tre appr ci es sur la cytologie
2.2.3. Lexamen histopathologique L examen histopathologique, partir d un chantillon tumoral au minimum biopsique permet d tudier les anomalies cytologiques et galement les anomalies de l architecture du tissu tumoral (degr d invasion, degr de diff renciation, vascularisation). Sa valeur pr dictive n gative est sup rieure celle de l examen cytologique. L obtention de tissu tumoral est requise pour faire un diagnostic histologique, mais galement pour la plupart des cancers, faire des analyses la recherche d anomalies mol culaires qui aideront le choix des traitements. En effet, il est alors possible d extraire de l ADN tumoral partir des cellules tumorales de la biopsie ou de la pi ce chirurgicale, qui servira ensuite tablir le profil mol culaire du cancer en fonction du primitif et du stade de la maladie
3. Examens paracliniques : bilans dextension et pr -th rapeutique Une fois le diagnostic de malignit tabli ou en cas de suspicion tr s forte de cancer des examens paracliniques sont prescrits avec deux objectifs : valuer l extension de la maladie afin de diff rencier une situation de curabilit (objectif de gu rison du cancer) et une situation d incurabilit aussi appel e palliative ; valuer le terrain, la gravit des comorbidit s, les ventuelles complications du cancer afin de d terminer les traitements envisageables lors d un bilan dit pr -th rapeutique
3.1. Bilan dextension 3.1.1. Au stade localis le bilan d extension doit tre adapt au cancer primitif, au type histologique, et l valuation pronostique initiale qui en d coule. Il comprend au minimum un bilan d extension loco-r gionale pour d terminer le stade clinico-radiologique et les possibilit s de traitements qui peut tre compl t par un bilan d extension distance Ce bilan d extension peut tre guid par l application de recommandations (inter)nationales. Qui est adapt l tat g n ral du patient et aux signes cliniques retrouv s. Une alt ration de l tat g n ral oriente vers une tumeur avanc e et le scanner thoraco-abdomino-pelvien Des douleurs osseuses intenses orienteront vers des localisations osseuses qui devront tre explor es par une imagerie centr e sur les zones douloureuses. Le bilan paraclinique doit galement prendre en compte le terrain sur lequel s est d velopp e la maladie canc reuse. Ainsi, pour les carcinomes pidermo des des voies a ro-digestives sup rieures (VADS), la probabilit que le patient pr sente un cancer synchrone du fait du terrain (second cancer des VADS, cancer du poumon) est de l ordre de 10-15 %. Aussi, le bilan d extension local (scanner cervico-facial et IRM du massif facial) est compl t par un scanner thoracique en coupes fines (recherche d un primitif bronchique synchrone) et une pan-endoscopie des VADS
Trois exemples sont donns ci-dessous pour illustrer le choix du bilan dextension radiologique en fonction de l valuation pronostique initiale
3-1-2 en cas de maladie mtastatique avre ou suspecte le traitement est la plupart du temps syst mique. Si maladie oligo-m tastatique dans certains cancers (cancer colo-rectal , rein),le bilan d'extension est important pour discuter la strat gie. il sert principalement avoir une imagerie de r f rence initiale et choisir des cibles radiologiques. L volution de ces cibles sera suivie sur les scanners ult rieurs et permettra de d terminer l efficacit des traitements. Dans la plupart des cancers, l examen de r f rence est le scanner thoraco-abdomino- pelvien Les reste des examens sont demand s en fonction des signes d appel ( IRM c r brale, scintigraphie osseuse ..)
3.2. Bilan pr-thrapeutique : bas sur le terrain, la strat gie th rapeutique envisag e, les complications suspect es vise valuer le terrain, les comorbidit s et les complications ventuelles du cancer. Son objectif est de d terminer si le patient est capable de recevoir les traitements recommand s. 3.2.1. Bilan pr -th rapeutique clinique L tat g n ral, valu par le performance status (PS selon OMS / ECOG) est corr l au pronostic dans toutes les maladies oncologiques
Certaines interventions chirurgicales lourdes , ainsi que la radio-chimioth rapie ou certaines polychimioth rapies ne sont possibles qu en cas de bon tat g n ral (performance status de 0 2). Au-del de PS3, en cas de maladie incurable, il est habituel d arr ter les traitements sp cifiques du fait du risque de toxicit et de d c s moyen ou court terme. Cas particulier : valuation oncog riatrique globale Les patients g s atteints de cancer pr sentent des sp cificit s li es en particulier leur comordidit s, aux syndromes g riatriques ventuellement associ s. Apr s 70 ans, il est souhaitable que les patients soient valu s par un g riatre sp cialis afin de d terminer si les traitements sont envisageables et/ou de les adapter pour en faciliter la tol rance
3.2.2. Bilan pr-thrapeutique paraclinique 3.2.2.1. Biologie Classiquement, le bilan pr -th rapeutique biologique value les fonctions r nale, h patique et h matologique. Il recherche aussi les anomalies li es au cancer, telles que l hypercalc mie ou les cons quences de la d nutrition. num ration formule sanguine, plaquette, RAI + groupe Rh sus si risque transfusionnel ionogramme, ur e, cr atinine (avec valuation du d bit de filtration glom rulaire), calc mie ; ASAT, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale et conjugu e, LDH h mostase : TP, TCA, fibrinog ne surtout si chirurgie, maladie h matologique ou insuffisance h patocellulaire suspect e ; bilan nutritionnel : albumine, pr albumine ; bilan inflammatoire : CRP, ferritin mie au cas par cas ; bilan infectieux : s rologies VIH, VHB, VHC selon le type de cancer et le terrain.
3.2.2.2. Imagerie Le bilan d imagerie pr -th rapeutique est le bilan d extension 3.2.2.3. Fonctionnel lectrocardiogramme. Echocardiographie En cas de chirurgie et de radioth rapie thoraciques, une preuve fonctionnelle respiratoire avec gazom trie art rielle en cas de chirurgie ou radioth rapie thoracique
4- classification et stadification des cancers notion de classification TNM, notion de stade et corr lation avec le pronostic La classification de la tumeur doit tre effectu e syst matiquement pour adapter au mieux le traitement et viter les traitements inutiles La classification TNM est internationale. et r guli rement renouvel e. Elle est bas e sur le degr d extension de la tumeur primitive l envahissement ganglionnaire loco-r gional l atteinte m tastatique distance
conclusion La d marche diagnostique devant une maladie tumorale est fondamentale, que ce soit pour le patient ou pour la prise en charge th rapeutique venir. Elle permet d valuer le retentissement de la pathologie tumorale sur diff rents niveaux, clinique, biologique, et en imagerie. Guid par les donn es de l examen et de l interrogatoire initiaux le m decin doit proposer la fois un bilan d extension adapt la gravit de la maladie et un bilan pr -th rapeutique. Le diagnostic de certitude est anatomo-pathologique, soit par une biopsie, soit directement par voie chirurgicale souvent compl t par une analyse mol culaire L ensemble de ces donn es permet de pr ciser le pronostic du patient et de proposer une strat gie th rapeutique adapt e, conforme internationales aux recommandations nationales et