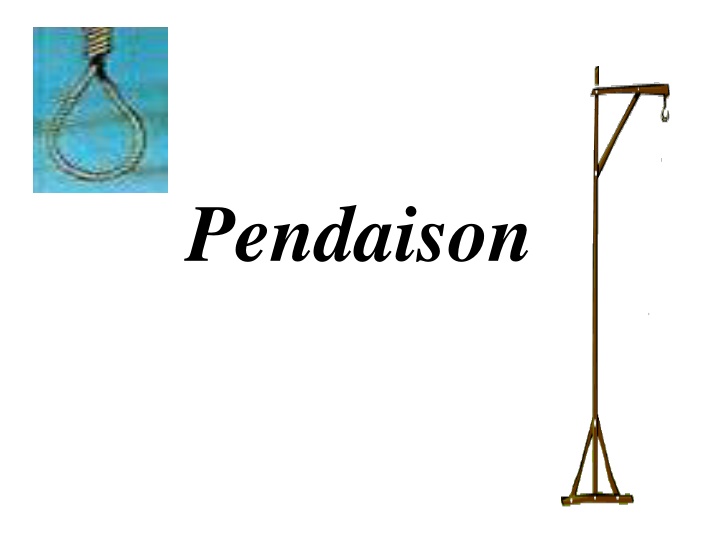
Understanding Different Aspects of Hanging
Learn about the various modes of hanging, the physiopathology behind it, different medicolegal forms, and the clinical diagnosis associated with this common method of suicide among men. Explore the complexities of complete and incomplete hanging, physiological effects, and medicolegal implications.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
PLAN I . INTRODUCTION-DEFINITION II . MODES DE PENDAISON III . PHYSIOPATHOLOGIE IV . FORMES MEDICOLEGALES V . DIAGNOSTIC CLINIQUE VI . CARACTERES ANATOMO-PATHOLOGIQUES VII.EXPERTISE MEDICOLEGALE VIII . CONCLUSION
I . INTRODUCTION-DEFINITION La pendaison repr sente le mode de suicide le plus fr quent chez l'homme. Il s agit d un acte de violence au cours duquel le corps, pris par le cou, dans un lien attach un point fixe, est abandonn son propre poids, exerce sur le lien sup rieur, une traction assez forte pour amener la mort . Dans ce cas, la constriction est passive, brutale et verticale ce qui la diff renci de la constriction active, progressive et horizontale de la strangulation au lien.
II . MODES DE PENDAISON 1.La Pendaison compl te : (70%) : quand la suspension du corps est totale et il n y a aucun point d appui sur le sol ou un support quelconque. 2. La Pendaison incompl te : (30%) : dans ce cas, la suspension du corps n est pas totale et une partie du corps repose sur un support (Sol, chelle ).
III . PHYSIOPATHOLOGIE 1. An mie c r brale : L oblit ration vasculaire carotidienne et jugulaire est l origine d une anoxie c r brale. Dans cette occlusion vasculaire, l oblit ration carotidienne est pr pond rante et peut survenir pour des forces de l ordre de 5kg alors que l oblit ration Jugulaire est plus pr coce (2kg). 2. Asphyxie : produite par compression trach ale et laryng e de m me que par le refoulement de la base de la langue contre la paroi post rieure du pharynx ; 15 kg suffisent pour obtenir ce r sultat. 3. Inhibition :provoqu e par l irritation traumatique des nerfs du cou et des sympathiques p ri-carotidiens, provoquant ainsi un arr t cardiaque reflexe.
IV . FORMES MEDICOLEGALES 1. La pendaison suicidaire : fr quente par sa facilit d ex cution et son caract re radical. 2. La pendaison accidentelle : rare. Le cas le plus fr quent est celui de l enfant attach dans un lit par les sangles. 3. La pendaison criminelle : Sa raret s explique par la difficult de la r alisation de l acte n cessitant l existence des facteurs favorisants: faiblesse physique (enfant, vieillard, maladie) ou mentale de la victime , l action de l alcool ou une autre drogue. 4. La pendaison supplice : ex cution judiciaire. 5. La pendaison simulation :
V . DIAGNOSTIC CLINIQUE Les troubles cliniques ont t d crits par Tardieu en trois phases : *La phase initiale: Commence au moment m me o le corps abandonn son poids, serre le lien autour du cou. Elle se caract rise par une douleur locale , une sensation de chaleur la t te avec une rougeur de la face allant la cyanose, des bourdonnements, des sifflements, des blouissements, les jambes s alourdissent. *La phase convulsive: D s que la perte de conscience est compl te. Elle est marqu e par des convulsions qui si gent la face, aux membres sup rieurs et inf rieurs et peuvent tre l origine d ecchymoses traumatiques.
*La phase terminale ou la mort apparente commence avec la cessation des mouvements respiratoires. Les manifestations cliniques au cours de cette p riode : aspect : faci s pr sente un certain degr de cyanose, suivi d un syndrome vasomoteur avec un visage rouge et vultueux. Signes respiratoires comprennent : -les accidents de suffocation dus l d me laryng -les apn es dues aux d sordres du syst me nerveux central -l d me pulmonaire fr quent r sultant de l hypertension veineuse due une hypoventilation. Signes neurologiques : Constants, les plus graves, c est le coma anoxique, les signes d accompagnement comprennent : -manifestations pyramidales, troubles du tonus, les mouvements anormaux, les tats d agitations et les crises pileptiformes ; il semble que ces signes soient en rapport avec l d me c r bral. -Le syndrome neurov g tatif : il est d une constance remarquable fait d hyperthermie, de sueur, d HTA, rougeur ..etc.
VI.CARACTRES ANATOMO-PATHOLOGIQUES : *Les l sions d ordre asphyxique : sont variables comme les facteurs pathog niques qui les engendrent. On distingue les pendus-blancs, la mort provient suite un r flexe inhibiteur et les pendus-bleus, la cyanose faciale, les ecchymoses sous-conjonctivales indiquent que l asphyxie et les troubles circulatoires ont t pr dominants comme cela se produit quand le n ud du lien est lat ral. Le syndrome asphyxique est souvent tr s discret : -les poumons sont congestionn s dans des cas. -l emphys me sous-pleural est plus fr quent. -raret des taches de Tardieu. -la congestion c r brale et l h morragie m ning e sont inconstantes. -parfois, on d couvre un piquet h morragique de la muqueuse stomacale et des suffisons sanguines externes le long du tube digestif.
*particularits thanatologiques se sont : -la projection de la langue hors de la bouche (inconstante) -l exophtalmie (rare) -l h morragie du conduit auditif (rare) -la turgescence de la verge et l jaculation (ph nom nes agoniques) -les lividit s localis es aux membres inf rieurs et particuli rement intenses aux pieds et aux mains (ph nom nes cadav riques).
*Lsions traumatiques : elles sigent au cou et proviennent des pressions et des tractions exerc es par le lien sur les tissus et les organes qui occupent les diff rents plans du cou. A la surface du cou, on trouve l empreinte du lien , le sillon au dessus du larynx. Il en existe deux vari t s : -sillon creux : en rigole, parchemin , blanch tre (ligne argentine) lorsqu il est du une corde ou un lien troit ou rugueux. -sillon large, mou tal bord impr cis, lorsque le lien est un foulard ou un linge. Le sillon est en g n ral unique, oblique, incomplet, plus profond en plein de l anse.
*Les lsions profondes du cou : -les ecchymoses tissulaires, musculaires, laryng es, r tro- pharyng es. -les d chirures musculaires +/-infiltration sanguine. -les l sions carotidiennes : Manchon ecchymotique de la tunique externe, d chirure transversale de la tunique interne (l sion d AMUSSAT). -les fractures des cornes de l os hyo de plus rarement celles du cartilage thyro de. -les l sions rachidiennes: ( Luxation, d collement ou fracture). *Les l sions agoniques : -les rosions et les ecchymoses diverses proviennent de heurtes contre un plan r sistant pendant la p riode de convulsion.
VII . EXPERTISE MEDICOLEGALE A/L examen externe d une victime de pendaison est centr sur l tude de l agent asphyxiant(ou de ses traces), ainsi que sur la recherche des l sions associ es, susceptibles d apporter des l ments dans le diagnostic m dico-l gal du d c s : A1-sur les lieux: Le m decin doit avant tout tudier le lien, les n uds, l attache et la position du corps.
-le lien : corde, sangle, cordelire, ceinture, foulard, bas, v tements. On valuera la longueur, la r sistance, l lasticit possible. -les n uds : sont tr s instructifs, chaque profession sa mani re elle de faire les n uds. -l attache : on en mesurera la hauteur, on appr ciera la solidit . -la position du corps : mensuration de la taille, la distance des pieds au sol, si la pendaison est compl te, mensurations des angles d inclinaison des diff rentes parties du corps, si la pendaison est incompl te. -les attitudes du corps : inclinaison de la t te par rapport l anse du lien, bras coll au corps, mains crisp es, membres inf rieurs fl chis. T te en g n ral inclin e du cot oppos au n ud. La situation du n ud par rapport au cou est le plus fr quemment nucale, quelquefois lat rale, exceptionnellement ant rieure.
A2-lexamen : -visage : en g n rale pale quand l anse est ant rieure, cyanos quand elle est lat rale. -la cyanose est fonction de l agonie et pr domine au niveau des oreilles et des l vres. -les h morragies sous-conjonctivales. -la langue fait issue hors de la bouche. -exophtalmie assez fr quente -lividit s distales -l empreinte du lien ou sillon de pendaison. A3- Autopsie : la dissection du cou plan par plan, montre au niveau de la zone de striction des l sions multiples et pr dominent au niveau de l anse.
VIII . CONCLUSION La pendaison est le mode de suicide le plus fr quent. Habituellement, le diagnostic de la pendaison est fait l examen externe par la constatation du sillon cervical caract ristique, ainsi qu l autopsie qui montre un tat asphyxique. Il faut tre particuli rement vigilant lors de l examen d un pendu pour ne pas passer cot d un homicide.
pendaison Strangulation au lien -sillon horizontal, souvent multiple. -sillon en g n ral oblique, le plus souvent unique. -profond et parchemin ; plus marqu au niveau du plein de l anse. -moins profond, uniform ment marqu -plac le plus souvent au dessous du larynx. -situ la partie sup rieure du cou. -circulaire interrompue. -compl tement circulaire. syndrome asphyxique souvent discret. -signes marqu s d asphyxie. -l sions traumatiques du cou plus important. -lividit s localis s au membre Inf rieur. -lividit s variables. -pr sente un aspect h b t . -pr sente un aspect surpris. -d sordre et d chirure des v tements. -Le plus souvent d origine suicidaire. - le plus souvent d origine criminelle. -force constrictive passive. -force constrictive active. - force de traction verticale passive. -force de traction horizontale active.
